EUGÈNE POUPIN, ÉDITEUR DE CARTES POSTALES
Au tout début du XXème siècle, à l’époque dite « de l’âge d’or » des cartes postales, beaucoup de photographes locaux vont éditer des cartes, souvent avec talent. La plupart d’entre eux rayonneront ainsi sur leur canton et le voisin. Quelques uns seulement auront pour ambition de couvrir l’ensemble du département de la Vendée ; parmi ceux-ci, il convient de citer entre autres Jules Robuchon, Lucien Amiaud (Cf. article sur le présent Blog N° 5-25), Paul Dugleux (Cf. article N°5-28) et surtout Eugène Poupin. Ce dernier est peut-être le plus célèbre, parce que le plus prolifique du département et le meilleur commerçant en zone rurale.
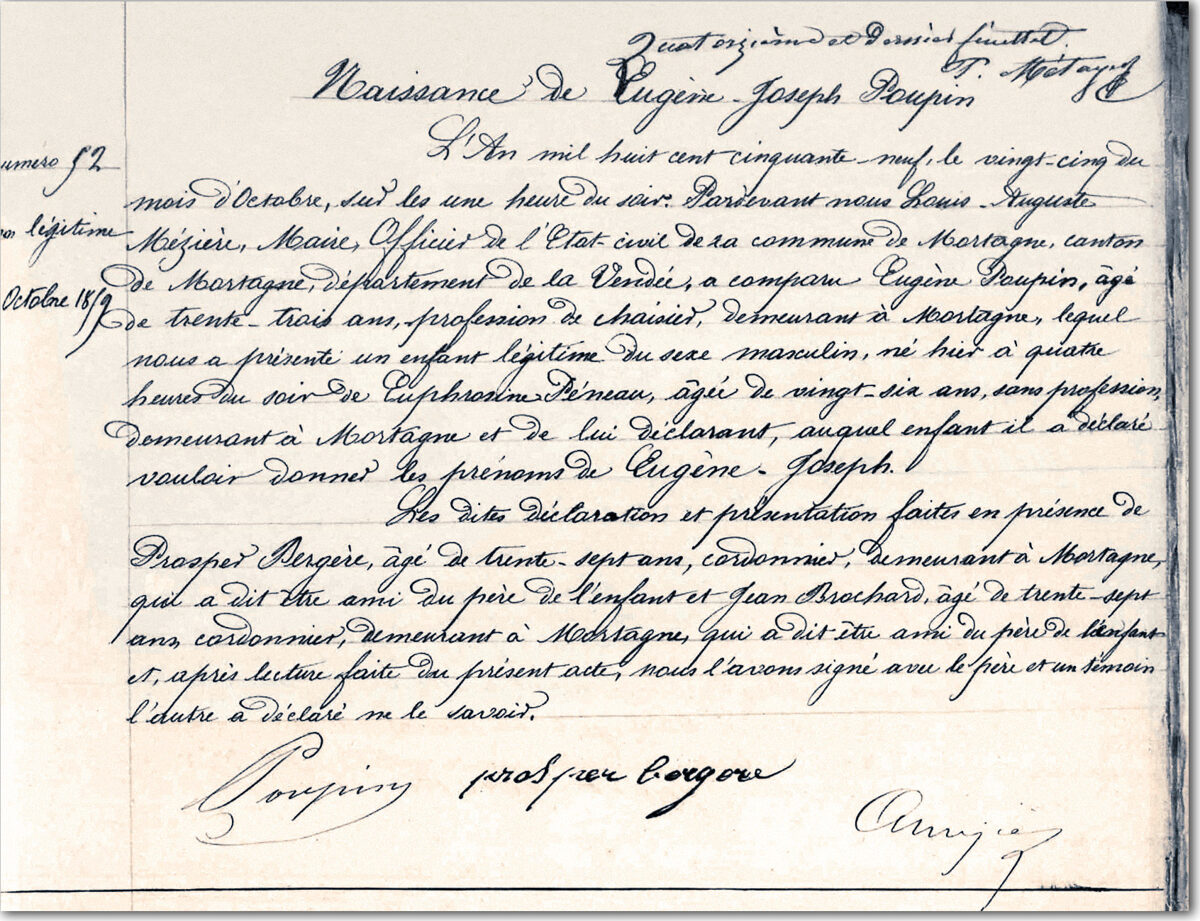 Extrait
du registre d’État civil de 1859 (Archives Départementales de la Vendée).
Extrait
du registre d’État civil de 1859 (Archives Départementales de la Vendée).
Eugène, Joseph POUPIN est né le 24 octobre 1859 à Mortagne-sur-Sèvre, route de Cholet, fils d' Eugène Poupin et d’Euphrasine Péneau (Cf. image ci-dessus). Il a ainsi reçu le prénom de son père Eugène et le 10 juillet 1862, il aura une sœur qui recevra, elle, le prénom de sa mère Euphrasine. Il passe sa jeunesse dans cette ville au Nord-Est du bocage vendéen et ne semble pas avoir poursuivi ses études au delà du cycle de l’école primaire. Il adopte tout d’abord le métier de son père « chaisier », mais avec le désir de s’en échapper. C’est, en effet, un jeune homme imaginatif et assez doué de talents artistiques. Il réalise des chansons, des dessins d’un certain intérêt, des instruments de musique et des sculptures, notamment sur des ceps de vigne. Il suivait ainsi la trace de son grand-père qui aurait fabriqué une draisienne vers 1810, comme le montre la photo ci-dessous.
 Bayard,
le vélocipède de M. Poupin vers 1810.
Bayard,
le vélocipède de M. Poupin vers 1810.
Âgé d’à peine 22 ans et chaisier, il épouse le 14 juin 1881 à Mortagne-sur-Sèvre Philomène-Marie Leigneil, sage-femme dans cette ville. Par contre, l’année suivante, au recensement de 1882, il se déclare tourneur et à celui de 1888 relieur, preuve qu’il cherche visiblement sa voie. Au recensement de 1891, il est encore officiellement chaisier et habite alors route de Nantes. Par contre à celui de 1896, il est bien désormais libraire, place de l’Église. Enfin à celui de 1906, sa librairie est alors installée à l’endroit définitif et reconnu : rue Nationale à Mortagne-sur-Sèvre.
Son épouse et lui ont eu deux filles : Annette (Eugénie, Clarisse) Poupin née le 11 juillet 1882 et Eugénie (Augustine, Alexandrine) Poupin née le 16 mai 1888. C’est l’aînée Annette qui épousera plus tard, le 15 décembre 1904 à Ivry-sur-Seine, (Charles) Victor Jehly. En attendant, c’est également elle qui aidera son père à faire des photographies, en posant vêtue de différents costumes pour illustrer les cartes des multiples coiffes locales de Vendée, ainsi que la célèbre « mariée de Chambretaud » (Cf. la 1ère image ci-dessous).
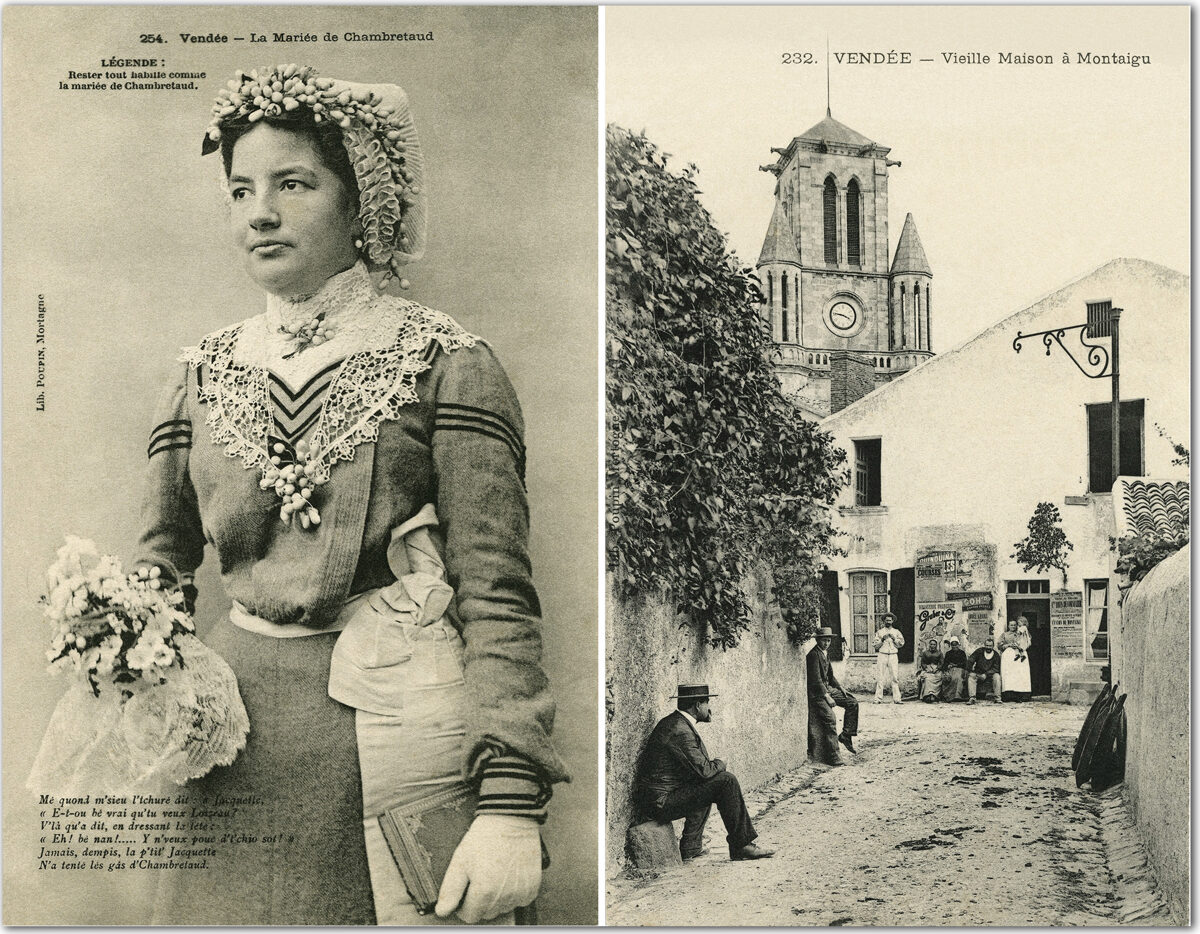 Gauche : La
Mariée de Chambretaud (1904). Droite : Dans
une rue à Montaigu (1901).
Gauche : La
Mariée de Chambretaud (1904). Droite : Dans
une rue à Montaigu (1901).
En effet, sa nouvelle profession de libraire l’a amené à s’intéresser à une récente activité : la photographie. Cela devient assez vite une passion et il réalise quelques plaques vers 1897. Toutefois, comme il n’est pas photographe de profession (il se dira d’ailleurs toujours libraire ou éditeur), il n’a pas tout de suite l’idée de les commercialiser. Il ne peut donc pas être compté parmi les pionniers, mais seulement dans les précurseurs. C’est à partir de 1900 qu’il édite en réalité ses premières cartes postales.
Une rencontre va être déterminante dans sa carrière, celle avec un photographe déjà de renom depuis quelques années, Lucien Amiaud de la Roche-sur-Yon. Ils se retrouvent tous les deux un après-midi dans une rue à Montaigu en 1901 et vont immortaliser l’évènement. Lucien Amiaud va réaliser une première photo représentant une rue avec Eugène Poupin assis sur une borne au premier plan. Il la publiera dans sa collection « Photogravure L. Amiaud La Roche-s-Yon » sous le numéro 225 en 1902. Il cédera la plaque à Eugène Poupin, qui la publiera à son tour en 1904 sous le numéro 232, comme le montre la 2ème image ci-dessus. Lucien Amiaud prendra un second cliché représentant son collègue en train d’installer son matériel pour prendre une photo aux Olivettes de Montaigu (Cf. image si dessous).
 Le
photographe à Montaigu.
Le
photographe à Montaigu.
Dans l’œuvre photographique d’Eugène Poupin, son célèbre magasin de la rue Nationale est visible au moins deux fois : une première fois sur une carte spéciale, sans titre, ni numéro, représentant le tombereau hippomobile des éboueurs et portant l’inscription « Attention Lisa, Boug’ pas, tu vas te faire photographier » ; une deuxième fois sur une carte intitulée « la rue Nationale » éditée en 1905 sous le numéro 1095 (Cf. image ci-dessous). Sur cette dernière on aperçoit principalement la sortie des enfants des écoles, mais aussi, sur la gauche la librairie Poupin. Dans la vitrine on distingue des livres, des documents, des chapelets, un christ, cinq plaques portant des cartes postales et le nom de propriétaire « E. POUPIN ». Il est très probable que la dame que l’on voit entre deux messieurs soit Madame Philomène Poupin.
 La
librairie Poupin (1905).
La
librairie Poupin (1905).
Pour réaliser ces reportages photographiques Eugène Poupin ne disposera jamais d’automobile ; en revanche il s’est fait fabriquer un curieux véhicule hippomobile à quatre roues, avec un grand coffre cubique, mélange de voiture à cheval et de carriole de livraison. Il était assez semblable à ceux des voyageurs de commerce (les rouleux), qu’il ira d’ailleurs photographier à Saint Michel-Mont-Mercure en 1904 (N°351). Ce fameux véhicule se retrouvera, plus ou moins volontairement, dans le champ visuel de plusieurs de ses clichés, en particulier à Évrunes, La Verrie, Tiffauges, Les Landes-Génusson, Les Herbiers (Cf. image à la suite), Sainte Florence-de-l’Oie, Saint Jean-de-Beugné (Cf. image ci-dessous), Nalliers, Le Girouard etc.
 Le
véhicule d’Eugène Poupin à Saint Jean-de-Beugné.
Le
véhicule d’Eugène Poupin à Saint Jean-de-Beugné.
Ses plaques ne sont pas vraiment classées dans l’ordre chronologique, mais les numéros de ses cartes permettent de suivre à peu près l’itinéraire qu’il effectuait lors de ses sorties pour une campagne de photos. Ainsi, en faisant le voyage de Mortagne vers La Chataigneraie (N°1237, 1246) il est passé à Pouzauges (N°1219) et est revenu par Cheffois (N°1220), Mouilleron en Pareds (N°1224, 1227), Monsireigne (N°1254), Mouchamps (N°1232, 1250), Beaurepaire (N°1217).
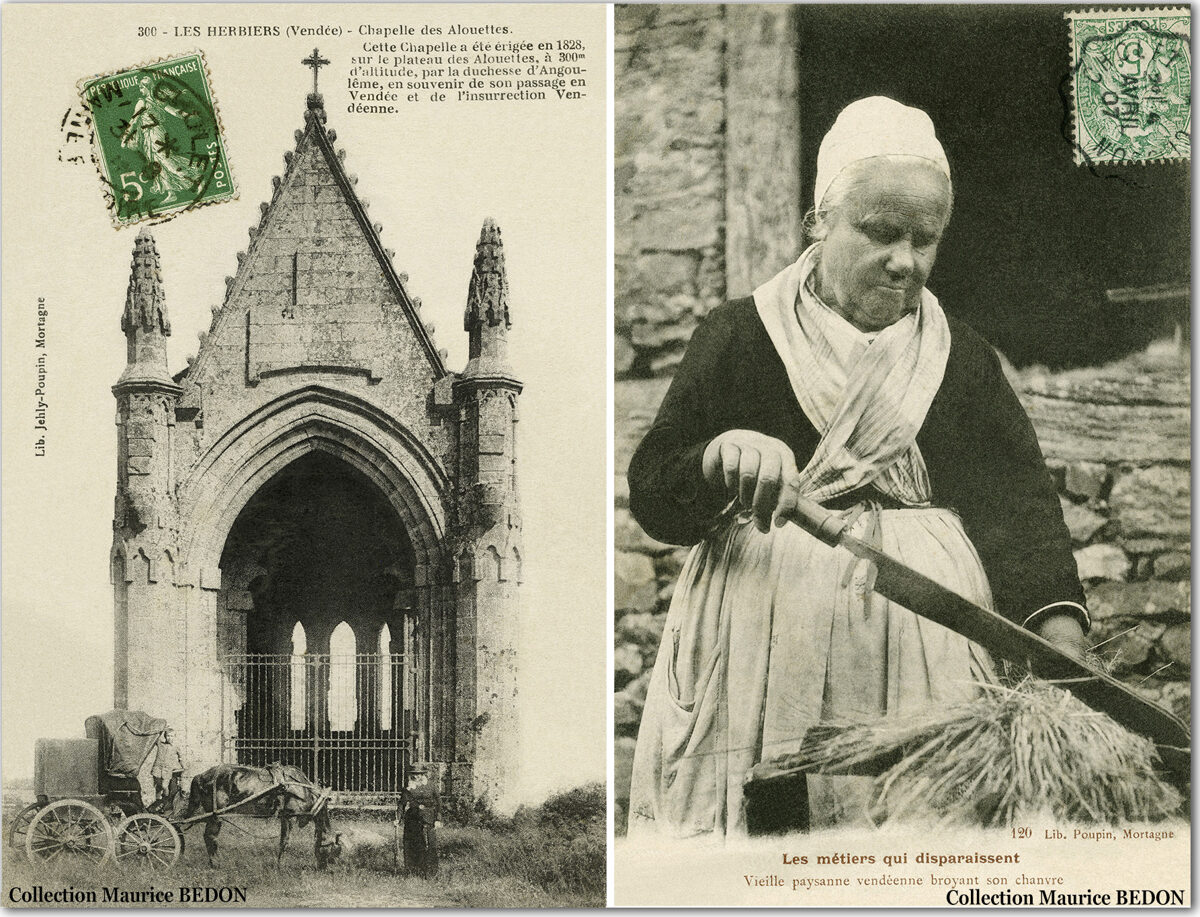 Gauche : Le
véhicule aux Herbiers (1904). Droite : La
broyeuse de chanvre (1902).
Gauche : Le
véhicule aux Herbiers (1904). Droite : La
broyeuse de chanvre (1902).
L’œuvre photographique d’Eugène Poupin a connu deux périodes : celle des précurseurs (1900 à 1903) et celle de l’âge d’or (1904 à 1914). Durant la première, le verso était réservé à l’adresse, la correspondance et l’image devaient alors se partager le recto. A partir de décembre 1903, l’image est autorisée à couvrir tout le recto, la correspondance se faisant au verso partagé avec l’adresse.
Eugène Poupin a un peu anticipé ce changement, car ses images n’ont jamais laissé beaucoup de place à la correspondance. Jusqu’en 1903, ses cartes sont reconnaissables au fait que les légendes sont toutes écrites en rouge (d’où le surnom de « Poupin rouges »). Elles représentent soit des monuments, des rues avec peu d’animation ou bien des vieux métiers (Cf. carte ci-dessus N°120). Durant cette période, il a édité un peu moins de 200 cartes et n’a guère quitté le canton de Mortagne. La carte reproduite ci-dessous, non numérotée, représentant une rue de Mortagne, est une des premières qu’il ait réalisée.
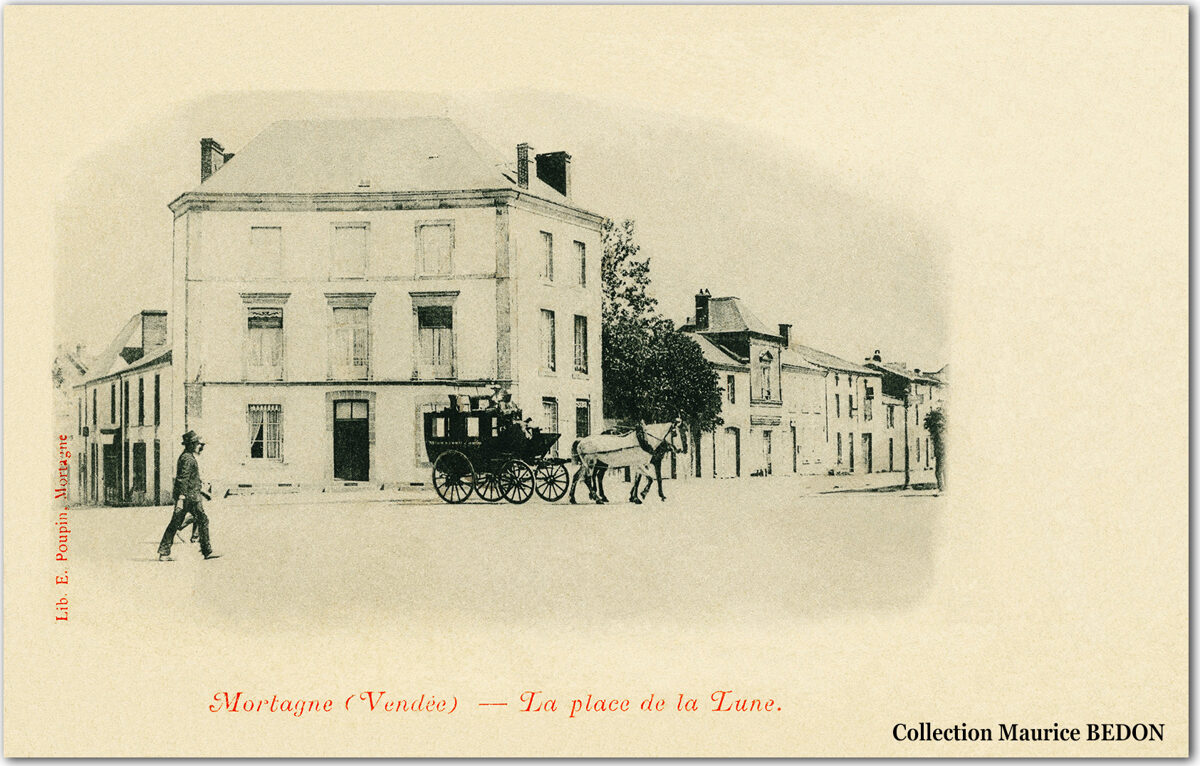 La
place de la Lune à Mortagne (1900).
La
place de la Lune à Mortagne (1900).
Durant la deuxième période, Eugène Poupin change de style complètement. Pour avoir une collection personnelle aussi complète que possible, il parcourt sans cesse tout le département, même les communes déjà couvertes par un collègue. En dix ans, lui, l’autodidacte, va produire à lui seul environ 3 500 plaques. Il ne sera dépassé dans la région que par les grandes maisons qui disposent d’une automobile et de plusieurs photographes : Bergevin à La Rochelle et Artaud-Nozais à Nantes.
Il ne se limitera d’ailleurs pas au seul département de la Vendée. Mortagne étant à proximité de la frontière des trois provinces (Poitou, Anjou, Bretagne), il photographie aussi dans le bas de la Loire-Atlantique, dans celui du Maine-et-Loire et dans le haut des Deux-Sèvres.
 Le
Puy-Greffier à Saint Fulgent (1904).
Le
Puy-Greffier à Saint Fulgent (1904).
Dans une commune, il essaie de tout avoir : l’église, les châteaux, les anciens logis, les rues, les évènements. Il est l’un des premiers à créer des cartes dites multivues, qu’il réalise en plaçant toutes les cartes faites dans une commune sur un support décoré et en photographiant la composition. Ces cartes, moins intéressantes, sont pourtant utiles aux collectionneurs pour savoir ce qui existe dans une commune.
Même si c’est son collègue Armand Robin de Fontenay-le-comte qui est considéré comme le spécialiste des « Châteaux de Vendée », Poupin n’en a pas oublié non plus.
La carte reproduite ci-dessus (N°527) représente les ruines de l’ancien château du Puy-Greffier à Saint Fulgent, qu’il a photographié en 1904. Toutes ses cartes de monuments bénéficient d’une longue légende très bien documentée (sans doute parce que son auteur était libraire). Au Puy-Greffier il a même produit un document précieux, puisque le château a été ensuite dynamité en 1974.
 Un
carrefour à Mesnard-la-Barotière (1908).
Un
carrefour à Mesnard-la-Barotière (1908).
Il a bien compris que les clichés présentant un maximum de personnes « étaient plus recherchés et commercialement plus rentables », alors il n’hésitait pas à réunir tous les habitants du quartier. Il le faisait d’autant plus facilement, qu’à l’époque, c’était nouveau et que les gens étaient très heureux de se faire photographier. C’est principalement le cas sur la carte reproduite ci-dessus à Mesnard-la-Barotière (N°1881), mais également à Treize-Septiers (N°1838), La Flocellière (N°1633), Les Herbiers (N°1867), Menomblet (N°1653), Saint Fulgent (N°1822), Saint Martin-des-Noyers (N°1899), La Ferrière (N°1604 & 1605) etc…
 Le
marché aux Herbiers (1905).
Le
marché aux Herbiers (1905).
Il s’est naturellement aussi intéressé à tous les aspects de la vie quotidienne : les vieux métiers (comme nous l’avons vu précédemment), les lavoirs comme à Mouilleron-en-Pareds (N°1235) ou à Champ-Saint-Père (N°2712), les scènes familiales reconstituées comme le « reçonnage », la veillée à la ferme (N°1089), la robe de mariée (N°1171) ou les nombreux personnages locaux pittoresques comme le célèbre « Riquiqui » (N°1083, 1084, 2504).
Il n’a évidemment pas manqué d’aller photographier les foires et marchés, comme à Mortagne-sur-Sèvre (N°929 à 933), Pouzauges (N°1637 à 1643), Les Herbiers (N°908 à 915 & 2164), L’Oie (114 à 116) ou l’Herbergement (N°947). La carte postale, reproduite ci-dessus (N°908) représentant le marché aux Herbiers, par sa précision et les personnages en gros plan, est une des meilleures réalisations dans le genre.
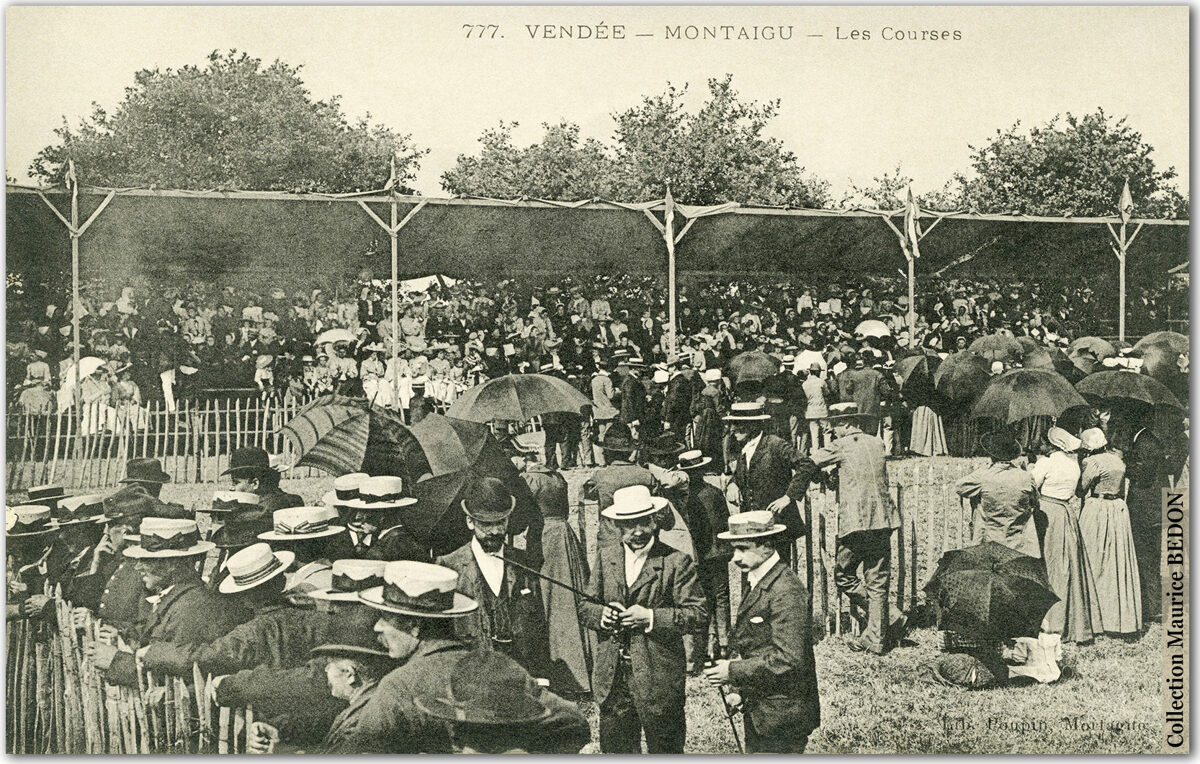 Les
Courses à Montaigu (1905).
Les
Courses à Montaigu (1905).
Les fêtes locales de toutes natures n’ont pas été oubliées non plus par Eugène Poupin. Il a photographié entre autres : les Courses hippiques de Montaigu (N°777, reproduit ci-dessus), Les Fêtes de gymnastique à La Verrie en 1909 (sans N°), Les Réjouissances populaires à Mortagne-sur-Sèvre (N°969 & 970), Les fêtes en l’honneur de Jeanne d’Arc à Pouzauges (N°2554 à 2558), au Boupère (N°2507 à 2509), ou aux Brouzils (sans N°).
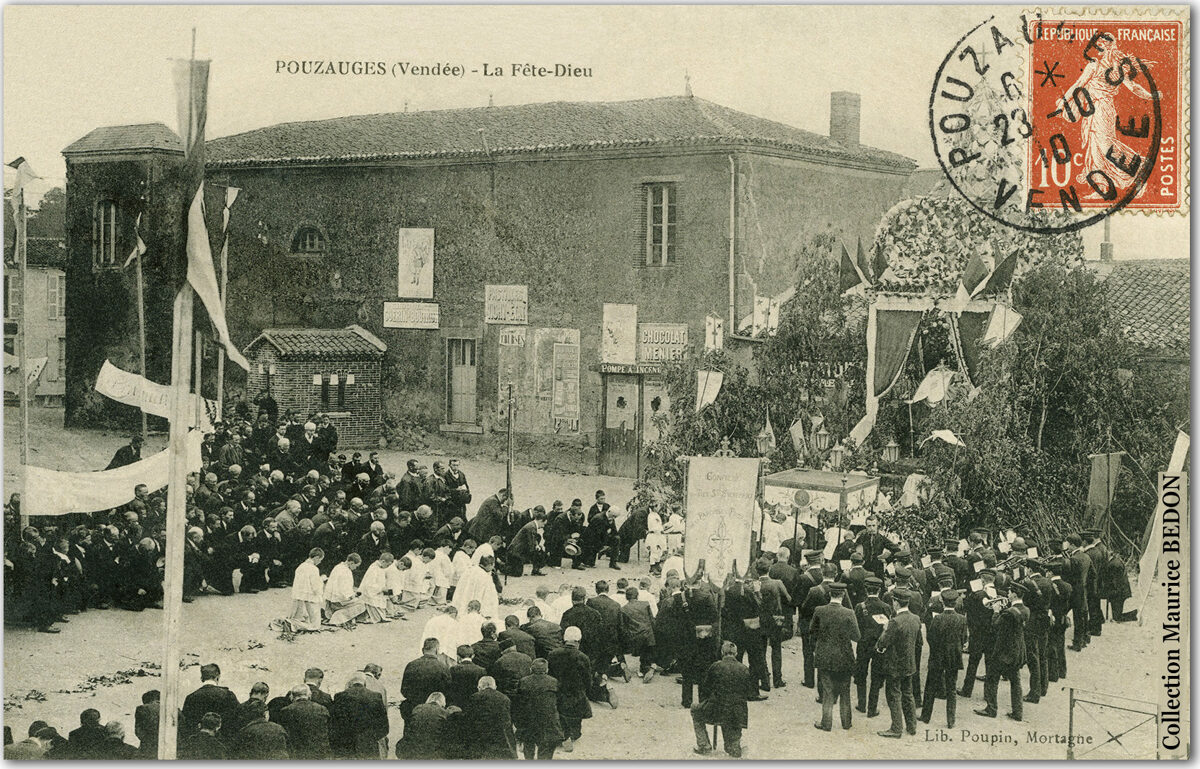 La
Fête-Dieu à Pouzauges (1910).
La
Fête-Dieu à Pouzauges (1910).Dans le même esprit, il s’est également consacré aux fêtes religieuses traditionnelles, comme les missions, les communions ou les processions de la Fête-Dieu. Nous avons ainsi la possibilité de trouver la Fête-Dieu à Pouzauges (2 cartes sans N°), dont une est reproduite ci-dessus. Il existe aussi les pèlerinages comme celui du Bienheureux Louis-Marie Grignion de Montfort à Saint Laurent-sur-Sèvre (N°886 & 887), les processions comme à Chavagnes-les-Redoux (N°1994), les adorations comme à Chavagnes-en-Paillers (N°2288) ou les Missions.
En 1909, il est chargé d’assurer le reportage photographique du pèlerinage (ou congrès) eucharistique vendéen annuel, qui se tient cette année-là dans la commune des Épesses. Il le fera en cinq clichés : la musique et la procession (N°2460), la procession sur la grande place (N°2463), le passage du Saint-Sacrement (N°2461), la messe en plein air (N°2464) et le retour à l’église (N°2462). C’est cette dernière qui est la première reproduite ci-dessous.
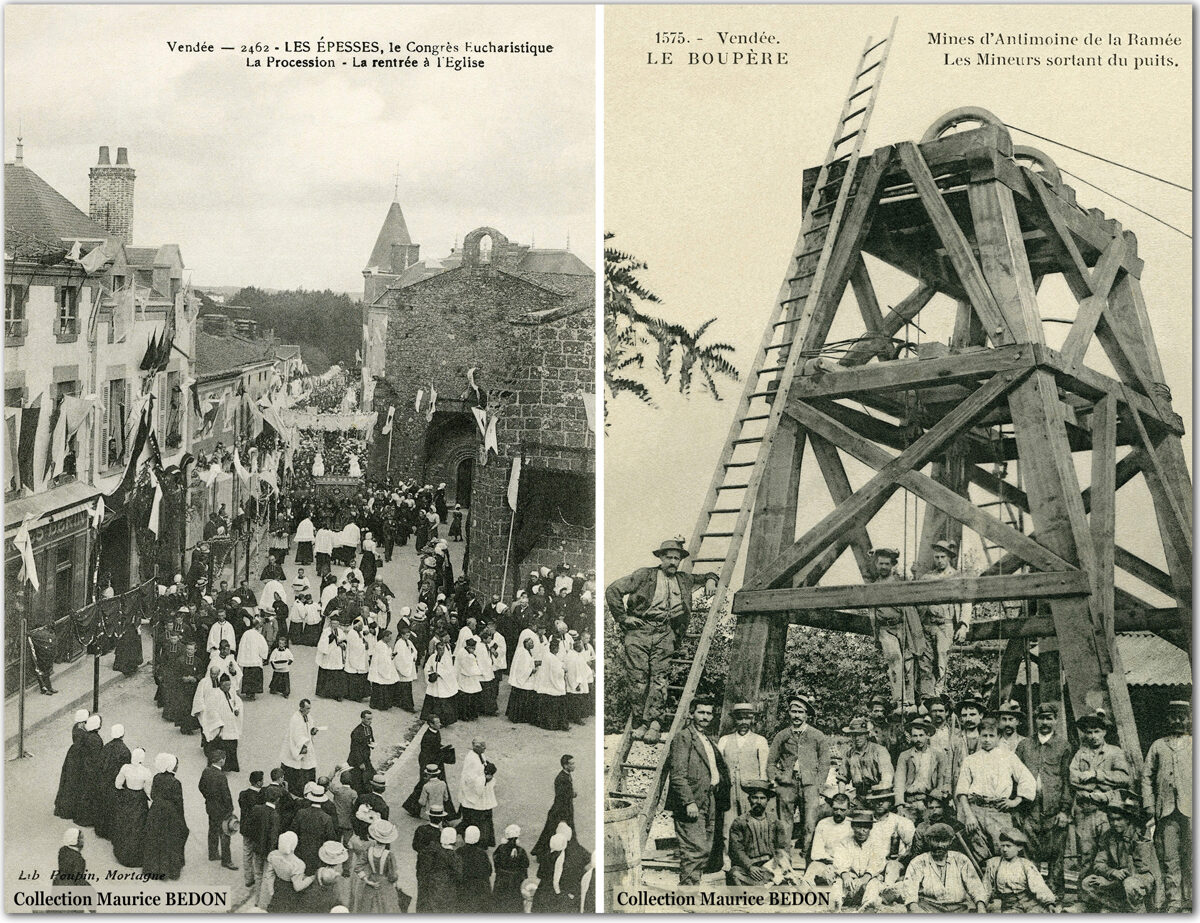 Gauche : Pèlerinage
eucharistique aux Epesses (1909). Droite : Le
chevalement de la mine de La Ramée (1907).
Gauche : Pèlerinage
eucharistique aux Epesses (1909). Droite : Le
chevalement de la mine de La Ramée (1907).
Dans un tout autre domaine, celui des activités agricoles, artisanales et industrielles, il a également produit des cartes postales, qui au prix du marché actuel des collectionneurs, ont pris beaucoup de valeur. Dès le départ il a été attiré par les métiers en voie de disparition : les tisserands (N°131), les tuiliers (N°1266), ou les techniques agricoles ancestrales : le battage à la gaule (N°133) le battage au rouleau (N°2628), la vannage (sans N°), le ramassage des pommes de terre (N°472).
Il a ensuite évolué vers l’industrie ou la construction : la sortie d’usine aux Herbiers (N°2235), l établissement de la ligne de chemin de fer à Mouchamps (N°2301), la construction de la gare de Mortagne-sur-Sèvre (N°3412) ou du viaduc de la Maunerie aux Herbiers (N°2465), la mine de Rochetrejoux (N°2292, N°2303, N°2312, N°3244).
En 1907, il a fait plusieurs voyages au Boupère pour la mine d’antimoine de la Ramée située sur cette commune. Le premier a eu lieu pour l’arrivée de l’énorme machine à vapeur, transportée par cinq paires de bœufs et un cheval depuis la gare de la Meilleraie-Tillay jusqu’à la mine (N°1572). Il s’agit de la carte reproduite ci-dessous. Il en a profité pour photographier toutes les installations de la mine (N°1575, Cf. 2ème photo ci-dessus, N°1840 & N°1910). Il en a ensuite réalisé un second déplacement pour la visite officielle du Préfet de la Vendée et des autorités (N°1865), du défilé dans les rues (N°1874) et du banquet républicain au village de l’Aumondière (N°1872).
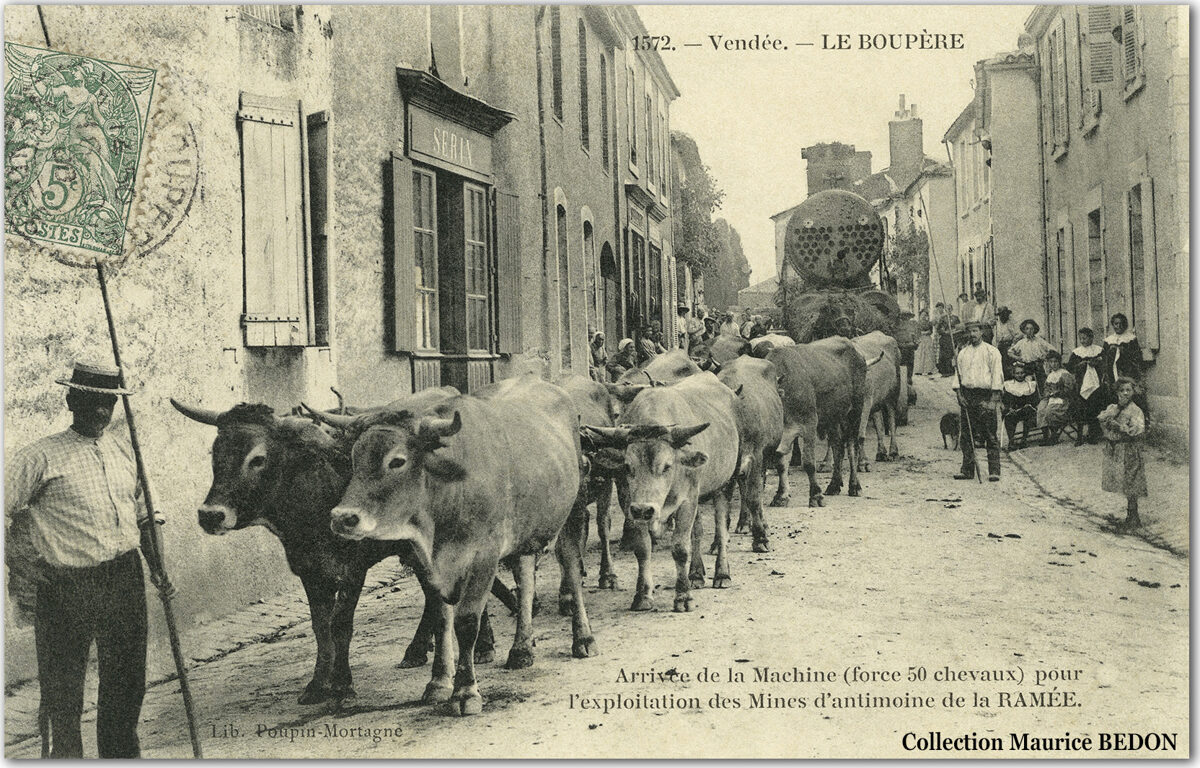 Le
transport de la machine à vapeur (1907).
Le
transport de la machine à vapeur (1907).
Du fait de la proximité avec Mortagne-sur-Sèvre, l’édification très spectaculaire du viaduc ferroviaire de Barbin à Saint Laurent-sur-Sèvre (300 m de long et 38 m de haut) a été le sujet qu’il a le plus suivi et où il est revenu très souvent, pratiquement à chaque étape du chantier. Ses différents clichés constituent un véritable reportage sur la construction et les techniques employées à l’époque. Il en a ainsi publié en carte postale une douzaine. On y trouve en effet la carrière de granit (N°645), les premières piles du viaduc (sans N°), la totalité des piles (sans N°), les 4 premières arches (sans N°, voir carte ci-dessous), les 6 premières arches (sans N°), les 7 premières arches (N°1036 à 1039), les 10 arches (N°1113), le viaduc presque terminé (N°1129 & 1531 ?), le viaduc vu de dessus (sans N° & 2224) et enfin l’ouvrage achevé (N°2593 & 1137, sûrement une erreur). Malheureusement, Eugène Poupin se trompe parfois dans la numérotation et en plus, ce qui induit en erreur, quand il réédite une carte, il y met un nouveau numéro.
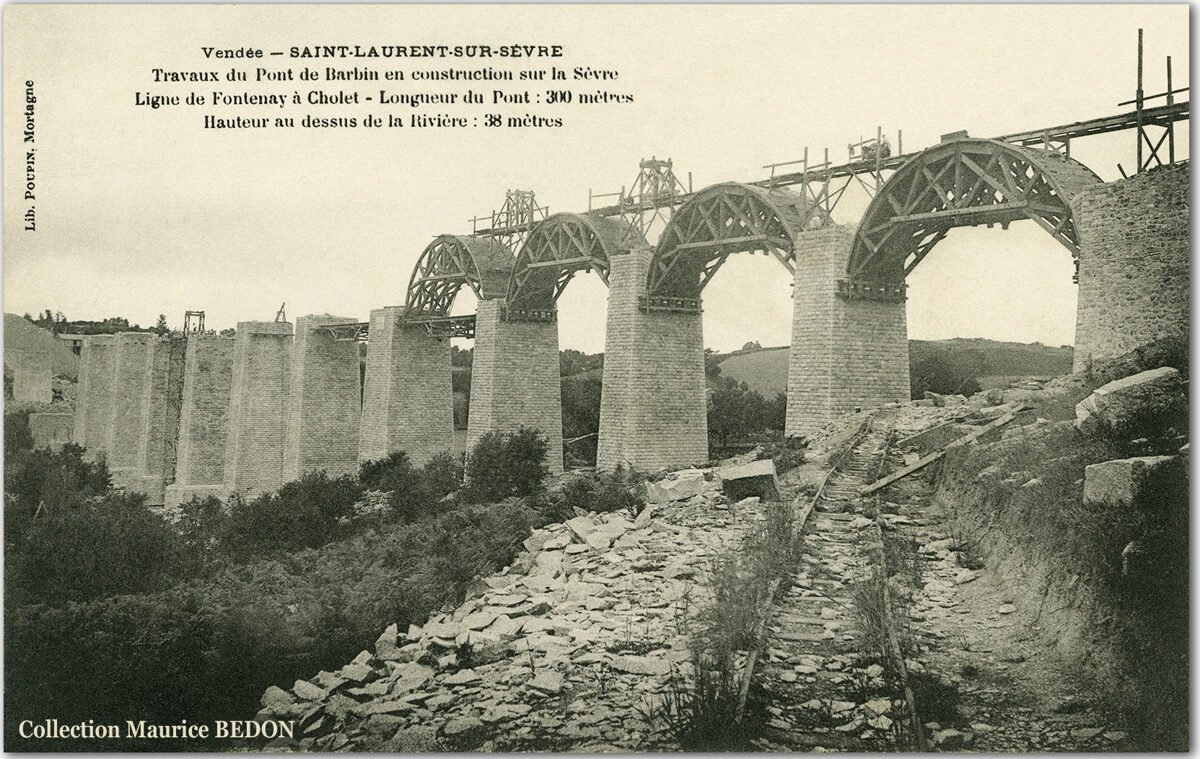 La
construction du viaduc de Barbin (1905).
La
construction du viaduc de Barbin (1905).
Il lui est arrivé aussi de faire des classements particuliers, quand certains clichés ou cartes ont fait l’objet de commande particulière. De cette manière, c’est lui qui a été chargé de photographier les dolmens et menhirs d’Avrillé et du Bernard sur la côte vendéenne, alors qu’il n’était pas le photographe du secteur. Nous lui en connaissons une série de 25, numérotées à partir du numéro 1. Il en a profité pour en faire certaines (animées celle-là) pour sa propre collection, comme les numéros 2634 (reproduite ci-dessous), 2655 et 2658 qu’il éditera plus tard. Auparavant, il n’avait pas manqué de s’intéresser très tôt aux monuments mégalithiques plus proches de chez lui, comme à Mortagne-sur-Sèvre (sans N° rouge), la Verrie (N° 54 rouge)
Plus surprenant, il a aussi édité sous la signature de EP un ensemble de cartes illustrées par des petits dessins humoristiques, avec des commentaires rédigés en patois local
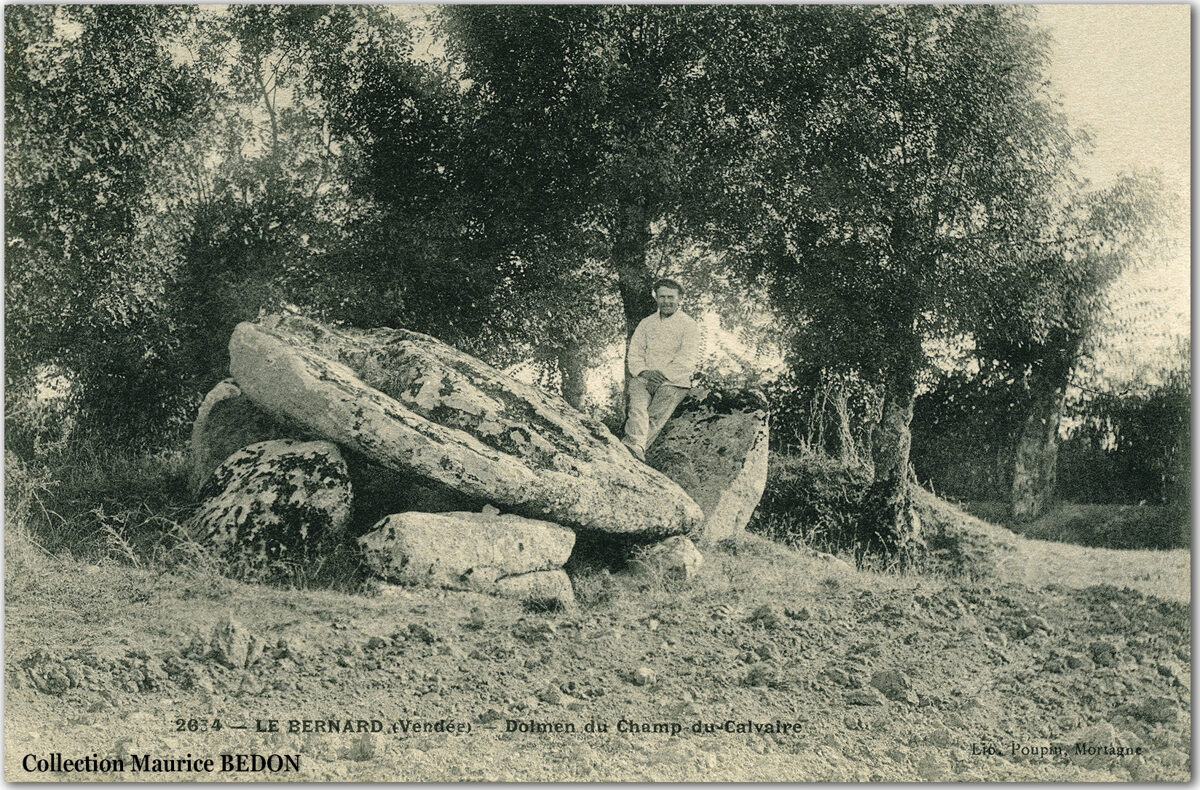 Un des dolmens du Bernard (Carte
éditée en 1909).
Un des dolmens du Bernard (Carte
éditée en 1909).
Trop vieux pour être mobilisé en 1914, Eugène Poupin a poursuivi ses activités professionnelles pendant la première guerre mondiale. Toutefois, il semblerait qu’il ait attrapé la grippe espagnole. En tous cas, il va décéder un mois avant la victoire du 11 novembre, le 15 octobre 1918 à presque 59 ans, à son domicile de la rue de Cholet et non pas au logement du magasin rue Nationale. A cette occasion, il est qualifié de « propriétaire » et non pas de « libraire ».
Après la guerre, sa fille Annette et son gendre (Charles) Victor Jehly vont prendre sa succession au magasin de la rue Nationale. Les cartes réalisées ensuite n’auront pas la même qualité que celles produites par Eugène Poupin lui-même. D’autant plus que son gendre va abondamment réutiliser certains clichés anciens jusqu’à leur usure. Un des fils Jehly prendra à son tour la succession de son père, mais finira par abandonner le métier de photographe.
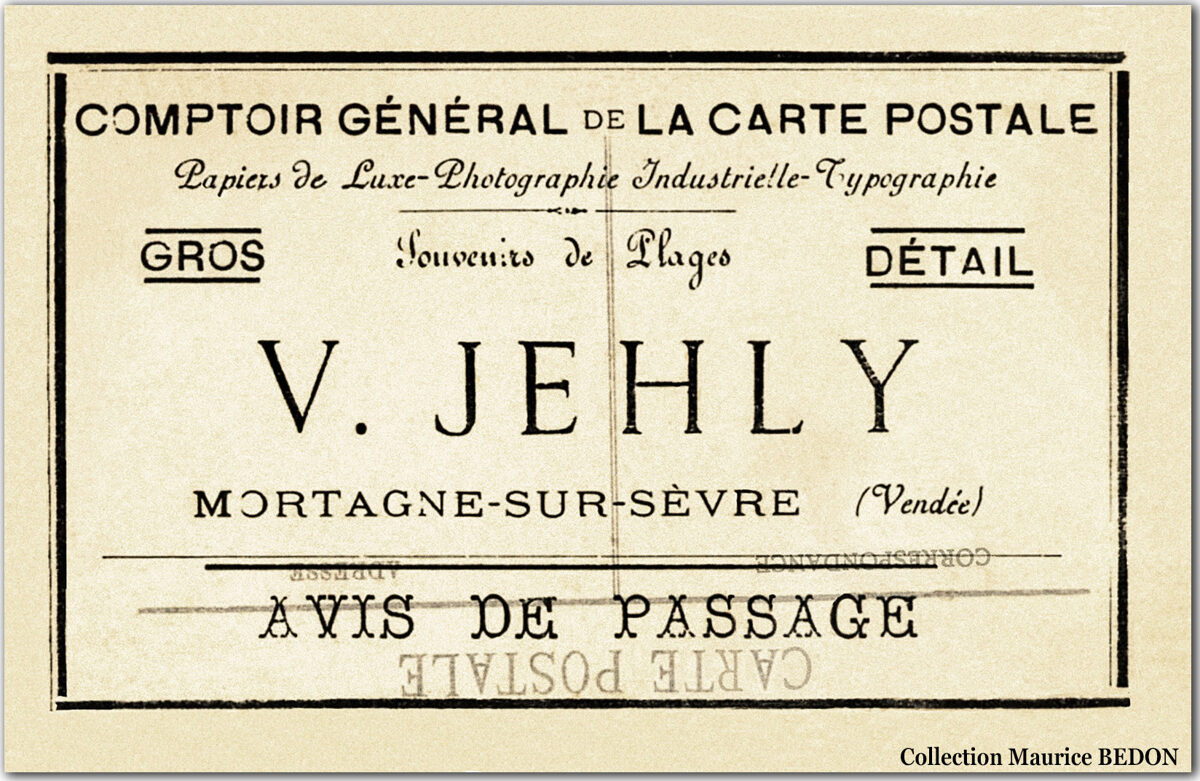 Carte d’avis de passage de Victor Jehly.
Carte d’avis de passage de Victor Jehly.
Annette Jehly est décédée le 18 mars 1958 et son mari Victor Jehly le 22 juin 1965. Malheureusement après cette date, lors de la succession, toutes les anciennes plaques photographiques, héritage d’Eugène Poupin, vont être jetées depuis le grenier au second étage dans un camion, pour être envoyées à la décharge, nous privant ainsi d’un patrimoine important et unique. Il ne nous en reste donc plus aujourd’hui que ses cartes postales, qu’il est important d’essayer de collectionner, pour s’efforcer de reconstituer ce patrimoine disparu.
Chantonnay le 8 novembre 2023.

L’AFFAIRE DES INVENTAIRES DE 1906 EN VENDÉE
Après qu’en 1789 le gouvernement révolutionnaire se soit approprié l’ensemble des propriétés de l’Église catholique en les déclarant biens nationaux, le Concordat Napoléonien de 1801 avait confié la gestion des lieux de culte (églises, cathédrales, séminaires) à des organismes publics, tels que les fabriques paroissiales. Celles-ci géraient tous les lieux de culte : les monuments anciens (antérieurs à 1789) aussi bien que tous les nouveaux édifices construits au cours du XIXème siècle. Or ces derniers avaient vu le jour grâce aux dons des fidèles ou de certaines familles, qui avaient en outre financé les cloches, les vitraux, le mobilier, les vêtements liturgiques, les objets du culte etc...
Désireux d’en finir avec le Concordat de 1801, les gouvernements anticléricaux de la IIIème République vont procéder d’abord à l’expulsion des Congrégations non autorisées (par leurs soins), puis à la Séparation de l’Église et de l’État. Cette dernière loi, datée du 6 décembre 1905, décidait de la dévolution des lieux de cultes à des associations cultuelles (qu’il fallait former).
Les catholiques, déjà sur leurs gardes depuis les mesures antireligieuses précédentes, n’acceptaient pas cette spoliation de leurs dons, qui pour eux portait tout simplement atteinte à la propriété privée. Certaines familles vont alors décider de reprendre possession des maisons données à usage de presbytères par exemple, comme à Mouchamps, Vendrennes, Saint-Vincent-Sterlanges, etc…
Quelques jours plus tard, le 29 décembre 1905, un décret d’application, pris dans une logique administrative (au mieux maladroite au pire volontairement agressive), prévoyait qu’« un inventaire descriptif et estimatif » serait établi de tout ce que contenait ces édifices à transférer. L’exaspération des fidèles était portée à son comble, car cette mesure apparaissait comme un préliminaire à la spoliation voire à la fermeture des églises.
Et pour couronner le tout, au début de l’année suivante, le 2 janvier 1906, une circulaire destinée aux agents du fisc annonçait que « les agents chargés de l’Inventaire demanderont l’ouverture des tabernacles ». C’est cette phrase, jugée comme une véritable provocation, qui allait mettre le feu aux poudres. Pour les catholiques, il s’agissait tout bonnement d’une véritable profanation sacrilège organisée par le pouvoir, à laquelle ils avaient bien l’intention de s’opposer de toutes leurs forces. Tous les éléments étaient en place pour que cette affaire suscite des émeutes et une opposition farouche.
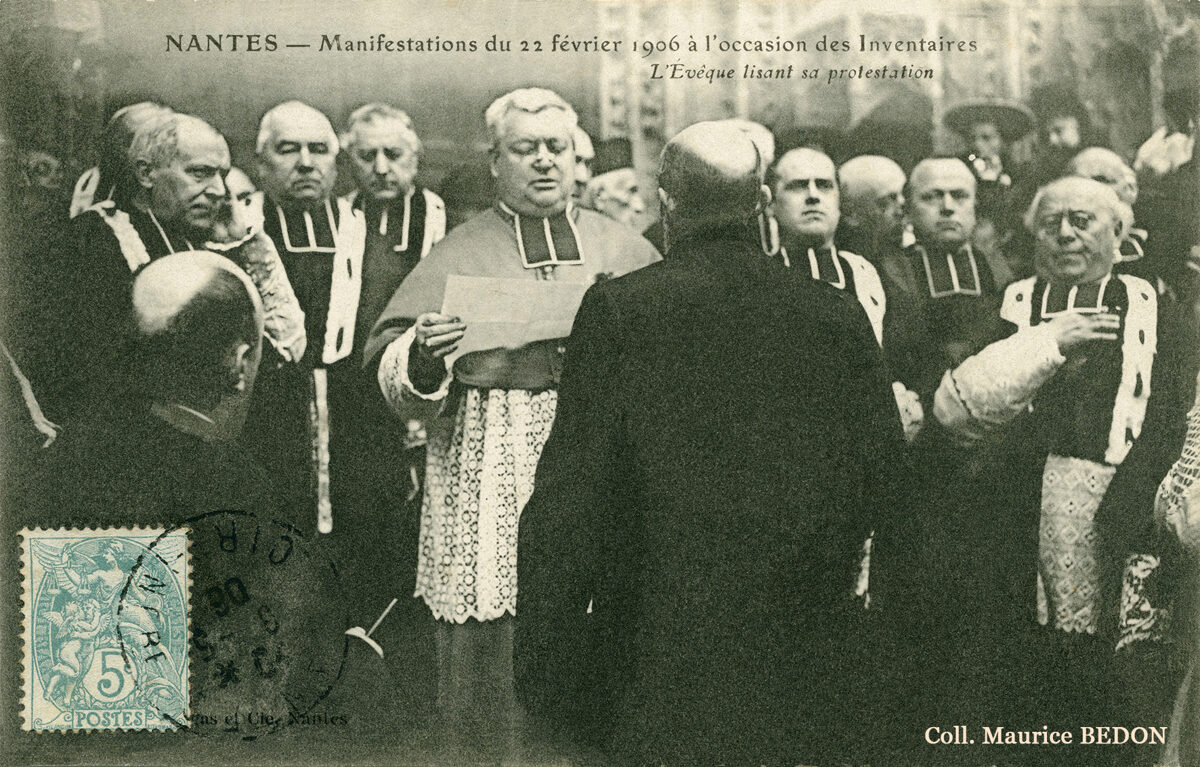 L’évêque de Nantes lit sa
protestation à l’Inspecteur de l’enregistrement.
L’évêque de Nantes lit sa
protestation à l’Inspecteur de l’enregistrement.
Les émeutes les plus violentes vont avoir lieu dans les régions profondément catholiques : dans les Flandres, le Massif Central, le pays Basque, la Savoie, en Normandie, en Bretagne, en Anjou et en Vendée. Pour y faire face, les préfets feront escorter les fonctionnaires du fisc par les gendarmes et seront même obligés de faire donner la troupe. De nombreux officiers préféreront alors démissionner plutôt que de se prêter à ce genre de besogne.
Le premier incident violent a lieu le 27 février 1906 à la chapelle de Champels dans la commune de Monistrol en Haute-Loire et fait 4 blessés. Quelques jours plus tard, le 3 mars à Montregard dans le même département, il y a un blessé très sérieux. Mais le problème le plus grave se déroule le 6 mars 1906 devant l’église Saint Martin à Boeschepe dans le Nord. Il fait un mort, Gery Ghysel, boucher âgé de 35 ans et père de 3 enfants.
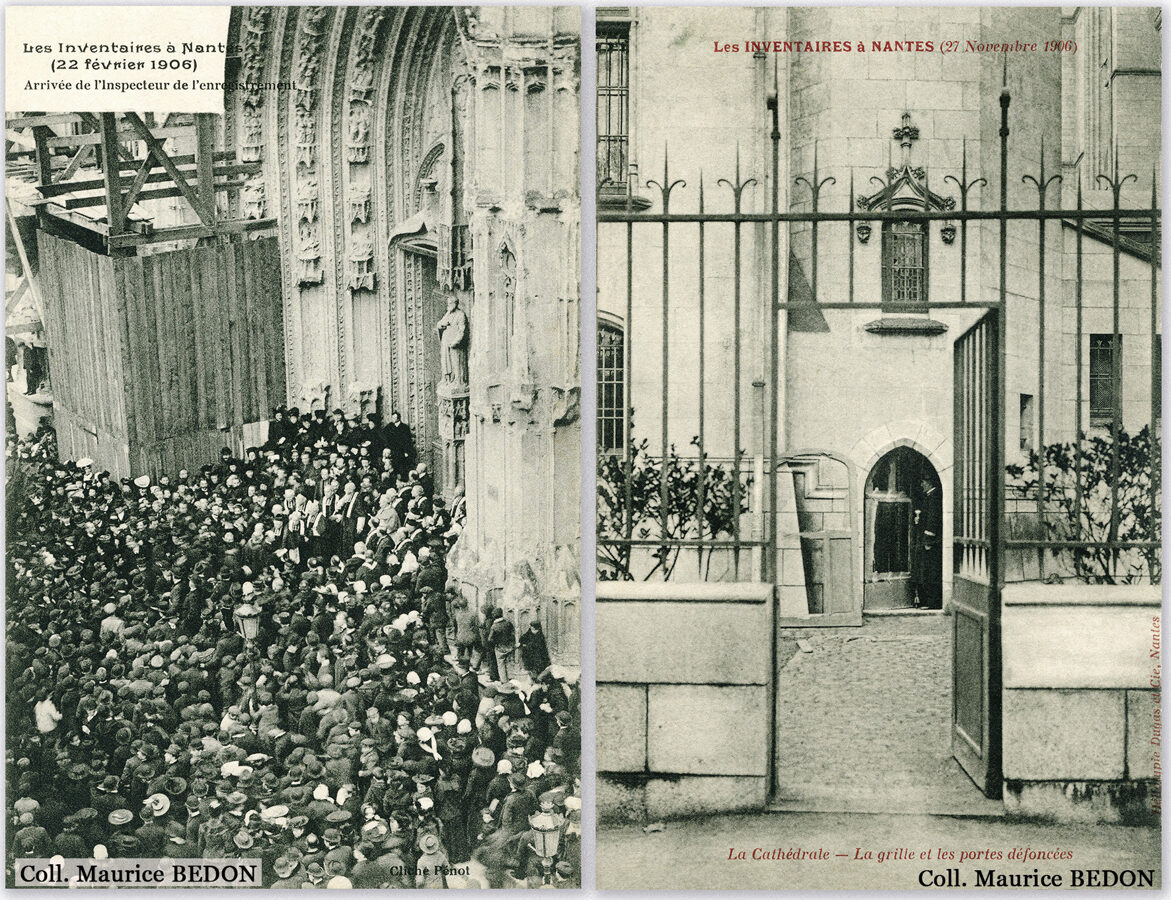 Cathédrale de Nantes.
A gauche : une
foule des manifestants entoure l’évêque.
Cathédrale de Nantes.
A gauche : une
foule des manifestants entoure l’évêque.A droite : le portail de la sacristie fracturé après l’Inventaire.
Le lendemain 7 mars, l’Assemblée nationale renverse le gouvernement de Maurice Rouvier. A l’issue de la crise ministérielle, un nouveau gouvernement est formé le 14 mars par Ferdinand Sarrien, avec comme ministre de l’Intérieur Georges Clemenceau. Ce dernier déclare à la chambre des députés : « la question de savoir si on comptera ou ne comptera pas des chandeliers dans une église ne vaut pas une vie humaine ».
Les Inventaires sont suspendus dans les endroits où ils se heurtent à une forte opposition. Ils seront repris avec plus de discrétion quelques mois plus tard. Toutefois, pour pénétrer dans les églises barricadées, on n’hésitera pas à en fracturer les portes (d’où le surnom de « gouvernement de crocheteurs » donné par l’opposition).
Ainsi, le pouvoir politique avait tenu à donner l’impression que force restait à la Loi. Toutefois les documents produits n’étaient, dans tous les domaines, d’aucun intérêt (incomplets, imprécis, et inexacts). En voici un exemple en Vendée, à Saint-Vincent-Sterlanges : le célèbre reliquaire en bois doré du XVIIème siècle a été inventorié comme « reliquaire en cuivre du XIVème ». Autre exemple dans le même département, dans la commune de Chavagnes-en-Paillers, où les habitants étaient tous solidaires, l’inspecteur n’a pas inventorié grand-chose à part les bancs, les objets intéressants étaient tous cachés dans les maisons voisines.
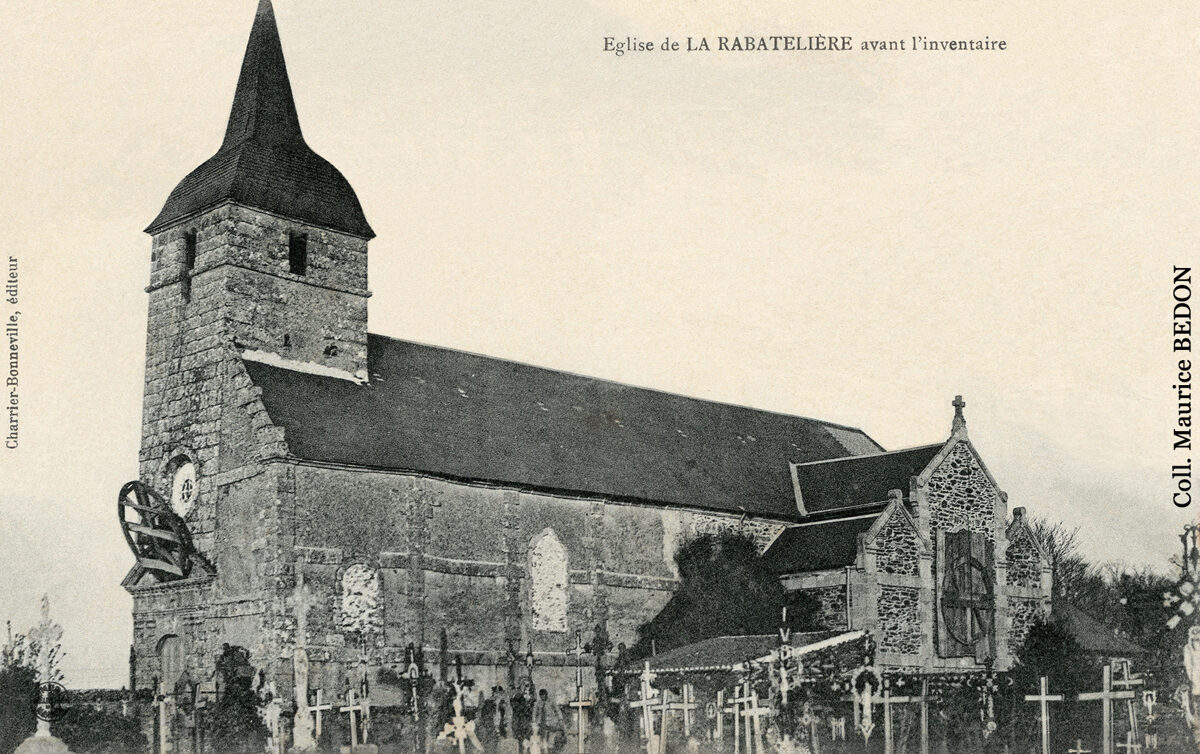 L’église de La Rabatelière
barricadée avant l’Inventaire.
L’église de La Rabatelière
barricadée avant l’Inventaire.
En Vendée, les opérations d’Inventaire ont débuté le 20 janvier 1906. Des manifestations hostiles de plus ou moins d’importance ont eu lieu dans la plupart des paroisses, mais le souvenir en a été conservé dans celles qui ont fait l’objet de reportages photographiques. Ce sont ces derniers que nous allons vous présenter maintenant.
Les fidèles ont commencé par se barricader en obstruant les portes, dressant des barricades de bois ou de chaises, créant des obstacles. La photo ci-dessus nous en montre un bon exemple à La Rabatelière où les paroissiens ont muré les vitraux et posé une roue de charrette destinée à tomber sur les « voleurs ».
 Les manifestants devant
l’église de Chambretaud.
Les manifestants devant
l’église de Chambretaud.
Comme précédemment à Nantes, l’Abbé Brébion curé de Chambretaud lit sa protestation à l’agent du fisc, au milieu d’une foule de manifestants, le 1er mars 1906. Découragées cette fois-ci, les autorités sont revenues 8 mois plus tard avec un groupe de gendarmes pour contenir la foule le 21 novembre de la même année et ont ainsi pu procéder à l’Inventaire.
 Les gendarmes ont pris place
devant l’église de Chambretaud.
Les gendarmes ont pris place
devant l’église de Chambretaud.
A la Verrie, commune proche de la précédente, l’affaire a été plus importante, puisque les gendarmes et deux compagnies de soldats d’infanterie commandés par un capitaine ont été mobilisés. A. Hisson, photographe à Mortagne-sur-Sèvre, a d’ailleurs édité plusieurs séries de cartes postales sur cet évènement (pas classées chronologiquement). Celle reproduite ci-dessous porte le numéro 8. On notera que pour ces clichés, les personnes présentes ont pris la pose et que l’auteur fait preuve d’humour dans ses commentaires : « foule sympathique » ou bien « paisiblement ».
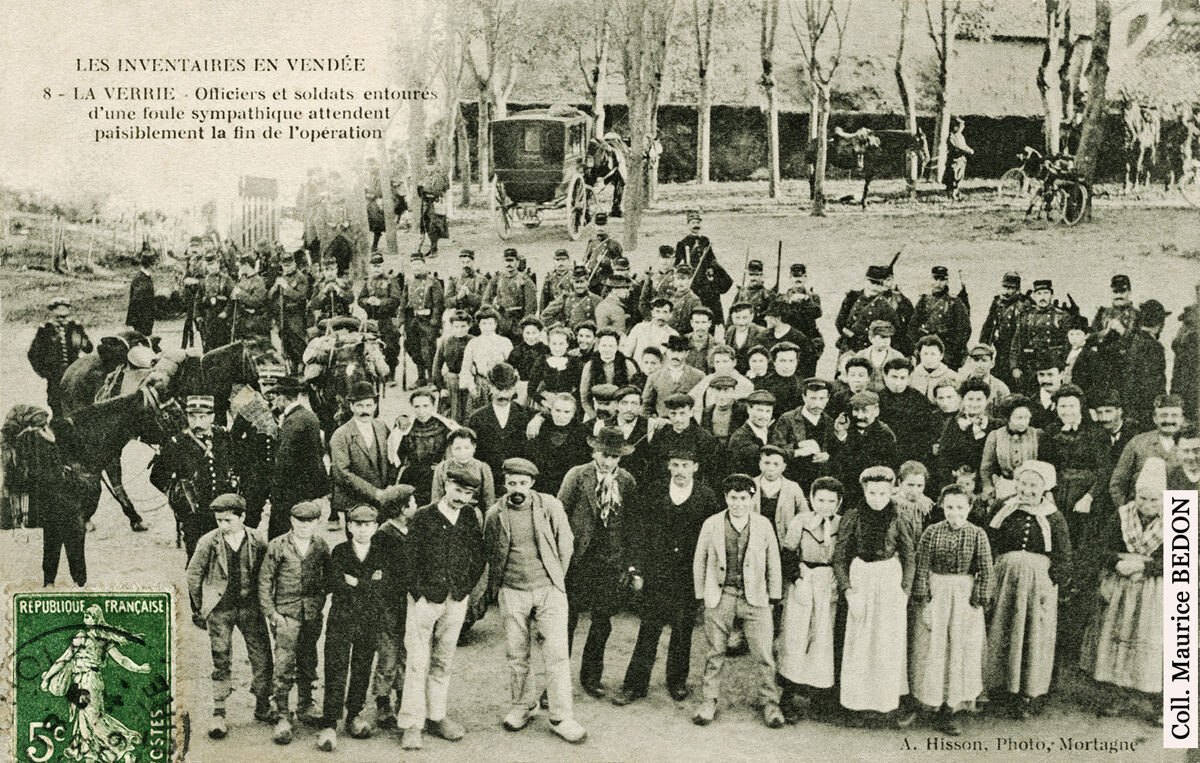 Les manifestants sur la
place de La Verrie.
Les manifestants sur la
place de La Verrie.
Cette deuxième carte postale, qui porte le numéro 4 dans la même série, montre la troupe ayant pris position sur la place. Ici aussi, curieusement les soldats, comme les personnes présentes, ne sont pas en action mais prennent soin de faire face au photographe.
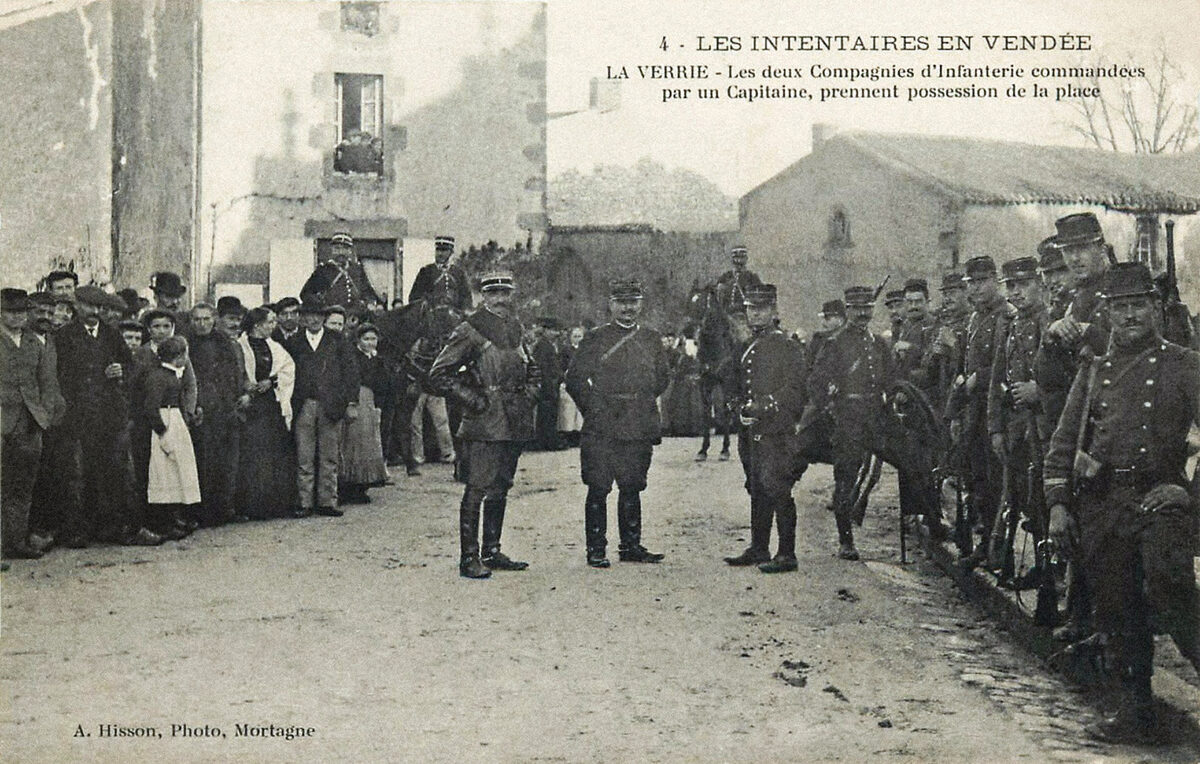 Les soldats devant l’église
de La Verrie.
Les soldats devant l’église
de La Verrie.
Encore plus bizarrement, cette scène d’action semble elle aussi posée. C’est le moment où les autorités ont requis du personnel pour forcer la porte de la sacristie de l’église de La Verrie. Cette carte, réalisée aussi par le photographe Hisson de Mortagne-sur-Sèvre, mais non numérotée, n’appartient pas à la même série que les deux précédentes.
 La porte de la sacristie de La Verrie
fracturée.
La porte de la sacristie de La Verrie
fracturée.
Le 15 février 1906, c’est dans la commune de la Pommeraie-sur-Sèvre au Nord-Est du département que se déroulent les inventaires. Cette fois-ci, dès la première tentative, les forces de l’ordre ont été déployées. On les voit ici contenir les manifestants sur la place au sud de l’église Saint Martin.
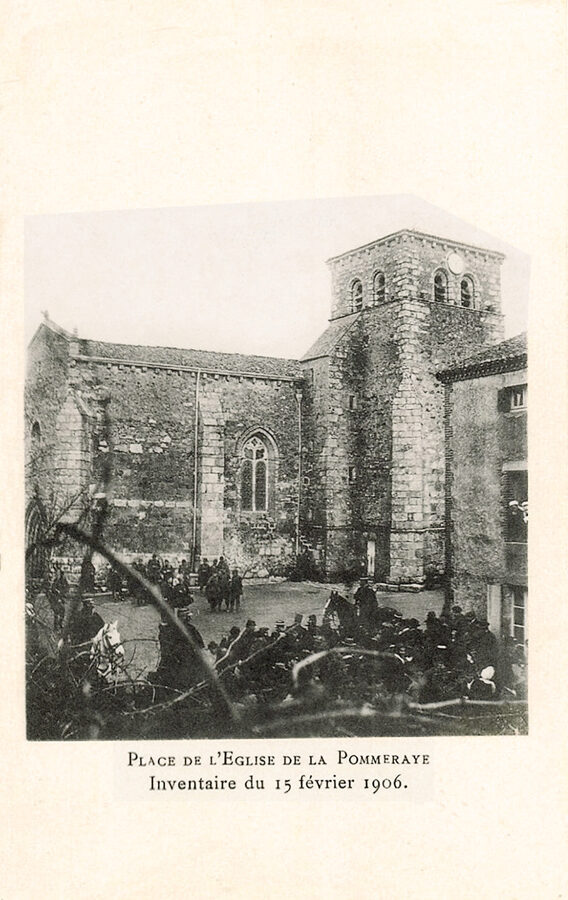 La place de La Pommeraie
pendant l’Inventaire.
La place de La Pommeraie
pendant l’Inventaire.
Pour la photo, les soldats se sont placés de façon à faire la haie et montrer au fond la porte principale de l’église défoncée pour permettre le passage des agents du fisc. On devine par le trou pratiqué les barricades un peu symboliques, réalisées avec des chaises.
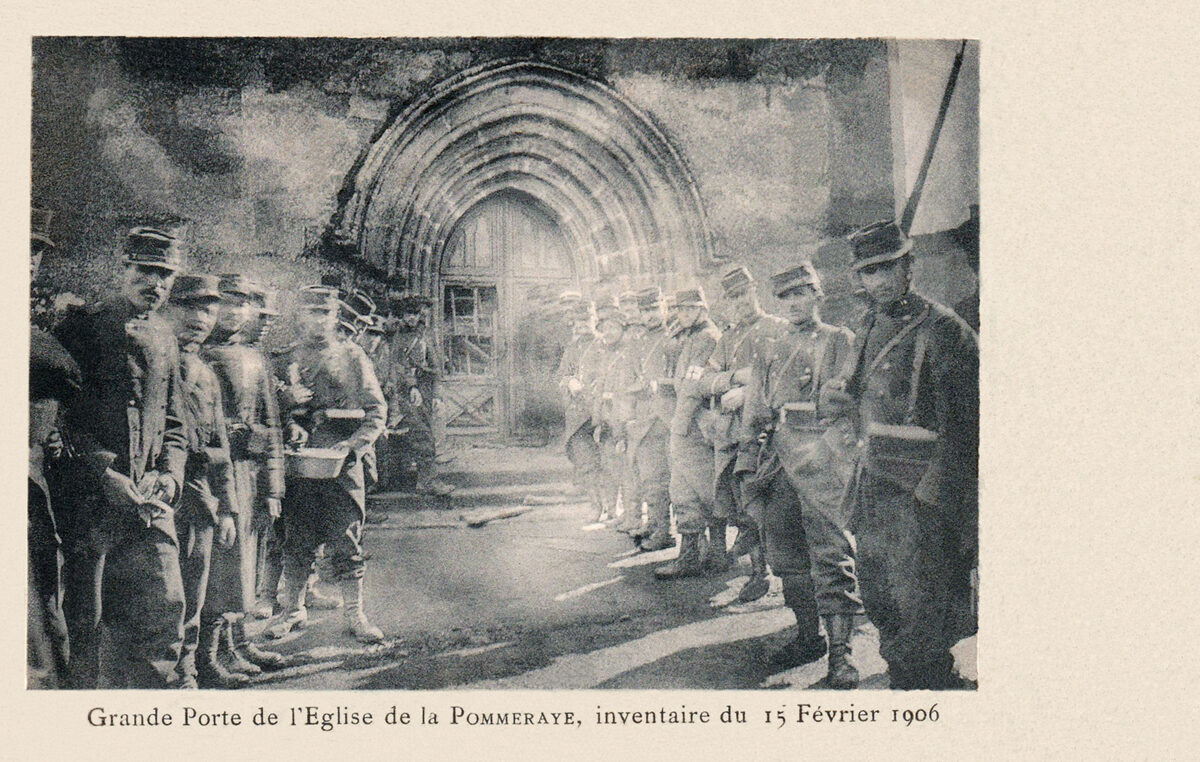 La porte de l’église de La Pommeraie défoncée
après l’Inventaire.
La porte de l’église de La Pommeraie défoncée
après l’Inventaire.
De la même manière, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, les Inventaires provoquent le regroupement de nombreux manifestants. Lors de la première tentative, ils entourent les autorités civiles et le curé. Il s’agit là d’une photo carte appartenant à une série réalisée par le photographe local, Abel de Saint-Laurent-sur-Sèvre.
 Les manifestants regroupés à
Saint Laurent-sur-Sèvre.
Les manifestants regroupés à
Saint Laurent-sur-Sèvre.
A la Boissière-de-Montaigu, la porte principale de l’église Notre-Dame de l’Assomption a été complètement défoncée dès le 7 mars 1906 au début de la période des Inventaires. La carte a été réalisée pour la circonstance par un photographe inconnu localement Cormerais peut être pour une diffusion régionale.
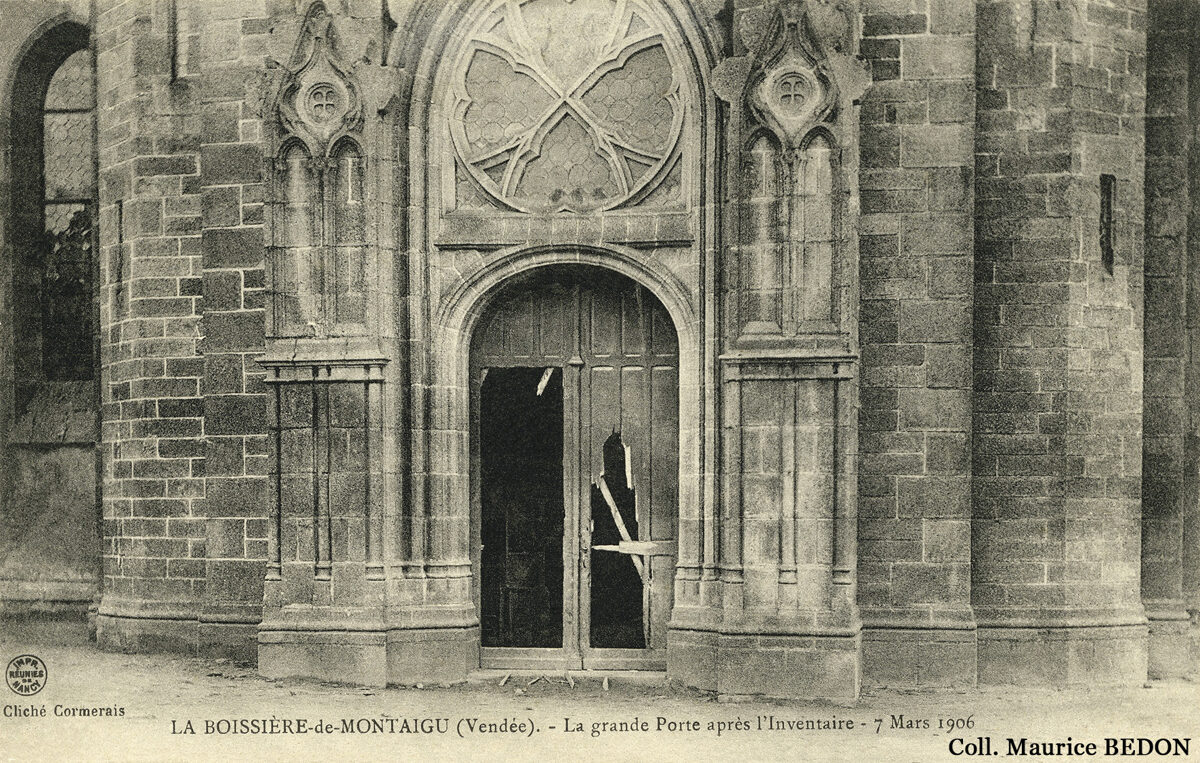 La porte de l’église de la
Boissière défoncée.
La porte de l’église de la
Boissière défoncée.
Dans cette même commune, une fête est organisée sur la place, avec un feu de joie, pour célébrer la libération des prisonniers arrêtés à l’occasion des manifestations d’opposition aux Inventaires. La légende de la carte nous indique quatre dates : les 2, 3, 7 et 22 mars 1906. Il s’agit peut-être des dates précises de différentes arrestations de manifestants. On remarquera sur la gauche la présence du clergé en vêtements liturgiques.
 La fête à La Boissière après
les Inventaires.
La fête à La Boissière après
les Inventaires.
Cette carte postale nous montre une manifestation « sympathique », vraisemblablement de soutien, qui voit des gens défiler à pied et en charrette à cheval le soir devant le presbytère de Mortagne-sur-Sèvre dans le cadre de l’affaire des Inventaires. La légende fait référence à un incident particulier qui aujourd’hui ne nous est pas connu. Peut-être s’agissait il d’un appel téléphonique des autorités qui n’avait pu aboutir parce que la liaison était mauvaise ou avait été volontairement interrompue ?
 Une manifestation à
Mortagne-sur-Sèvre.
Une manifestation à
Mortagne-sur-Sèvre.
Comme viennent de nous le démontrer les cartes postales, les Inventaires ont entraîné des manifestations surtout au quart Nord-Est du département de la Vendée dans les communes les plus catholiques ; mais pas seulement. En effet, à Venansault, au centre du département, près de la Roche-sur-Yon, les choses ne se sont pas passées facilement. La photo ci-dessous nous montre une barricade dressée avec des fagots de bois et des roues de charrette devant la façade de l’église.
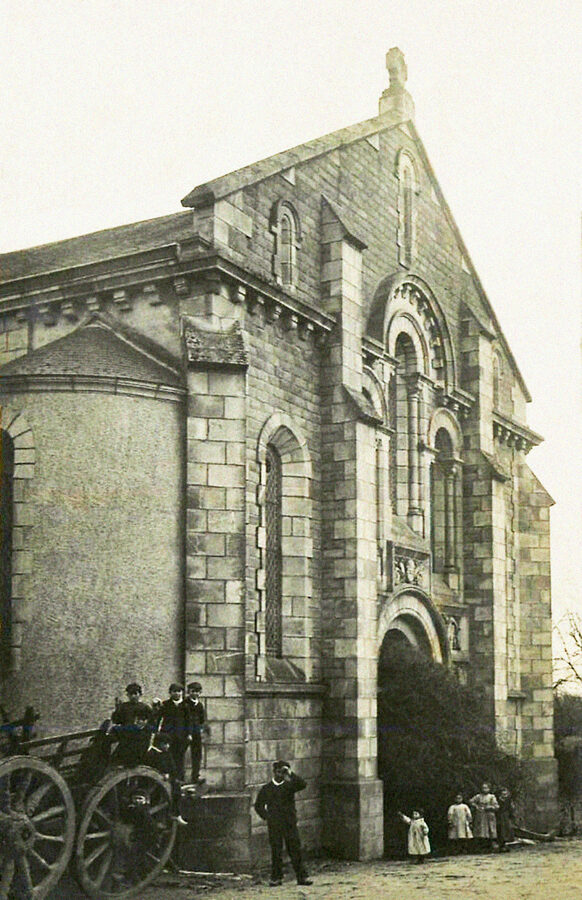 Les Inventaires à Venansault.
Les Inventaires à Venansault.
De la même manière à Olonne-sur-Mer, tout à l’Ouest de la Vendée, il y eut aussi des manifestations. Ce cliché, réalisé par le célèbre photographe Lucien Amiaud, nous montre le moment où le prêtre (reconnaissable à son rabat) dialogue avec les autorités (identifiables à leur chapeau melon) au milieu de la foule visiblement en train de chanter des cantiques.
A la Garnache, commune située au Nord-Ouest du département, le marquis de Baudry d’Asson, député de la Vendée, avec les paroissiens, s’est couché sur le sol devant l’église pour empêcher les autorités d’entrer.
 Les Inventaires à
Olonne-sur-Mer.
Les Inventaires à
Olonne-sur-Mer.
A Foussais-Payré, c'est-à-dire au Sud-Est du département, dans la zone de la Vendée dite républicaine, les soldats de la troupe ont été là aussi appelés pour intervenir, comme nous le montre cette photo.
 Les Inventaires à Foussais.
Les Inventaires à Foussais.
S’il n’y eut pas de morts ou de blessés graves en Vendée lors des manifestations d’opposition aux Inventaires, des coups furent parfois échangés avec les soldats ou la maréchaussée. Les gendarmes de Palluau, par exemple, se plaignirent devant les tribunaux d'avoir été piqués aux fesses avec des épingles à chapeaux et même mordus. Les manifestantes mises en cause se défendirent en montrant qu’elles ne portaient jamais de chapeaux mais seulement des coiffes.
Chantonnay le 10 août 2023.

CHARLES JOUFFELOT, ÉDITEUR DE CARTES POSTALES
Charles, Émile, Célestin, Élie JOUFFELOT est né 21 août 1887 à Chantonnay en Vendée. Son père Célestin Jouffelot était coiffeur dans cette ville, rue Nationale, mais il n’appartenait sans doute pas à une famille locale. Il est né à Saint-Juire-Champgillon dans le canton voisin de Sainte-Hermine. En revanche sa mère Elisabeth Mallet, épicière rue de Bordeaux, appartenait à une famille de commerçants déjà présente à Chantonnay et dans le canton au moins depuis le XVIIIème siècle (elle est dite « sans profession » sur l’acte d’état civil, sans doute pendant la grossesse).
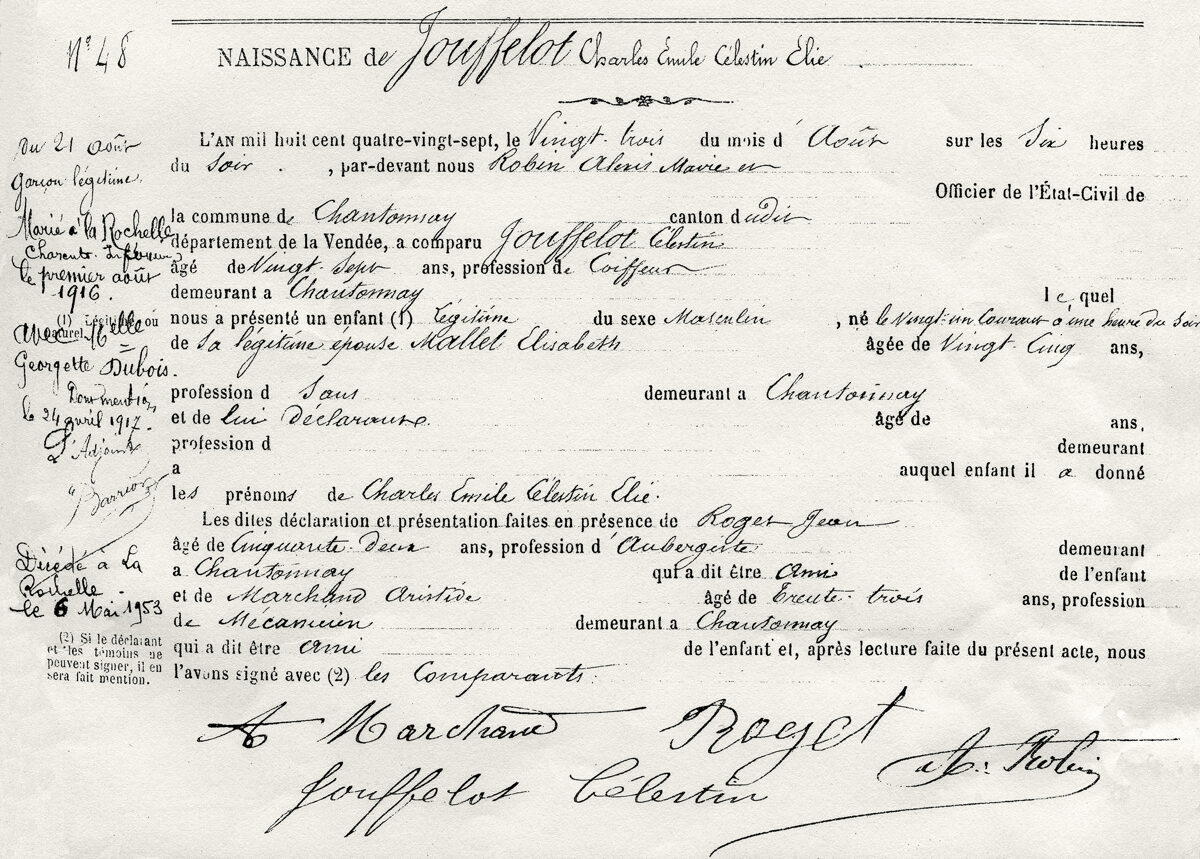 L’acte de naissance de Charles Jouffelot (archives départementales).
L’acte de naissance de Charles Jouffelot (archives départementales).
Il est tout d’abord devenu élève à l’école primaire publique de garçons, située place de la République, à 100 mètres environ de l’habitation de ses parents. Âgé de 11 ans en 1898, il entre alors à l’École Primaire Supérieure (E.P.S) établie dans le même groupe de bâtiments. Il y poursuivra ainsi ses études jusqu’en classe de troisième, à l’âge de 15 ans, c’est à dire en 1902.
Il restera très attaché à cet établissement. En effet, il lui a consacré plus tard, dès 1904, un véritable reportage photographique qui sera édité en sept cartes postales : l’entrée et les élèves, l’aile gauche, le bâtiment principal, l’aile droite, l’atelier de menuiserie, le préau gymnase, la fanfare (N° 1 bis à 7 bis), sans compter tous les clichés où on aperçoit des élèves de l’E.P.S en promenade (reconnaissables à leur uniforme). La plus connue de ces dernières est reproduite ci-dessous ; on y retrouve alignés en V le personnel et les élèves de l’Établissement. Ces cartes constituent aujourd’hui un très riche témoignage sur la vie scolaire du début du XXème siècle.
 La façade de l’E.P.S, le personnel et les élèves en 1904
La façade de l’E.P.S, le personnel et les élèves en 1904
A la sortie de l’école, après le diplôme du Brevet, il a ensuite fait un apprentissage d’imprimeur pendant deux ans de 1902 à 1904. Nous ne savons pas exactement à quel endroit, mais nous serions tenté de penser que cela pouvait être dans la ville même de Chantonnay, chez Amédée Gaultier imprimeur.
En tous cas, c’est durant cette période qu’il a été initié à la photographie. Il réalise d’ailleurs ses premiers clichés dès la fin de l’année 1902 et ils seront édités en cartes postales à cette date, sous l’appellation : « Imprimerie Papeterie C. Jouffelot Chantonnay ». Quatre sont aujourd’hui connues des collectionneurs : la vue générale, la rue Nationale, le château de la Mouhée et le viaduc de l’Angle. La première est sans doute celle qui est reproduite ci-dessous, non numérotée et représentant une vue générale du bourg prise du haut de la rue Nationale. La correspondance figurant sur la carte ne laisse aucun doute quant à la datation (fin 1902). Ce qui, en réalité, place le jeune Charles Jouffelot, âgé de seulement 15 ans 1/2, dans la catégorie des photographes précurseurs (c’est à dire ceux travaillant avant décembre 1903).
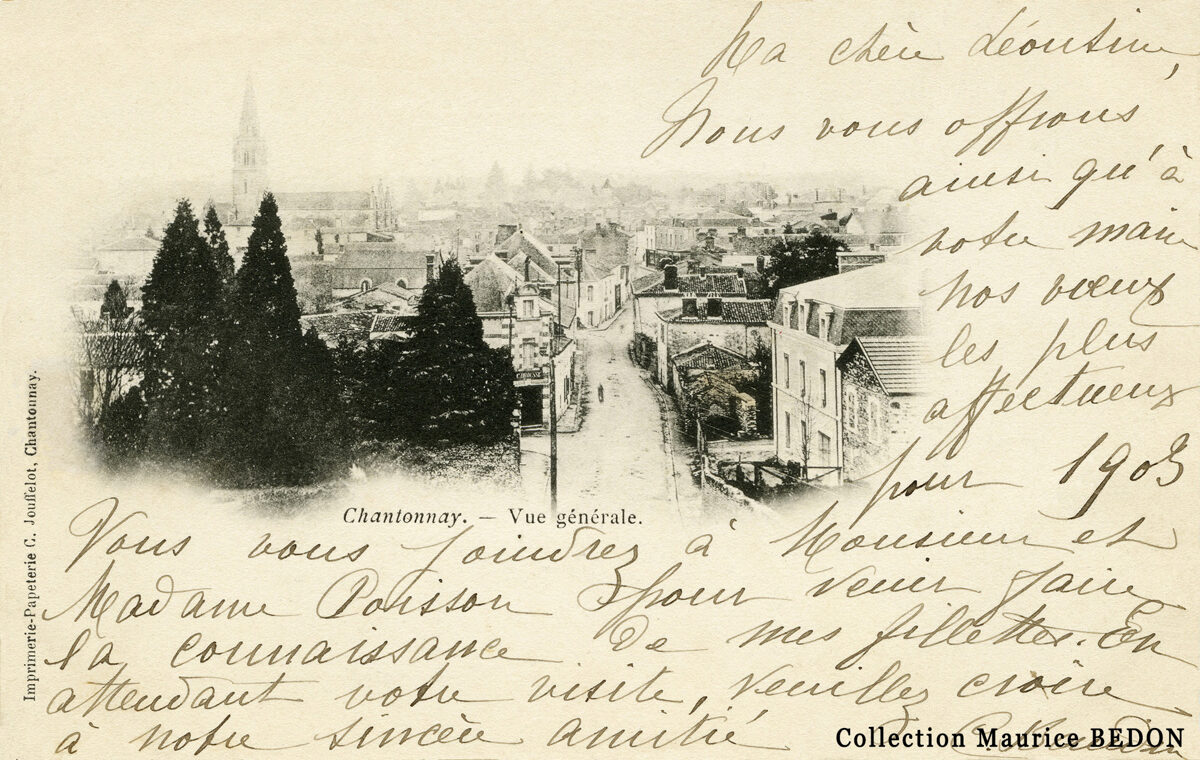 Vue générale par le nord du bourg en 1902.
Vue générale par le nord du bourg en 1902.
Après cet apprentissage, en 1904, alors qu’il est toujours mineur et âgé de 17 ans, il travaille comme imprimeur à son compte, sous le couvert officiel du magasin tenu par sa mère « Épicerie Librairie Papeterie Imprimerie Bazar » au N° 5 de la rue de Bordeaux (actuelle avenue Georges Clemenceau). En réalité, on aura compris qu’il le faisait déjà durant son apprentissage.
Il semblerait que nous soyons dans cette situation paradoxale où le fils ait désormais son père comme employé dans une entreprise n’existant que sous le couvert légal du magasin de sa mère. En tous cas, l’imprimerie est bien dans le nom de Charles, comme le prouve la facture publiée plus loin et établie le 31 mars 1907 pour Monsieur Oscar Robin, propriétaire du domaine situé en face du magasin (parc Clemenceau actuel).
Sous ce statut particulier, qui va durer jusqu’à ses 21 ans en 1908, il va réaliser la plus grande partie de ses cartes postales (numérotées jusqu’à 58) et les plus caractéristiques. Par manque de moyen de communication, il est obligé de se cantonner à Chantonnay et aux abords immédiats (Sainte-Cécile en particulier). Il s’intéresse principalement aux différents aspects de la vie journalière des habitants. En effet, il photographie beaucoup de scènes de la vie quotidienne : la foire à Chantonnay, les fours à chaux, les moulins, l’ancienne mine de charbon et les rues de la ville etc. Sa carte postale du lavoir de la rue Lafontaine à Chantonnay (cf. reproduction ci-après) est la plus expressive de toutes les autres représentant des lavoirs en Vendée et réalisées par ses collègues (CP N° 44).
 Vue du Lavoir de Chantonnay (aujourd’hui détruit).
Vue du Lavoir de Chantonnay (aujourd’hui détruit).
De la même manière, quand il photographie la place de la Mairie un jour de foire en 1906, la carte est du plus grand intérêt pour l’histoire locale (voir ci-dessous). On y distingue les halles (détruites en 1967), la mairie (incendiée en 1930), l’ancienne école (reconstruite en salle municipale en 1932), la maison Sachot (annexée à la mairie), la maison du vétérinaire Goudeau (reconstruite récemment pour le Crédit Mutuel), l’édifice des poids publics (datant de 1887 et remplacé par un nouveau sur la place de la République en 1930) etc. (CP N°27).
 La place de la Mairie et la foire.
La place de la Mairie et la foire.
Il photographie également avec la même qualité les évènements locaux importants. La carte reproduite ci-dessous, fait partie d’une série de deux, représentant l’impressionnant cortège lors de l’enterrement du Marquis Zénobe de Lespinay, Député-Maire de Chantonnay, Conseiller Général et Président de nombreuses associations le 6 juillet 1906. Le début du convoi funèbre, qui vient du château de la Mouhée, passe ici rue de Bordeaux juste devant le magasin Jouffelot.
 L’enterrement du marquis de Lespinay en 1906.
L’enterrement du marquis de Lespinay en 1906.
Parallèlement il entreprend de faire une série spéciale de cartes sur les rives du Grand Lay, avec les moulins, les passerelles, l’assemblée, le canotage etc. Il va aussi visiblement essayer de photographier tout ce qui peut présenter de l’intérêt dans la commune. Il réalise aussi des cartes postales de publicité commandées par des clients comme celle reproduite ci-dessous représentant le magasin Papon, situé à l’angle de la place de la mairie et de la rue Nationale. Ce bâtiment qui servait au début du siècle de clouterie et de coutellerie, a ensuite souvent changé d’affectation, épicerie, café. Il est actuellement, en cette fin d’année 2022, en cours de démolition pour faire place à un immeuble.
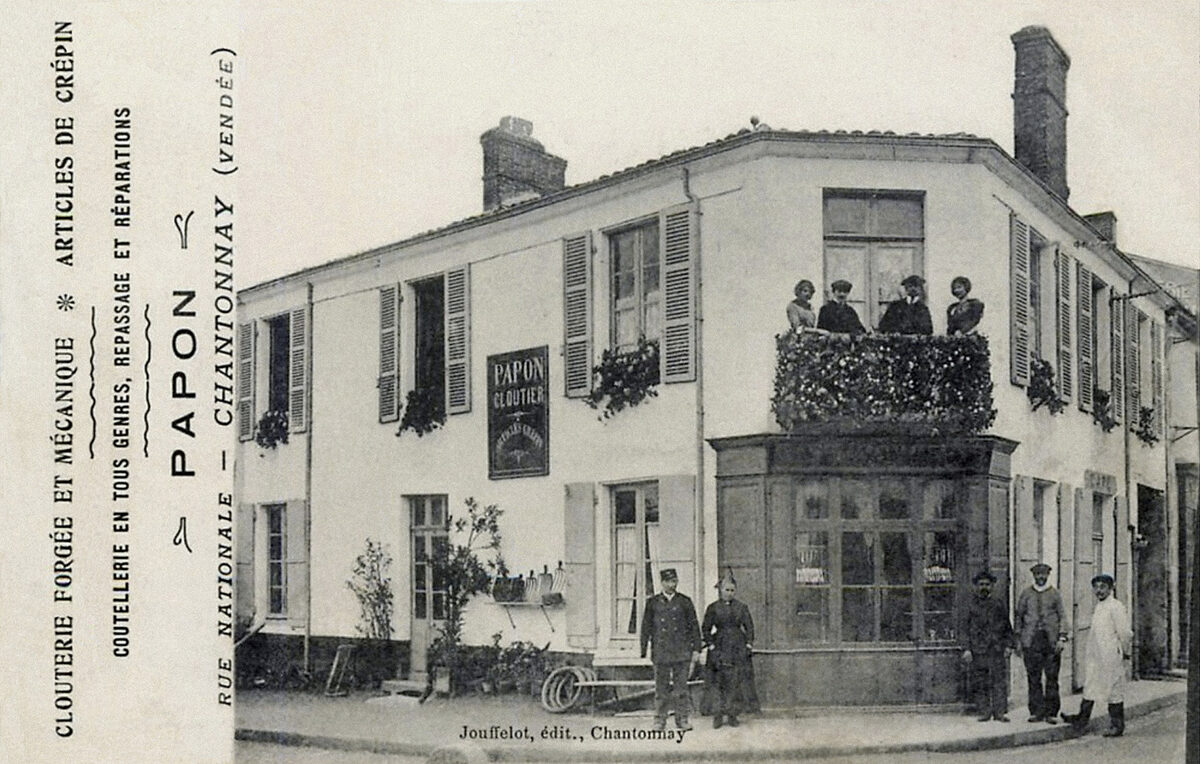 Le magasin Papon rue Nationale en 1906.
Le magasin Papon rue Nationale en 1906.
Ces cartes de publicité de magasin ou d’entreprise font aujourd’hui la joie des collectionneurs, car elles caractérisent bien leur époque. L’autre carte reproduite ci-dessous est également une carte de publicité, mais il l’a incluse dans sa numérotation générale (CP N° 58). D’autre part c’est la seule qui constitue une double vue. Elle représente le garage Chauveau, quand il était encore installé place des Champs-Élysées (actuelle place Jeanne d’Arc). Il sera au cours du XXème siècle déplacé avenue Georges Clemenceau, puis avenue de Lattre de Tassigny. Cette carte est aussi intéressante par les exemples de voitures d’époque qu’elle montre.
 Publicité pour le garage Chauveau.
Publicité pour le garage Chauveau.
L’année 1908 va marquer la fin de cette association avec sa mère, parce que Charles Jouffelot doit partir faire son service militaire. Et durant cette période de menace de conflit mondial, le service est de deux ans, en plus des périodes militaires successives. Il est donc incorporé le 6 octobre 1908 au 1er bataillon de chasseurs à pied à Épernay dans la Marne, puis finalement affecté au 137ème régiment d’infanterie de Fontenay-le-Comte, dont il sera libéré le 25 septembre 1910.
Ces deux longues années d’absence, dans la période la plus importante, vont fortement compromettre sa carrière d’éditeur de cartes postales. Ses concurrents auront eu le temps de couvrir l’essentiel de la clientèle de Chantonnay, comme Eugène Poupin de Mortagne-sur-Sèvre, Paul Dugleux de la Roche-sur-Yon ou Armand Robin de Fontenay-le-Comte.
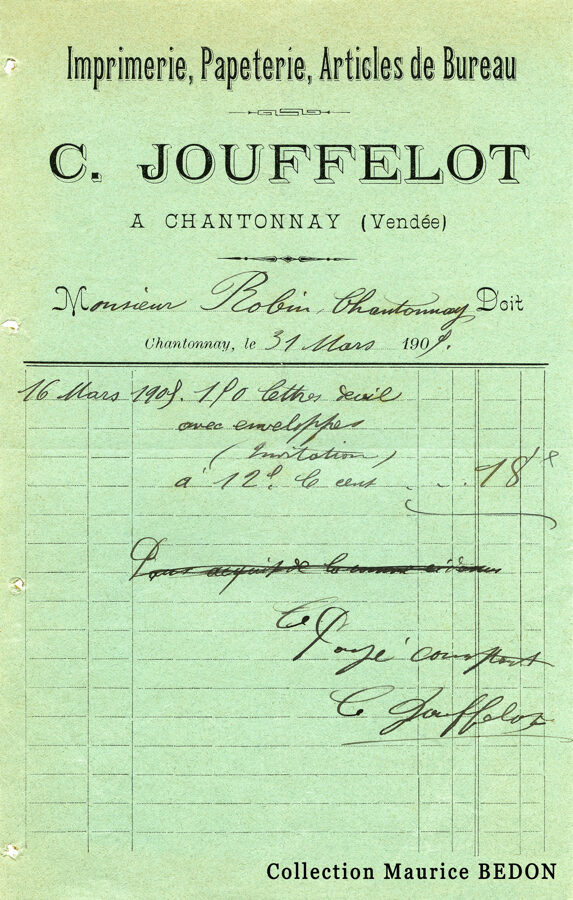 Une facture faite par C. Jouffelot en 1907.
Une facture faite par C. Jouffelot en 1907.
En 1910, au retour du service militaire, il est âgé de 23 ans et donc majeur ; il installe alors un studio et un magasin de photographe dans la maison contiguë au magasin de sa mère, au N° 3 de la rue de Bordeaux. Bien qu’ayant évidemment changé plusieurs fois d’affectation, ces deux bâtiments sont encore visibles aujourd’hui aux numéros 3 et 5 de l’avenue Clemenceau (cf. ci-dessous). Pendant cette période de sa vie, il va faire essentiellement de la photo et beaucoup moins d’imprimerie. Quant aux cartes postales, il manque toujours de moyen de communication pour pouvoir élargir son périmètre autour de Chantonnay.
 Vue actuelle (2012) des 3 et 5 avenue Clemenceau à Chantonnay.
Vue actuelle (2012) des 3 et 5 avenue Clemenceau à Chantonnay.
Il continue néanmoins à éditer des cartes postales, mais celles-ci sont surtout consacrées à des sujets ponctuels. Il publie en cartes, des photos qu’il prend lors des fêtes locales à Chantonnay bien sûr, mais aussi à Saint-Philbert-du-Pont-Charrault et même à La Jaudonnière. Dans le même esprit, à cette époque, il fait partie de « l’Association de la rue de Bordeaux », qui est en concurrence avec les associations de la rue Nationale et celle de la « République Libre des Quatre Routes ». Et ces trois dernières animent la ville par des fêtes qui essayent de rivaliser en importance et en fréquentation. Charles Jouffelot réalise à l’occasion de la cavalcade de la mi-carême du 2 mars 1913 une série spéciale de 15 cartes toutes très recherchées. Celle qui est reproduite ci-dessous (N°2) représente le char de l’Horticulture, attendant dans la cour arrière de son propre immeuble rue de Bordeaux.
 Un char lors de la mi-carême de 1913.
Un char lors de la mi-carême de 1913.
Tous les clichés qu’il prend de sites, de monuments ou d’évènements ne sont pas forcément édités en cartes postales. Certains sont vendus en grand format sur des cartons. Pour produire ces cartes postales, ce sont des clichés identiques qui sont utilisés en contretypie. La photo reproduite ci-dessous représente la cour intérieure du moulin du Gué à Sainte-Cécile. Il a préféré un autre cliché plus animé pour réaliser sa carte postale du lieu, portant le numéro 18.
 Une photo du moulin du Gué à Sainte Cécile.
Une photo du moulin du Gué à Sainte Cécile.
Malheureusement, quatre années plus tard, sa carrière photographique va être de nouveau interrompue le 2 août 1914 par le début de la Première Guerre mondiale et cette fois-ci pour plus longtemps. Âgé de 27 ans, il est évidemment mobilisé et dès 4 août au 137ème régiment d’infanterie de Fontenay-le-Comte. Au cours de l’année 1914, ce dernier combat successivement en Belgique, puis à la Bataille de la Marne et dans la Somme. En fin d’année, il bénéficie d’une courte permission et il la met à profit pour aller faire un reportage d’au moins dix-sept photos et cartes postales (cf. ci-dessous) sur l’hôpital militaire temporaire bénévole N°30 Bis installé au château de la Mouhée à Chantonnay, chez la marquise de Lespinay.
 Les blessés de l’Hôpital devant le château en 1914.
Les blessés de l’Hôpital devant le château en 1914.
Le 18 janvier 1915, il est muté avec d’autres soldats au 87ème régiment d’infanterie parce que ce dernier a subi de très lourdes pertes l’année précédente. Toutefois, le 21 juin de la même année, malade, il combat dans les Vosges et est évacué vers l’ambulance de Rebeuville puis l’hôpital de Vittel pour « grande fatigue générale ». De là, il passe ensuite le 9 août à l’hôpital de Lyon. Deux jours plus tard, le 11 août, il est autorisé à partir en convalescence dans son foyer. Pendant cette période il fera quelques photographies en studio, en particulier pour des soldats en permission avec leurs familles (dont celle des grands-parents de l’auteur).
Il rejoint le front le 5 février 1916, mais malheureusement quelques jours plus tard le 28 février il doit de nouveau être évacué et cette fois-ci pour une « bronchite paludéenne ». Il entre alors à l’hôpital municipal de Lyon.
Durant cette période il a dû avoir l’autorisation de s’absenter, puisqu’il se marie à La Rochelle en Charente-Maritime avec Georgette Dubois, le 1er août 1916.
Retourné à l’hôpital municipal de Lyon, il est transféré le 29 août au dépôt des convalescents dans la même ville. Il en sort le 2 septembre et part en convalescence pour deux mois. Après cela, il rejoint le dépôt le 2 novembre et est reconnu comme inapte au service pendant 20 jours pour cause de « bronchite suspecte ».
 Photo Jouffelot de la chapelle de la Mouhée en 1914.
Photo Jouffelot de la chapelle de la Mouhée en 1914.
Il passe ensuite au 93ème régiment d’infanterie le 6 mars 1917 et sert comme ordonnance du Général commandant la 111ème région aux armées. Blessé en service commandé le 20 mai 1918, il est évacué vers l’intérieur par convoi sanitaire et conduit à l’entrepôt d’Autun. Il en sort le 3 juillet et part de nouveau pour un mois de convalescence.
Il est alors envoyé à l’hôpital mixte de La Roche-sur-Yon pour « dyspepsie ». De là, il est conduit à l’hôpital de Nantes le 18 août, puis à l’hôpital militaire de la même ville et est de retour à celui de La Roche-sur-Yon le 29 août. A cet endroit, il est proposé à la commission de réforme pour « troubles dyspepsiques à l’estomac et entérocolite chronique imputable ». La commission le maintiendra dans le service actif avec une invalidité de moins de 10%. Toutefois, il sort de l’hôpital le 13 novembre 1918 et à cette date, la guerre est terminée.
Il restera ensuite considéré comme « sans affectation » et ne sera libéré définitivement de toutes obligations militaires qu’en 1936.
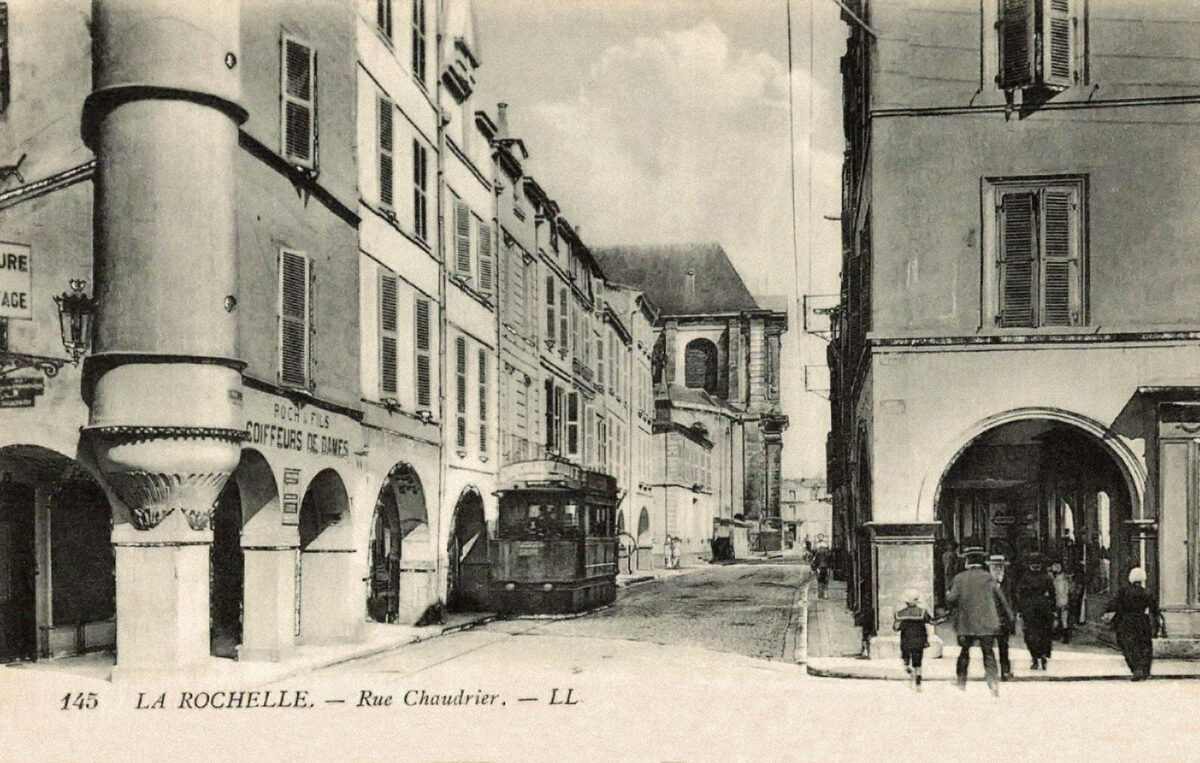 Les arcades de la rue Chaudrier à La Rochelle.
Les arcades de la rue Chaudrier à La Rochelle.
Comme il s’est marié à La Rochelle, il va aller habiter dans cette ville en 1919 et abandonner Chantonnay. Il y ouvre d’abord un studio de photos, mais comme à La Rochelle le marché des cartes postales est largement dominé par les Établissement Bergevin, il va changer de métier. Il ouvre alors vers 1920 un magasin de maroquinerie et d’articles de voyage « Les Nouveautés Parisiennes » à l’angle des rues Chaudrier et de Bazoges, tout près de la Cathédrale. Il meurt dans cette ville le 6 mai 1953 à l’âge de 65 ans.
Chantonnay le 10 décembre 2022.
LES 300 ANS DE LA GENDARMERIE A CHANTONNAY (VENDÉE)

Cet événement historique significatif a fait l’objet, fort à propos, d’une cérémonie de commémoration à Chantonnay. Et la presse s’en est fait l’écho dans un article paru sur le journal hebdomadaire Ouest-France du lundi 11 juillet 2022.
Malheureusement, sans doute par manque d’informations, l’historique qui y était retracé comportait quelques confusions. Par exemple, les gendarmes n’avaient pas pu s’installer rue Nationale en 1720 puisque cette voie a été créée seulement vers 1750.
Par conséquent, il nous a semblé opportun, pour une information historique de nos concitoyens, de préciser ces différents éléments dans le présent article paraissant sur le Blog de « La Chouette de Vendée ».
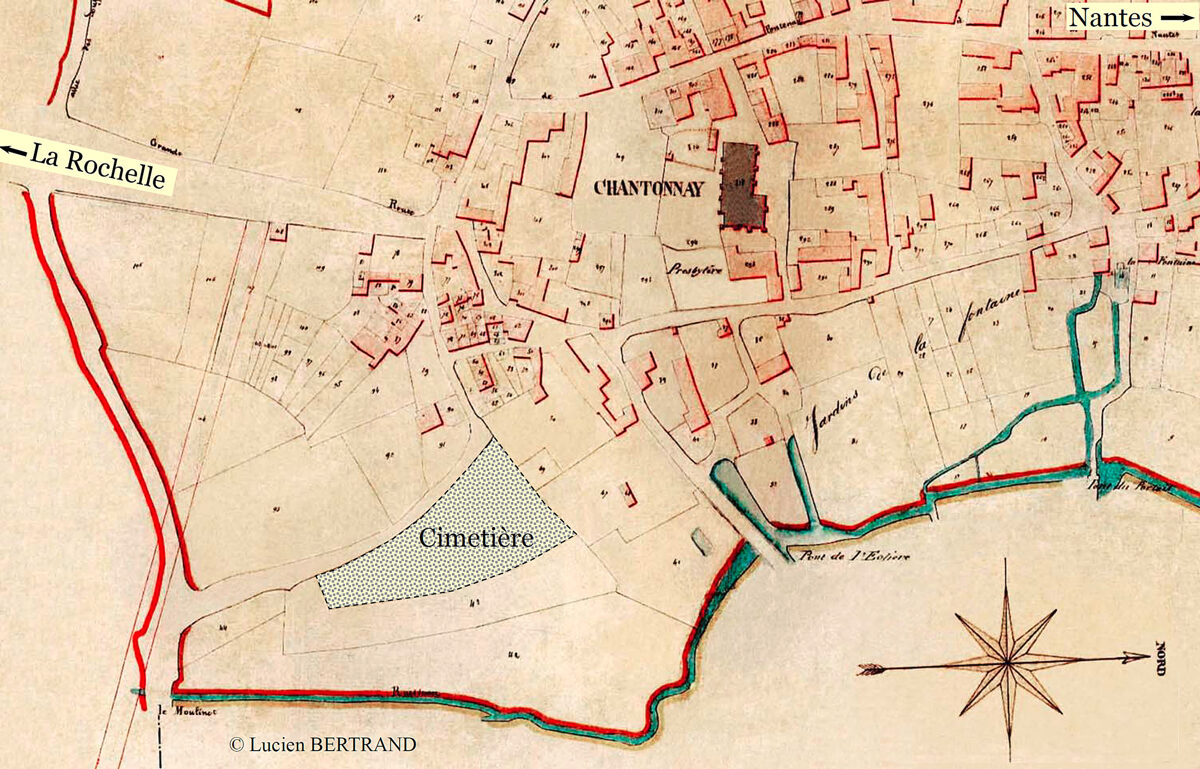 Premier plan cadastral de Chantonnay en 1824.
Premier plan cadastral de Chantonnay en 1824.
En 1720, les deux premiers gendarmes ont pu s’installer dans un immeuble presque contigu au portail d’entrée de l’église, que l’on aperçoit ci-dessus sur la reproduction du premier cadastre de la commune (établi en 1824). Dans ce bâtiment, s’entassaient alors : le corps de garde (Gendarmerie), la maison de sûreté (Prison) et l’école. Il s’y adjoindra la maison de ville (Mairie) après la Révolution et encore le Justice de Paix. Cette dernière fonction a été exercée de 1822 à 1830 par le célèbre officier des Guerres de Vendée Louis-Dominique Ussault de Din-Chin.
De plus, cet immeuble fortement endommagé par l’incendie allumé par les colonnes infernales en 1794, avait été réparé d’une façon assez sommaire. Dès 1817, il était considéré comme « en fort mauvais état » et les conseillers municipaux espéraient bien le faire restaurer aux frais du gouvernement.
Presque 20 ans plus tard, ils espéraient encore et sans plus de succès ! En 1836, il était qualifié de « fort incommode et dans un particulier état de vétusté ». L’école pour sa part avait quitté les lieux en 1838 pour s’installer à l’emplacement de l’hôtel de ville actuel. Les édiles locaux durent pourtant s’armer de beaucoup de patience pendant encore 20 ans supplémentaires.
En 1855, la paroisse envisageait alors de reconstruire en partie l’église, de l’agrandir et de lui ajouter une nef supplémentaire (celle du Sacré-Cœur). Cette fois-ci, c’était le comble, le fameux bâtiment allait en gêner la réalisation.
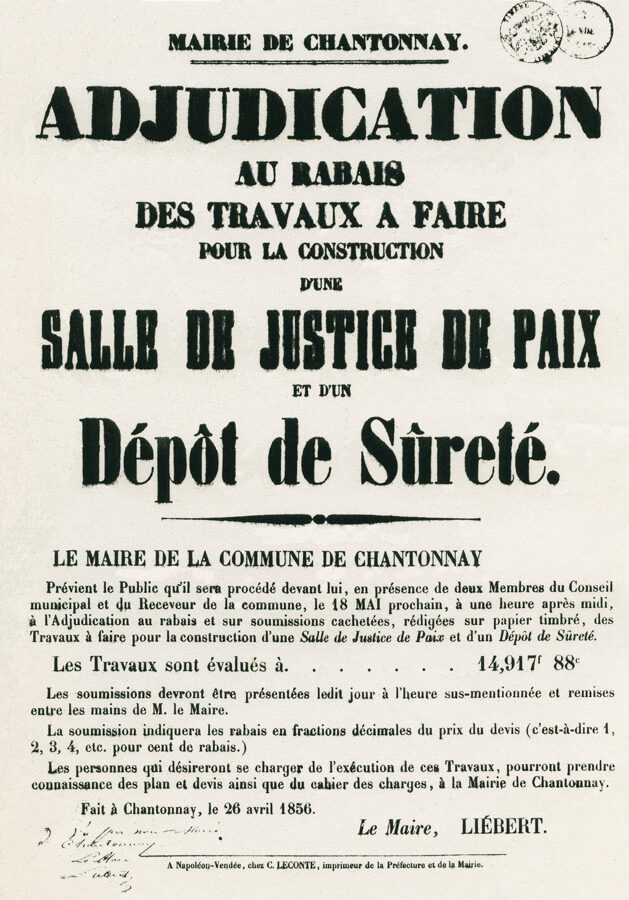 L’affiche d’adjudication de 1856.
L’affiche d’adjudication de 1856.
Aussi, par délibération du 9 février 1856, le Conseil Municipal décida finalement de se prendre en main et de construire à ses frais « un prétoire, une justice de paix et un dépôt de sûreté ». Le Maire Benjamin Liébert organisa le 18 mai 1856 une adjudication au rabais des travaux, estimés à 14 917,88 Francs.
Les nouveaux bâtiments furent implantés dans la partie basse (à l’Est) du nouveau champ de foire aux vaches, rebaptisé ensuite pompeusement « Les Champs Élysées », puis place Jeanne d’Arc. Ils comprenaient : la salle des pas perdus et la salle de la Justice de Paix dans le pavillon central avec le fronton et dans chacune des deux ailes un appartement pour un gendarme, les prisons dans l’aile de gauche (5 rue Victor Hugo) et une petite écurie dans la cour de droite.
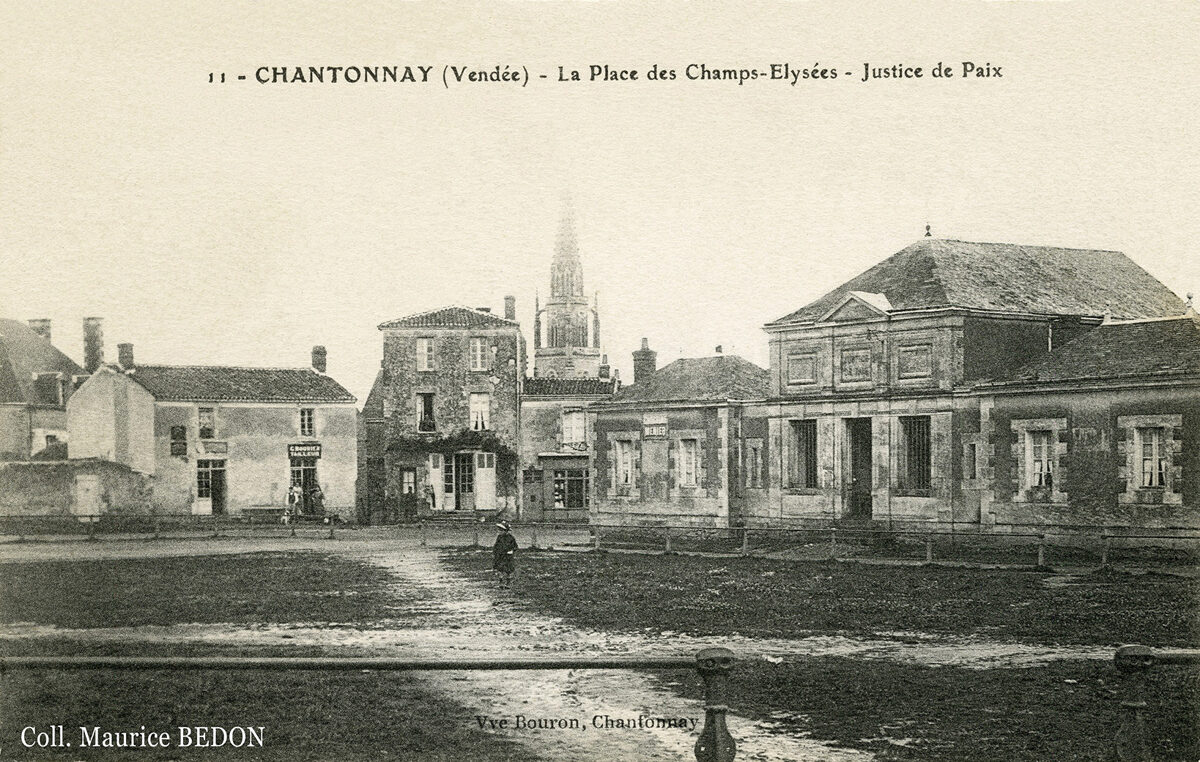
La Justice de Paix vers 1905.
Vers 1850, comme on vient de le voir, la Brigade de Gendarmerie de Chantonnay ne possédait que deux gendarmes. Aussi les locaux de la place Jeanne d’Arc apportèrent un confort inhabituel, qui changeait considérablement par rapport au siècle précédent.
Il nous reste une photo montrant le fonctionnement de la Justice à Chantonnay. Elle est un peu plus tardive (vers 1910) et a été prise dans le parc Clemenceau actuel (propriété alors d’Oscar Robin). On y reconnaît au premier rang, de gauche à droite : Charles Malthète huissier, Toussaint Guinaudeau assesseur, le Juge de paix, Oscar Robin assesseur et Fréderic Marais greffier ; au second rang Périclès Olivier assesseur, le Brigadier François Charbonnier et le Gendarme Charles Girard.

Les acteurs de la Justice à Chantonnay vers 1910.
Toutefois les choses allaient évoluer assez vite, car vers le début du Second Empire, les effectifs de la Gendarmerie à Chantonnay augmentèrent, peut-être du fait de l’accroissement de la population du canton de Chantonnay. Celle-ci, en effet, passa de 14 145 habitants en 1851 à 15 480 en 1881. Dès 1861, ils étaient déjà cinq gendarmes à Chantonnay. Il est à noter que les chefs-lieux de canton n’étaient pas les seuls à bénéficier d’une brigade de gendarmerie. Autour de Chantonnay, il y en avait aussi à Bournezeau, La Caillère, Mouilleron-en-Pareds et Mouchamps.
En tous cas, la Gendarmerie, pourtant installée à cet endroit depuis peu, pouvait difficilement rester place Jeanne d’Arc, puisqu’il n’y avait que deux logements. Au début, plusieurs gendarmes logèrent en dehors de la caserne. Il fallut tout de même trouver, en urgence, une maison assez vaste pour faire au moins cinq logements. C’est à ce moment là que les gendarmes s’installèrent à l’angle des rues Nationale et Travot (à l’emplacement de la pharmacie de la Poste). A cet emplacement on remarque encore un grand porche, fermé d’un portail clouté, qui permettait l’accès aux écuries. La date exacte de cette installation effective ne nous est pas connue exactement, on peut toutefois l’estimer probablement vers 1865.
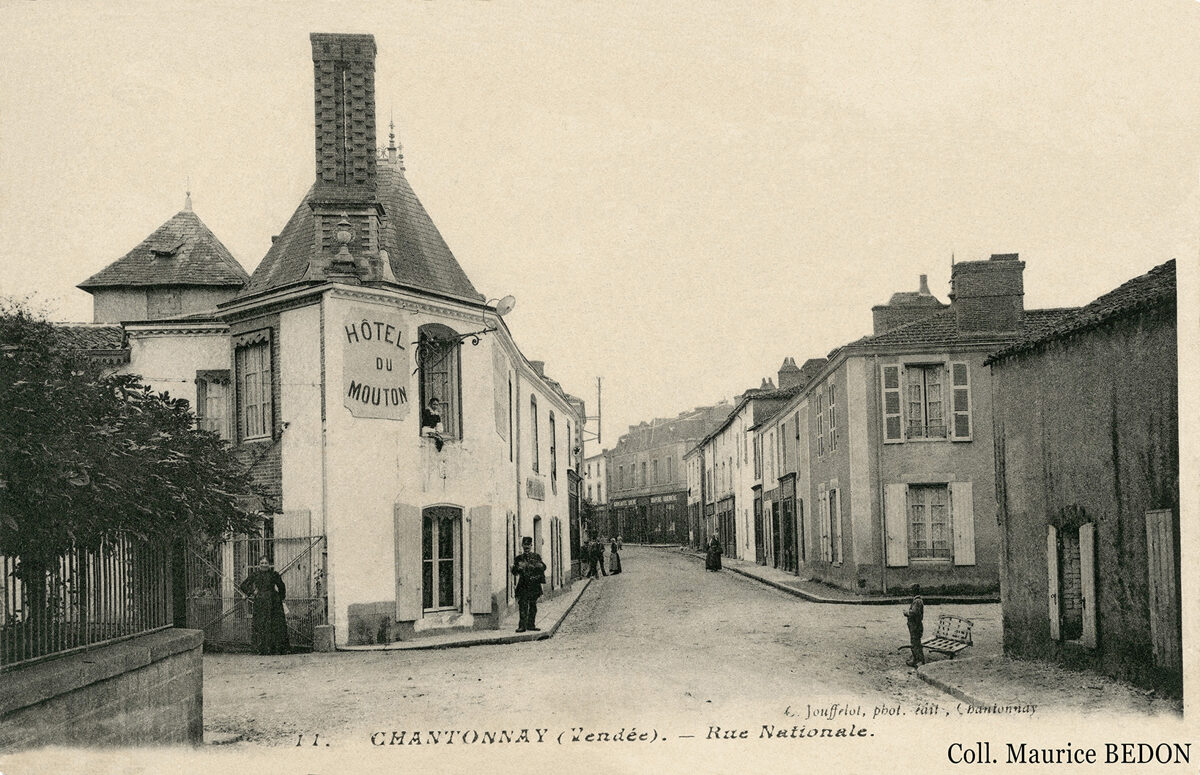
La gendarmerie (1865-1888) est visible au carrefour à droite (Carte postale de 1904).
De toute façon, cette installation dans une maison ordinaire à l’angle des rues Nationale et Travot a toujours été considérée comme provisoire, en attendant la construction d’une caserne. D’ailleurs, des problèmes ne vont pas tarder à apparaître. Les cellules étaient restées place Jeanne d’Arc et les logements prévus et délaissés par les gendarmes avaient été attribués à des employés municipaux. Aussi, le garde champêtre était chargé de surveiller et de nourrir les prisonniers. Seulement un vagabond réussit à prendre le dessus sur le garde champêtre et à l’enfermer à sa place dans sa cellule. Après une autre évasion du même genre, de nouvelles cellules furent alors aménagées rue Travot.
Au recensement de la population de 1881, il y avait cinq gendarmes (« à cheval ») rue nationale : Mariot (Maréchal des logis), Pageaud, Troussilh, Rivasseau et Lenicolais. Au recensement suivant, en 1886, ils logeaient encore rue Nationale.

La maréchaussée à cheval à la fin du XIXème siècle.
C’est durant son séjour rue Nationale que la Brigade connut son affaire judiciaire la plus célèbre : le crime de Saint Vincent-Sterlanges le 17 février 1882. Pierre Barbier, domestique agricole, avait tué avec une particulière sauvagerie son employeur Auguste Durand et la fille de ce dernier Madame Gibot. Récupéré à la suite d’une battue, il fut ramené à pied entravé entre deux gendarmes à cheval et passa la nuit du samedi 18 dans une cellule à Chantonnay. Le lendemain les gendarmes l’escortèrent par le train jusqu’à la prison de La Roche-sur-Yon. Reconnu coupable et condamné à mort, il fut le dernier à être guillotiné en Vendée le vendredi 22 septembre 1882 devant une foule considérable (Cf. article du présent Blog).

La gendarmerie au 21 Avenue Georges Clemenceau (1888-1966).
Une nouvelle caserne de Gendarmerie fut construite à Chantonnay au numéro 21 de la rue de Bordeaux (actuelle Avenue Georges Clemenceau) vers 1888. Elle était située dans un quartier en cours d’urbanisation, juste après la construction de l’École Primaire Supérieure en 1886. L’édifice existe encore, il sert aujourd’hui de logements de fonction pour le Lycée Clemenceau. Cette fois-ci, il s’agissait d’un bâtiment fonctionnel uniquement à usage de gendarmerie. Et d’un beau bâtiment, d’un genre qui l’on retrouve à peu près en plusieurs endroits du département, comme Saint Fulgent ou Tiffauges. Un immeuble, divisé en deux par un vestibule et un escalier central avec un appartement de trois pièces de chaque côté (le bureau à droite et les cellules à gauche) ainsi que trois appartements de trois pièces à l’étage. Les écuries et les W. C. communs au fond du jardin (le confort de l’époque !)
Au recensement de la population de 1891, quatre logements seulement étaient occupés. Par contre en 1901, il y avait bien cinq gendarmes. Dix ans plus tard, en 1911 on y trouvait : 1- le Maréchal des Logis François Charbonnier, son épouse Eugénie et son fils Marcel ; 2- le Gendarme Augustin Laurent, son épouse Marie et ses enfants Edmond, Adolphe et Olga ; 3- le Gendarme Charles Girard, son épouse Félicitée et ses fils Charles et Louis ; 4- le Gendarme Félix Péault, son épouse Marie-Rose et son fils Marcel ; 5- le Gendarme Jean Neau, son épouse Marie et son fils Jean. (François Charbonnier et Charles Girard étaient visibles sur une photo publiée plus haut).
Cette caserne est la plus emblématique de Chantonnay, puisqu’elle a été utilisée pendant la période sensible des deux guerres mondiales du XXème siècle. D’ailleurs la photo ci-dessus a été prise précisément lors de la fête de la Victoire le 14 juillet 1919. On y voit les gendarmes de l’époque et leur famille devant l’édifice pavoisé.

La gendarmerie au 11 rue des Soupirs (1966-2004).
L’exigüité des locaux, l’absence de confort et le manque de logements suffisants imposaient une construction nouvelle. Elle eut lieu au cours des années 1964 et 1965, à proximité au N° 11 de la rue des Soupirs par les soins de la ville de Chantonnay. Elle comprenait un petit bâtiment de bureaux à gauche de l’entrée de la cour et à droite un immeuble de logements proche de la Salle des Congrès. Et ce voisinage justement finissait par rendre l’habitation difficile, à cause des bruits nocturnes engendrés par cette salle. Le transfert s’imposait donc. Actuellement les anciens bureaux sont utilisés par des associations ; par contre l’immeuble de logements a été complètement détruit.

La Gendarmerie actuelle rue de la Plaine.
Comme entre temps, la responsabilité avait été transférée à la Communauté de Communes des Deux-Lays, c’est cette dernière qui entreprit une nouvelle construction. Elle fut implantée rue de la Plaine à proximité du Collège René Couzinet, où elle se trouve encore aujourd’hui. La brigade de Gendarmerie en a pris possession en mars 2004.
Chantonnay le 27 juillet 2022.
Maurice BEDON
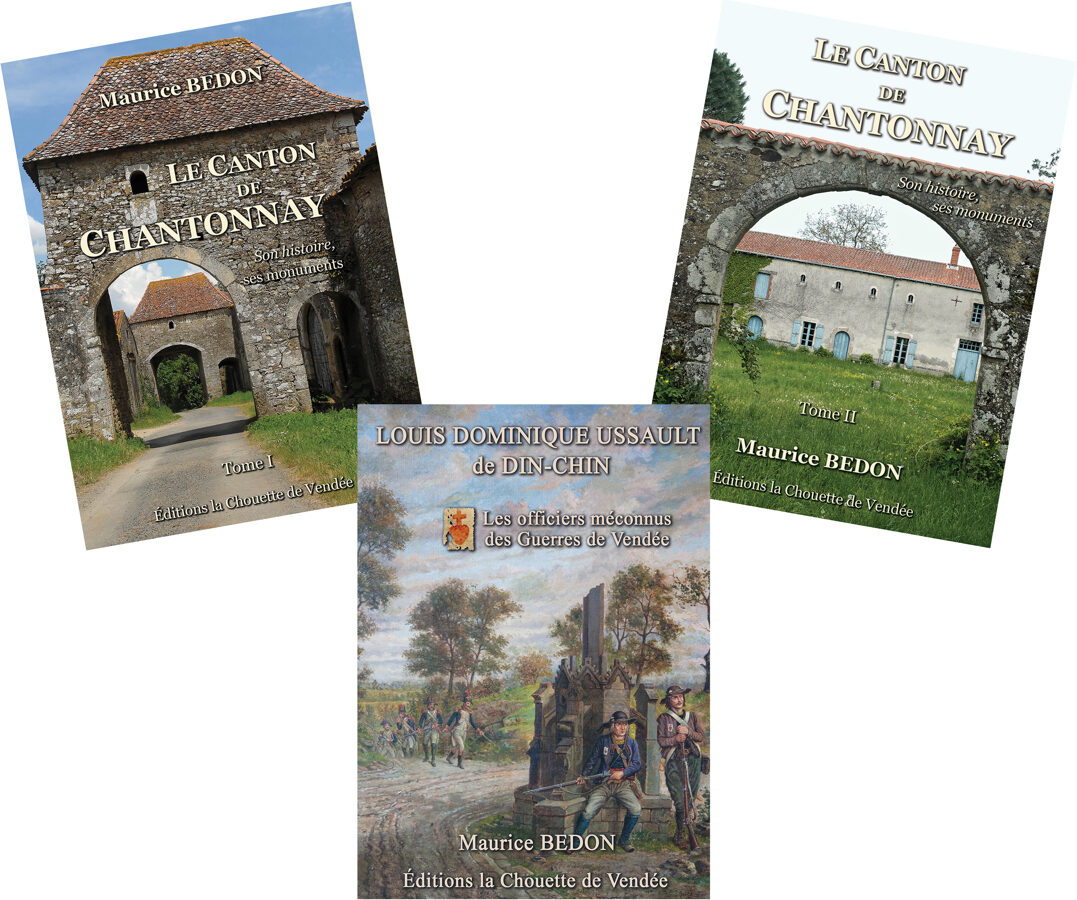

LA MORT D’UN PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
 La façade de l’Élysée, rue du Faubourg Saint-Honoré.
La façade de l’Élysée, rue du Faubourg Saint-Honoré.
Contrairement à ce que l’on aurait pu penser à priori, pas moins de 14
sur un total de 25 présidents qui se sont succédés sous les IIème, IIIème, IVème et Vème
Républiques n’ont pas eu la possibilité de terminer leur mandat (à
l’époque de 7 ans et désormais de 5 ans) et ce, pour des raisons très
diverses : 10 ont démissionné et 4 sont morts en cours de mandat.
-
Louis-Napoléon Bonaparte (1808-1873) entré en fonction le 20 décembre
1848, le « prince président » fait un coup d’état le 2 décembre 1852
pour modifier la constitution qui l’empêchait de se représenter. Il
établira ensuite le Second Empire à son profit ;
-
Albert Lebrun (1871-1950) entré en fonction le 10 mai 1932 et réélu en
1939, il ne démissionne pas, mais son mandat est interrompu par la fin
de la IIIème République et la création de l’État Français avec le maréchal Philippe Pétain le 11 juillet 1940 ;
- René Coty (1882-1962) entré en fonction le 16 janvier 1954 (élu au 14ème tour de scrutin), il se retire le 8 janvier 1959 pour laisser la place à la Vème République et au Général de Gaulle.
- Patrice de Mac Mahon duc de Magenta (1808-1893) entré en fonction le 24 mai 1873, il démissionne le 30 janvier 1879 après une défaite aux élections législatives qu’il avait provoqué. Il avait préféré alors « se démettre plutôt que se soumettre » ;
- Jules Grévy (1807-1891) entré en fonctions le 30 janvier 1879 et réélu en 1886. Il doit démissionner le 2 décembre 1887 après le scandale des décorations, où son gendre le député Wilson était compromis par la vente de Légion d’honneur ;
- Jean-Casimir Périer (1847-1907) entré en fonction le 27 juin 1894, il démissionne dès le 16 janvier 1895 du fait de l’hostilité des deux chambres ;
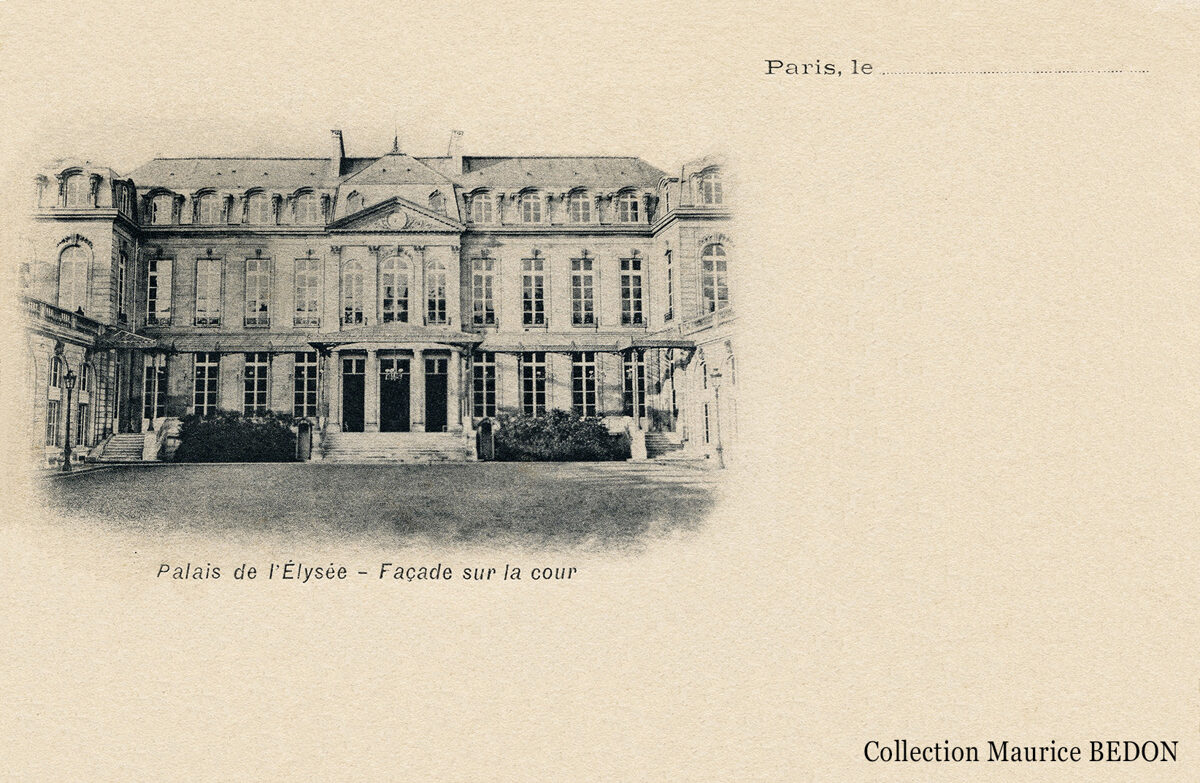 La cour du palais de l’Élysée à la fin du XIXème siècle.
La cour du palais de l’Élysée à la fin du XIXème siècle.Démission pour raison de santé : 1
Décès en cours de mandat : 4
- Félix Faure (1841-1899) entré en fonction le 17 janvier 1895, il est mort au palais de l’Élysée le 16 janvier 1899 d’une congestion cérébrale. C’est à lui que nous allons nous intéresser plus loin ;
- Paul Doumer (1857-1932) entré en fonction le 13 juin 1931, il a été assassiné lors d’une exposition à Paris le 7 mai 1932 par un illuminé russe Paul Gorgulov ;
- Georges Pompidou (1911-1974) entré en fonction le 20 juin 1969, il est mort à l’hôpital de la maladie de Waldenström, le 2 avril 1974.
 Portrait officiel de Félix Faure.
Portrait officiel de Félix Faure.Félix Faure est arrivé en gare de La Roche-sur-Yon le 20 avril 1897 au matin, en compagnie du Président du Conseil Méline, du ministre de l’intérieur Barthou, du général Brault commandant le 11ème corps d’armée de Nantes et de la maison militaire présidentielle, pour traverser la ville en direction de la Préfecture dans un landau attelé à la Deaumont. Le parcours était décoré de drapeaux tricolores et de lampions en papier. On avait dressé pour l’occasion un imposant arc de triomphe devant le square de la Préfecture, au bas de l’actuelle rue Jean Jaurès, entre les Archives Départementales et la Trésorerie Générale. Construit généralement pour les parades militaires, ce genre de monument était le plus souvent décoré d’armes (baïonnettes, sabres, cuirasses) disposées en faisceaux. Ici, comme il s’agissait d’une cérémonie civile, on utilisa de manière surprenante des outils agricoles (fourches, pelles, charrue, herses). La carte postale reproduite ci-dessous a été prise par Eugène Poupin de Mortagne, en dehors de la communication officielle, le lendemain de l’évènement. En raison de la pluie, les lampions en papier avaient déjà été retirés.
 L’arc de triomphe de La Roche-sur-Yon en 1897.
L’arc de triomphe de La Roche-sur-Yon en 1897. Début de la cérémonie d'inauguration de la statue à La Roche-sur-Yon.
Début de la cérémonie d'inauguration de la statue à La Roche-sur-Yon.Ce voyage officiel d’un Président modéré, était destiné à opérer un rapprochement entre l’Ouest monarchique et la France républicaine. D’ailleurs, les parlementaires monarchistes de Vendée avaient accepté d’être présents. L’accueil a été partout magistral et le voyage une véritable réussite. Les résultats furent malheureusement annulés par la politique radicale et sectaire exercée par Émile Combes quelques années plus tard.
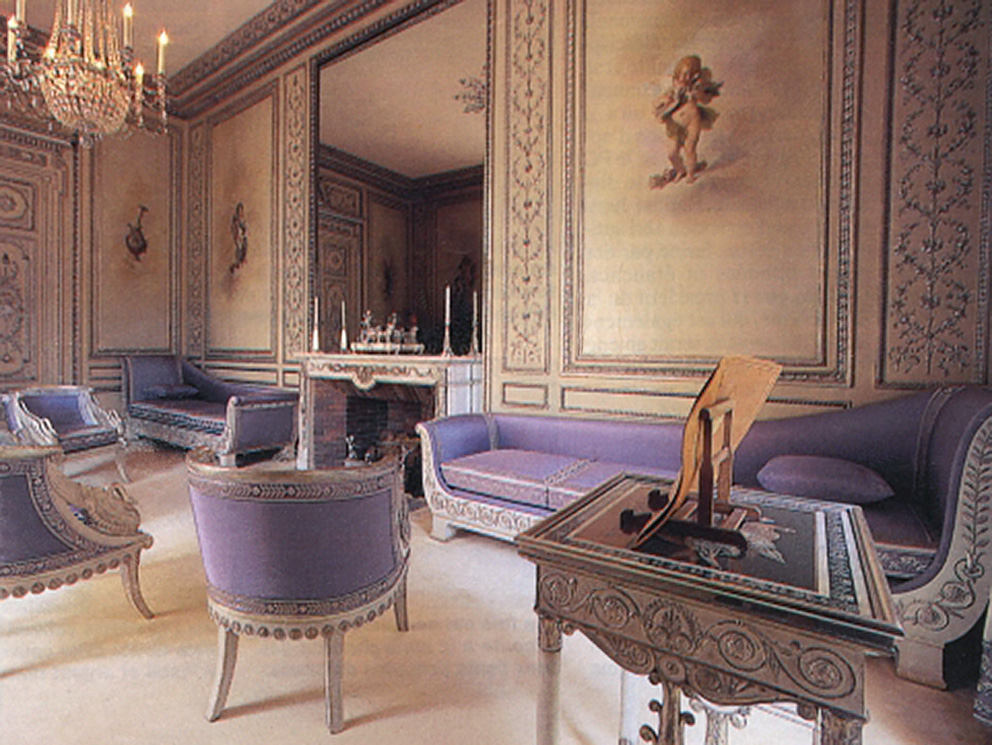 Le salon d’argent au palais de l’Élysée.
Le salon d’argent au palais de l’Élysée.Et précisément ce 16 février 1899, Félix Faure avait eu une longue journée puisque S. E. Monseigneur Richard cardinal archevêque de Paris et S. A. S. Albert Ier Prince de Monaco étaient venus tous les deux dans l’après midi, en particulier pour plaider en faveur de l’innocence du capitaine Dreyfus. Il avait toutefois donné rendez-vous, dans le salon d’argent, à 17 heures à sa maîtresse (on disait pudiquement à l’époque sa « connaissance ») Marguerite Steinheil, épouse d’un peintre connu.
Au cours de l’entretien, le chef de cabinet Le Gall a été brusquement alerté par des cris provenant précisément du salon d’argent. S’étant précipité, il trouva le Président agonissant, victime d’un accident vasculaire cérébral. Pour éviter le scandale, Madame Steinheil n’eut que le temps de se rhabiller rapidement pour quitter les lieux. Elle le fit tellement vite qu’elle en oublia son corset, que le chef de cabinet conserva en souvenir. Elle sortit discrètement de l’Élysée par la porte sur le côté gauche de l’entrée du palais, donnant dans la rue dite de l’Élysée.
Son épouse Marie-Mathilde Bulluot Faure et sa fille rejoignirent alors le Président.
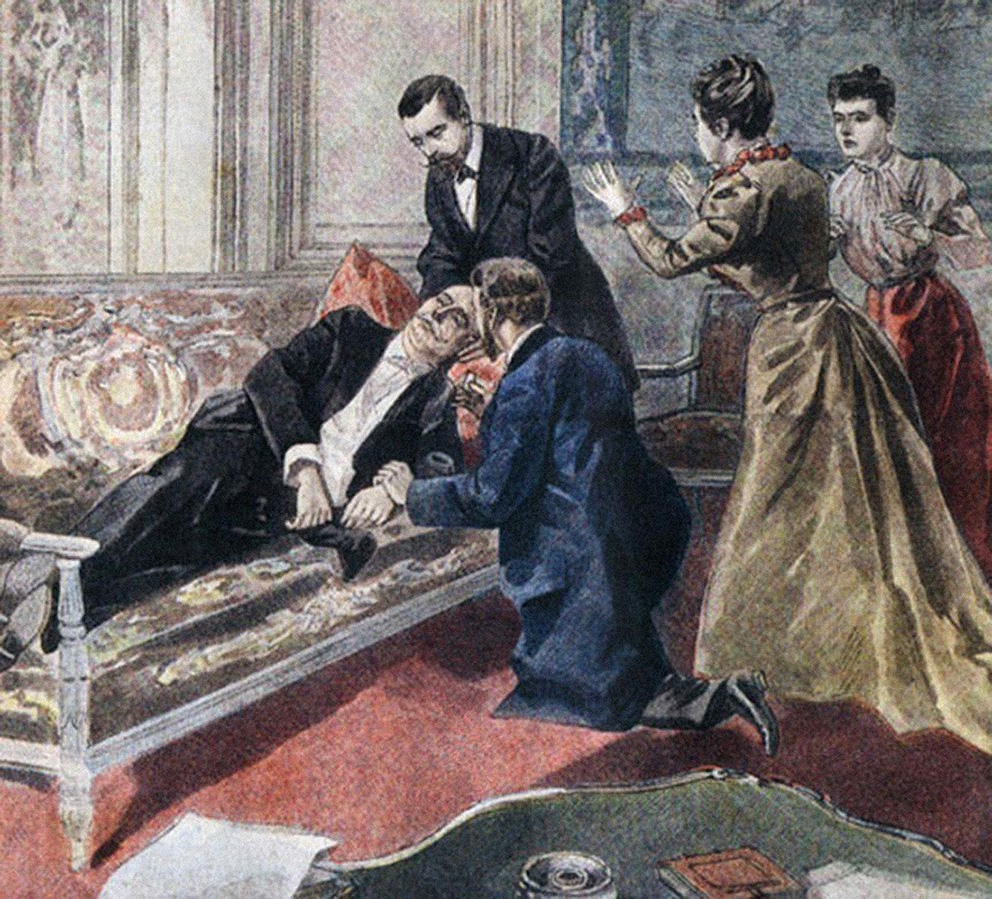 La mort du Président vue par la Presse en 1899
La mort du Président vue par la Presse en 1899Madame Faure avait demandé à deux huissiers du palais d’aller chercher l’abbé Herzog curé de l’église de la Madeleine, pour administrer les derniers sacrements. En s’y rendant par la rue du Faubourg Saint-Honoré les deux hommes rencontrèrent par hasard un prêtre sur le trottoir. A cette époque, on les reconnaissait facilement à leur soutane, leur rabat et leur chapeau à larges bords. Ils lui firent part de leur recherche et celui-ci leur répondit aussitôt « Je vous suis, mes enfants ». Parole un peu imprudente, parce qu’il était bien plus âgé que les deux huissiers. Après avoir traversé rapidement la cour, arrivé au haut du perron, il risqua une question pour pouvoir reprendre sa respiration. C’était d’ailleurs, la question traditionnelle que posaient tous les prêtres en pareille circonstance, car le fait d’être conscient ou non changeait la nature du sacrement : « Monsieur le Président de la République a-t-il toujours sa connaissance ? ».
La réponse qu’il reçut va le surprendre beaucoup et fera ultérieurement rire tout le monde : « Oh ! ne craignez rien Monsieur le Curé, bien entendu, nous l’avons fait sortir par la porte de derrière ».
 La cour de l’Élysée tendue de noir et le corbillard.
La cour de l’Élysée tendue de noir et le corbillard.L’aspect général de la cour du palais de l’Élysée, recouverte de tentures noires et argent, montre bien la pompe de la cérémonie, de même que le corbillard monumental, tiré par six chevaux caparaçonnés de deuil, que l’on aperçoit dans la cour.
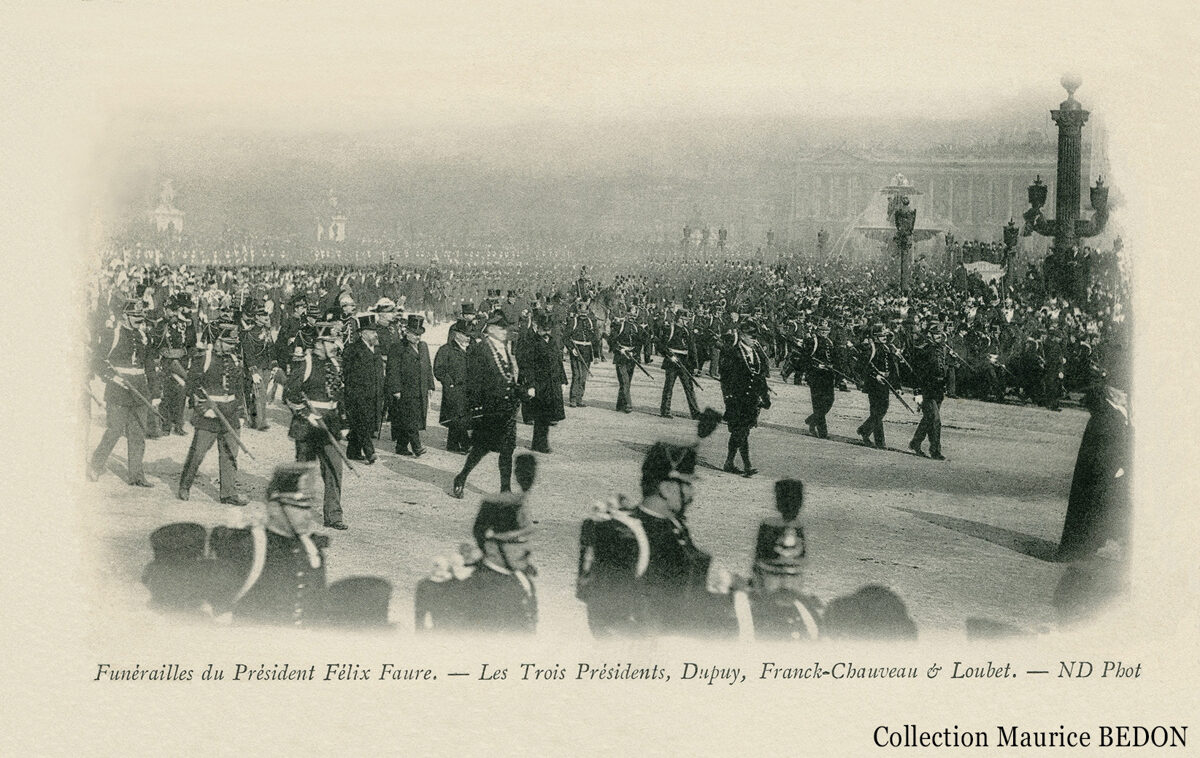 Le cortège funèbre passe place de la Concorde.
Le cortège funèbre passe place de la Concorde.
ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE LOUIS DE FROTTÉ
18 février 2022, souvenir d’une funeste date. Il y a 222 ans le comte Louis de Frotté, général en chef des chouans de Basse-Normandie partait à l’exécution avec ses compagnons.
18 février 1800 : Monsieur Louis est victime de sa fidélité, de sa droiture et de la parole donnée. En effet, il fut arrêté à Alençon alors qu’il venait négocier la fin des hostilités (l’Ouest entier ayant posé les armes, la Normandie tenant seule le drapeau du roi). Muni d’un sauf conduit, il sera tout de même arrêté, les bleus arguent que le sauf conduit était expiré… piètre argument… Louis et ses compagnons sont dans le noir concernant leur sort. Ils sont convoyés en direction de Paris, seront-ils jugés devant le sombre Bonaparte ? Ce cher Napoléon ne prendra même pas cette peine, le convoi de l’horreur s’arrête à Verneuil-sur-Avre. Là bas, un simulacre de procès a lieu et la peine est ce qu’elle est : la peine de mort à exécution immédiate. Louis et ses six compagnons ne verront pas l’aube du 19 février, la vie s’arrête aujourd’hui. Le songe normand s’arrêtera aujourd’hui, Louis ne sera pas le restaurateur de la monarchie, il emmènera le cœur de la chouannerie normande avec lui dans la mort.
Ils sont emmenés à l’écart de la ville, sur leur passage on raconte que les habitants de Verneuil ferment les volets, en signe de protestation silencieuse ? Le déroulement de l’exécution ainsi que l’intégralité des événements depuis sa capture demeurent cependant brumeux. En effet, il n’existe aucune trace écrite de quoi que ce soit, et si elles furent réalisées, elles ne sont pas parvenues jusqu’à nous. Ainsi, on raconte qu’un seul peloton fut chargé de tirer sur Louis et ses compagnons en même temps. Louis de Frotté est face à la mort, s’il a déjà dansé avec elle plusieurs fois, cette fois il la regarde dans le blanc des yeux et ce sera la dernière fois. Louis de Frotté, homme très sensible, va payer de sa vie pour ses idéaux et pour avoir toujours gardé cette droiture qui le caractérise.
Avait-il encore sa place dans ce monde ? Lui, homme d’ancien régime des pieds à la tête. Avec lui, se tourne également la page des chevaliers à l’aura légendaire. Car oui, il a laissé son empreinte et il laisse derrière lui une épopée digne des plus beaux romans. Le peloton tire, Louis est abattu. Encore une fois, l’on peut se prêter à rêver sur plusieurs versions, Louis s’est il relevé pour crier une dernière fois « Vive le Roi » ? Les condamnés furent ils achevés à terre car toujours vivants ? Ce qui est certain, c’est qu’ils sont partis avec panache et fierté, Louis de Frotté avait 33 ans.
Aujourd’hui, 18 février 2022, je vous invite à allumer une bougie en sa mémoire afin que chaque année la légende continue. Après ce court résumé sur la tristesse de sa mort, laissez-vous bercer par la beauté de sa vie en lisant mon livre : Louis de Frotté, La Normandie du Roi, disponible aux éditions la chouette de Vendée.
Morgan Lazartigues.
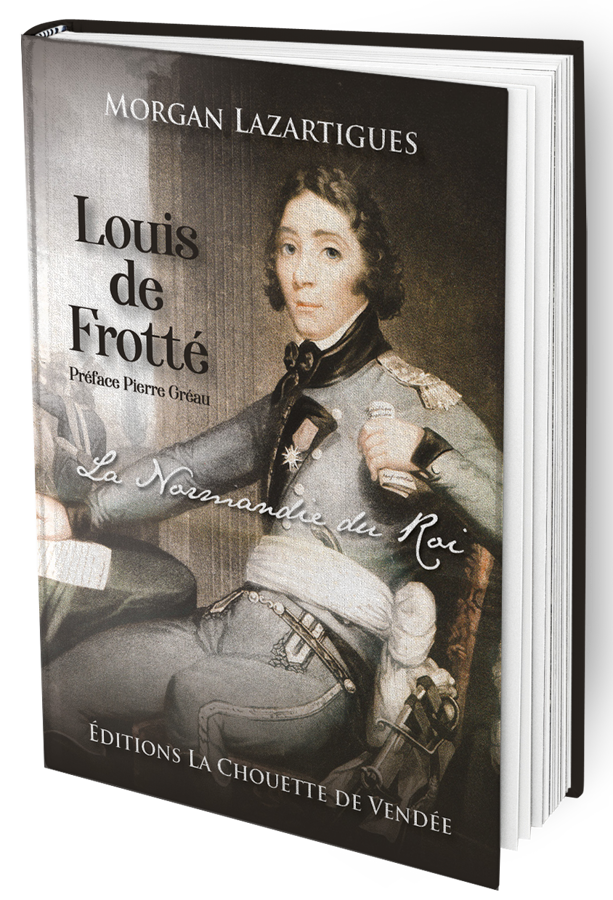

LA NAISSANCE DES CARTES POSTALES EN VENDÉE
La modification importance va être l’apparition d’une toute petite illustration au recto, initiée d’abord par le magasin « La Belle Jardinière » à Paris. Les premières cartes réalisées de cette façon vont sortir pour l’exposition universelle de Paris en 1889, avec naturellement un petit cliché de la toute nouvelle Tour Eiffel. Ces célèbres cartes, appelées les « Libonis », seront diffusées à 300 000 exemplaires par le monde.
Toutefois, à cette époque en Vendée, on ne trouve encore que les cartes non illustrées utilisées à des fins commerciales, pour annoncer le passage d’un représentant ou faire une commande. Le cliché ci-dessous en est un bon exemple. Il a circulé le 14 août 1890 pour permettre la commande de M. Papineau, épicier rue Nationale à Chantonnay, auprès d’un grossiste M. Pernod, de Pontarlier dans le Doubs.
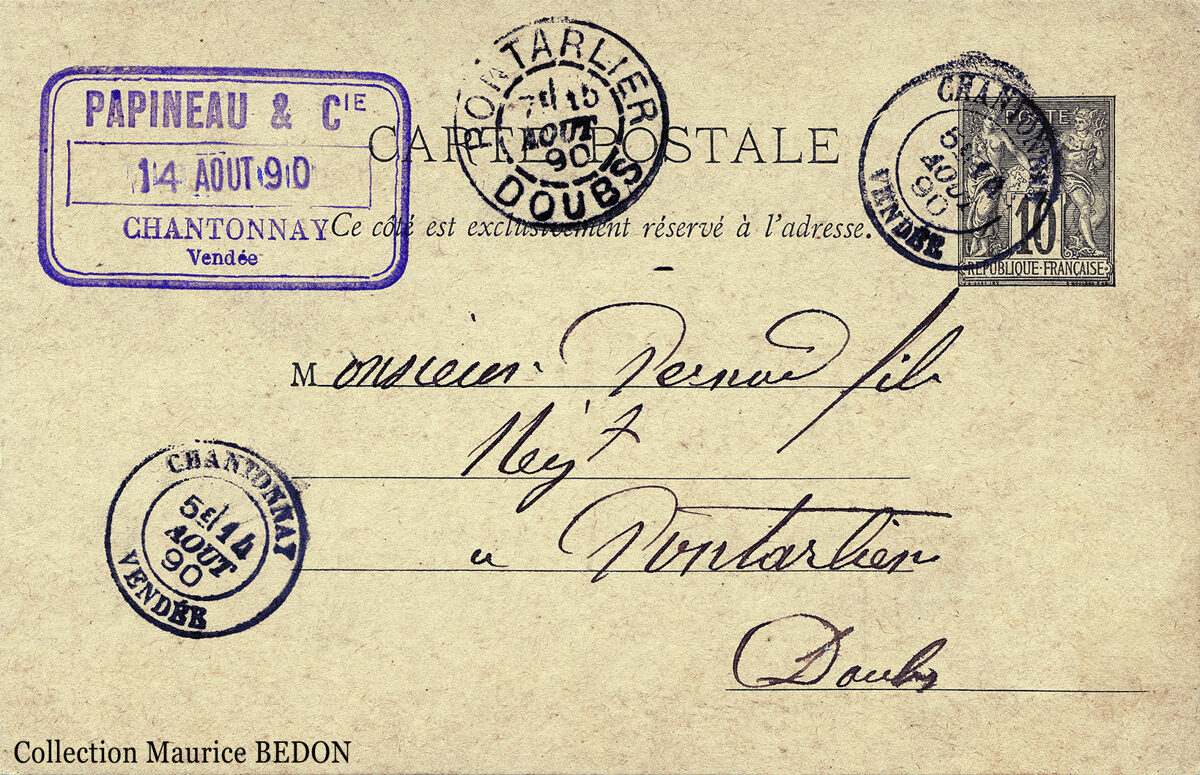
Le carton commercial posté en 1890.
Les cartes postales « Pionnières » (1897-1900)
Dans le département, les premières cartes réalisées à destination des touristes, ont été éditées par un imprimeur parisien Daniel Neurdein, sous le pseudonyme « ND Phot. ». Ce dernier, faisant en 1885 le tour des grandes villes de France pour réaliser des clichés, s’était arrêté en Vendée, mais seulement aux Sables d’Olonne. Aussi, quelques années plus tard vers 1893, il tenta de s’en servir pour faire les premières cartes postales.
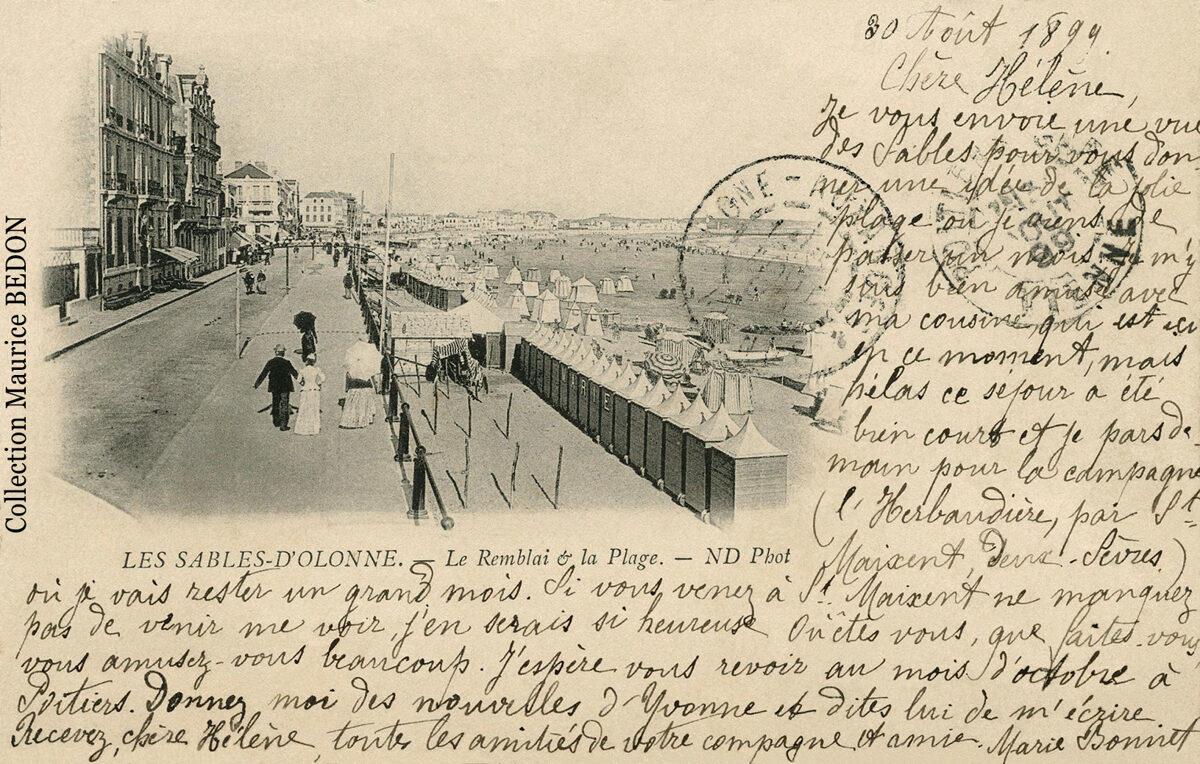
Une carte postale du Remblai aux Sables d’Olonne, ND phot, postée en 1899.
Seulement, si son premier essai n’avait pas connu le succès attendu, il avait néanmoins donné des idées à plusieurs concurrents sur le plan local.
Ainsi, le premier Vendéen a éditer ses propres cartes postales va être Lucien Amiaud de La Roche-sur-Yon, dès le mois de novembre 1897. Fils d’Émile Amiaud photographe dans cette ville, rue Lafayette, c’est juste à sa sortie des obligations du service militaire qu’il se lance dans cette activité. Cette date étant connue, elle nous permet ainsi de dater officiellement la diffusion véritable des premières cartes postales dans le département. En réalisé, il y avait sûrement pensé plus tôt, car habitant à moins d’un kilomètre de sa caserne, il avait fait des tentatives lors de ses permissions chez son père. La carte postale ci-dessous est une des premières, elle a été postée trois mois plus tard, le 18 février 1898. Elle constitue ainsi la preuve que le photographe en avait vendu assez rapidement. Ses premières cartes ne sont pas numérotées et portent encore très discrètement le nom de l’auteur. La numérotation viendra ensuite assez rapidement, quand il aura besoin de retrouver ses plaques facilement pour effectuer des rééditions. Nous avons déjà retracé succinctement la vie et l’œuvre de ce photographe dans un précédent article du présent Blog.
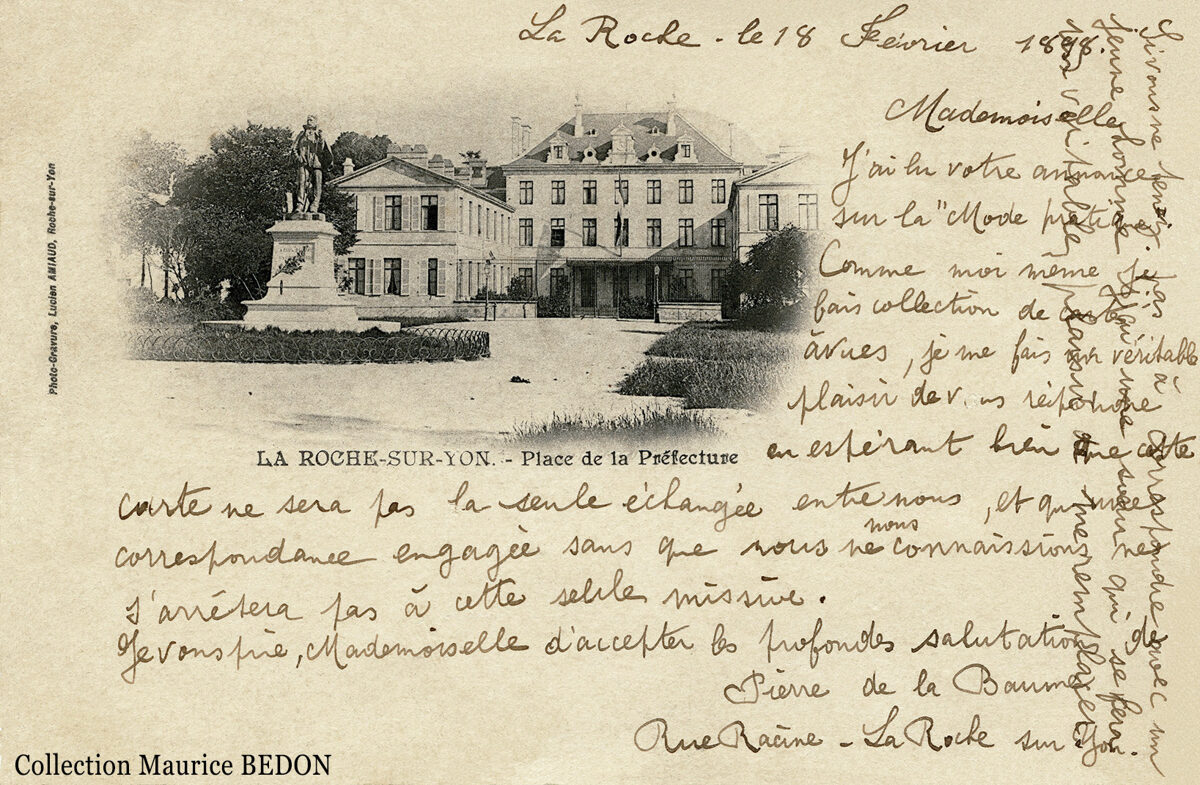
Une carte postale de la Préfecture à La Roche-sur-Yon,
Lucien Amiaud, postée en février 1898.
Lucien Amiaud a été le premier photographe vendéen de cartes postales, mais il a été suivi de très, très près par plusieurs autres concurrents amateurs et professionnels. La première personne qu’il convient de citer ici c’est tout d’abord Donatienne de Suyrot, habitant place Louis XVI à Nantes ou au château de la Gastière à Chambretaud. Elle avait, en effet, réalisé quelques années plus tôt tout un ensemble de photos du plus grand intérêt. La commercialisation de ses clichés n’était pas le premier objectif de sa démarche. Elle souhaitait plutôt en faire un usage personnel dans les échanges entre amis ou collectionneurs (déjà !). Elle n’en éditera qu’une trentaine environ, sous la rubrique « Souvenir du Bocage Vendéen », en collaboration avec un imprimeur de Mortagne-sur-Sèvre. Celle reproduite ci-dessous a été expédiée le 28 décembre 1898.

Une carte postale du Mont des Alouettes aux Herbiers,
Donatienne de Suyrot, postée en décembre1898.
Outre les premiers photographes et des particuliers, d’autres professions vont s’intéresser très tôt à l’édition de cartes postales. Parmi ceux-ci on trouve Henri Lussaud, imprimeur à Fontenay-le-Comte et le plus célèbre éditeur d’Histoire locale du département. Toutefois, comme il n’est pas photographe, il utilise les plaques faites par un certain Gaborit. La carte postale figurant dessous n’a voyagé que le 22 août 1900, mais elle est visiblement un peu plus ancienne. Pour Henri Lussaud, il ne s’agissait que d’une activité très secondaire, il ne produira en réalité que quelques cartes de Fontenay-le-Comte ou des environs immédiats.
IL convient aussi de préciser que d’autres cartes, non datées et sans nom d’auteurs, circulaient également en plusieurs lieux de Vendée et en particulier aux Sables d’Olonne, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à Luçon, à Tiffauges etc… Ces clichés pourraient probablement être attribuées à des photographes locaux collaborant avec des entreprises urbaines. Ces mêmes artisans, on les retrouvera plus tard, quand ils se seront installés dans la fonction.
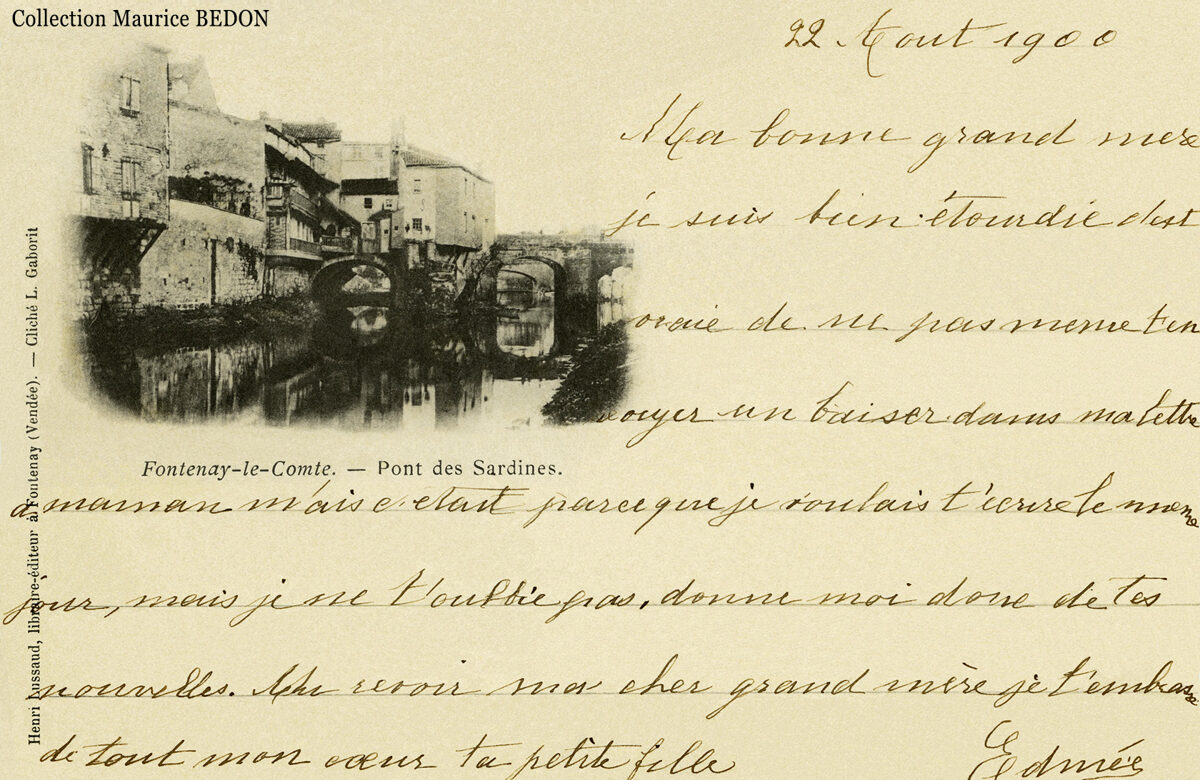
Une carte postale du pont des sardines à Fontenay-le-Comte,
Imprimerie Lussaud, postée en août 1900.
Un autre artiste a également sa place dans ce chapitre et à cette période « pionnière » : Il s’agit de Jules (César) Robuchon (1840-1922) sculpteur, peintre et photographe, installé successivement à La Roche-sur-Yon, à Fontenay-le-Comte et finalement à Poitiers. Comme nous venons de le voir, il n’a pas été le premier à éditer des cartes postales en Vendée, en revanche ses réalisations sont d’un intérêt primordial. En effet, pour ce faire, il utilise les plaques de verre anciennes qu’il possède dans son atelier. Il s’agit de personnages qui sont venus se faire tirer le portrait dans son studio sous le Second Empire, vers 1866, mais aussi des clichés pris vers 1885 et destinés à illustrer la célèbre série de livres « Paysages et Monuments du Poitou ». La carte postale ci-dessous appartient à la première catégorie. Elle représente, en 1870, une dame en tenue locale, mais avec une robe en forme de crinoline.

Une carte postale d’une dame en costume de 1870, Jules Robuchon, non postée.
Les Cartes postales « précurseurs » (1900-1903)
Cette période de 1900 à 1903 reste encore une période intermédiaire dite des « précurseurs ». Les cartes postales n’ont pas encore leur forme définitive. Elles sont dites « en nuage », car l’image et la correspondance doivent cohabiter sur le recto et le cliché n’a pas de bords francs, mais des limites évanescentes. En effet, l’Administration des Postes n’a pas encore pris la décision qui va tout changer. Elle ne le fera qu’en décembre 1903, en décidant que le recto serait désormais réservé à l’illustration, l’adresse et la correspondance se partageant équitablement le verso. On notera également sur la carte ci-dessous la présence de l’inscription « République Française » qui disparaîtra d’ailleurs un peu plus tard. Certains s’amusaient à la raturer ou à la cacher avec le timbre (la Marianne mise la tête en bas).

Le verso d’une carte postale, postée en mai 1900 (pour Alexandrie en Égypte).
A partir de 1900 environ, les cartes postales sont devenues désormais monnaie courante dans le département. La presque totalité des grands noms de la photographie locale qui vont faire carrière sont maintenant en place, qu’ils aient été formés ou soient autodidactes. Signalons en particulier les deux plus importants sur le plan départemental : Eugène Poupin de Mortagne-sur-Sèvre et Armand Robin de Fontenay-le-Comte, mais sans oublier que chaque canton a un ou plusieurs éditeurs locaux de cartes postales et que certains essayaient de rivaliser avec les éditeurs départementaux, comme Madame Milheau. Le premier a tout d’abord une période dite « rouge », où toutes les inscriptions et légendes sont faites avec cette couleur d’encre. La carte visible ci-dessous figure parmi les premières d’Eugène Poupin.

Une carte postale de Mortagne-sur-Sèvre en 1900,
Eugène Poupin de Mortagne, non postée.
Comme le précédent, Armand Robin va s’intéresser à l’ensemble de la Vendée et même aux communes limitrophes des autres départements (comme les Deux-Sèvres). Il fera également des séries que des amateurs achèteront en bloc, comme « Les Églises de Vendée » et surtout son plus grand succès « Les Châteaux de Vendée ».

Une carte postale de Fontenay vers 1900, Armand Robin de Fontenay, non postée.
Les Cartes postales de « l’Age d’Or » (1904-1914)
A partir du 1er janvier 1904, les cartes postales ont désormais leur forme définitive et vont connaître un succès qui ne se démentira pas pendant 10 ans au moins et ne sera ralenti que par la première guerre mondiale.
Durant cette troisième période on voit encore apparaître quelques grands photographes comme Paul Dugleux à La Roche-sur-Yon, dont nous avons également déjà retracé le parcours sur le présent Blog.
Comme à cette date, il y a encore peu d’appareils photos, que les journaux ne sont pas illustrés, que les magazines le sont souvent par des dessins et sont chers, acheter une carte postale constitue le moyen de conserver des souvenirs d’évènements communs (fêtes locales, congrès eucharistiques, missions, évènements militaires etc…
C’est durant cette période de 1904 à 1914 que l’on connaît le plus grand nombre d’éditeurs, que leurs œuvres sont innombrables et encore imparfaitement connues. Cette période pourrait donc faire l’objet d’un nouvel article.

PAUL DUGLEUX, PHOTOGRAPHE
Paul Samuel DUGLEUX est né 31 mars 1871 à La Roche-sur-Yon. Il est le fils de Pierre Dugleux cordonnier (dans le quartier des Halles) et de Marie Marché. Nous ne savons pas dans quel établissement scolaire public il a fait ses études mais il a poursuivi jusqu’au brevet.
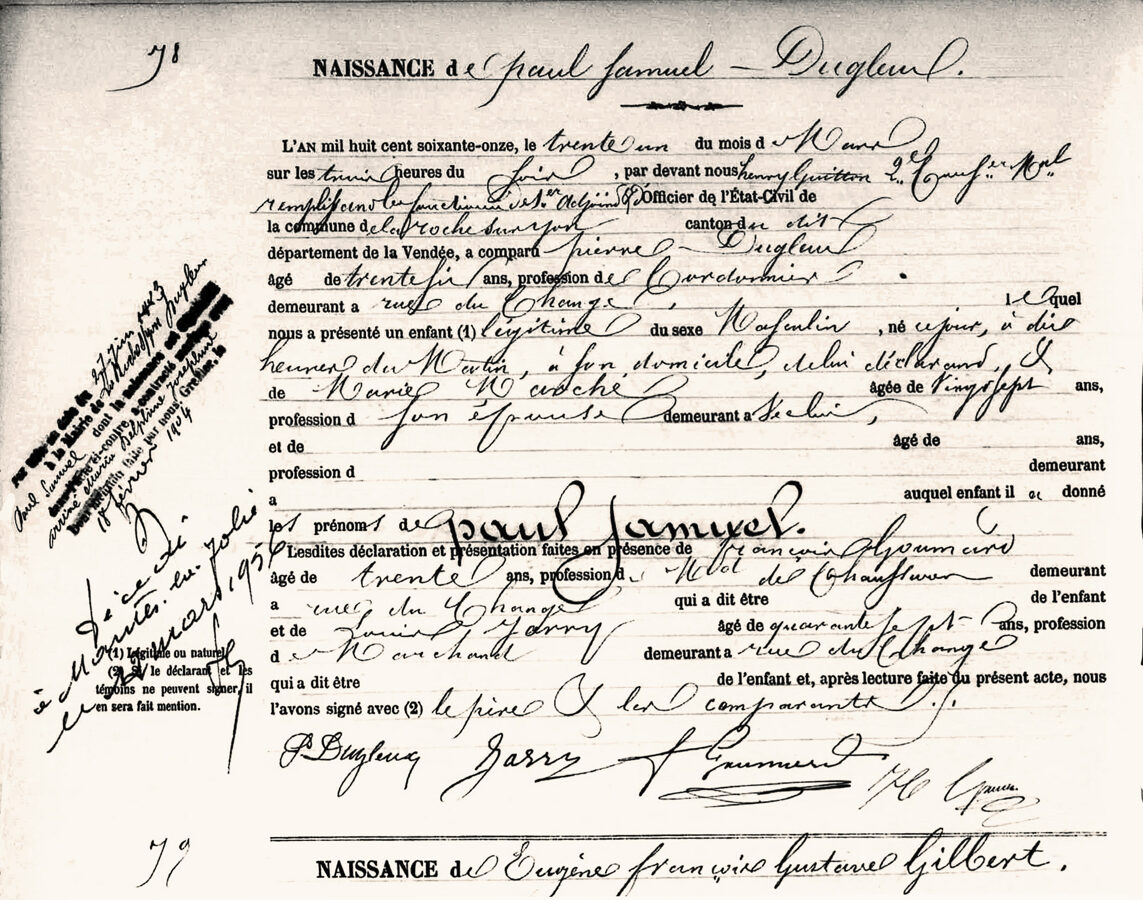 L’acte de naissance de Paul Dugleux (archives départementales).
L’acte de naissance de Paul Dugleux (archives départementales).
A l’âge de 20 ans, il songe tout d’abord à faire une carrière militaire et il se porte comme engagé volontaire pour une durée de 3 ans à partir du 12 mars 1891. Incorporé le jour même au 93ème régiment d’infanterie de La Roche-sur-Yon, il sert peu après en qualité de musicien. Il est libéré le 12 mars 1894 et recevra plus tard le grade de caporal, mais sa carrière militaire n’ira en fait pas au-delà. En effet les commissions spéciales des 21 septembre 1900 et 27 octobre 1901 le réforment pour « infirmités contractées en dehors du service militaire : bronchite tuberculeuse ».
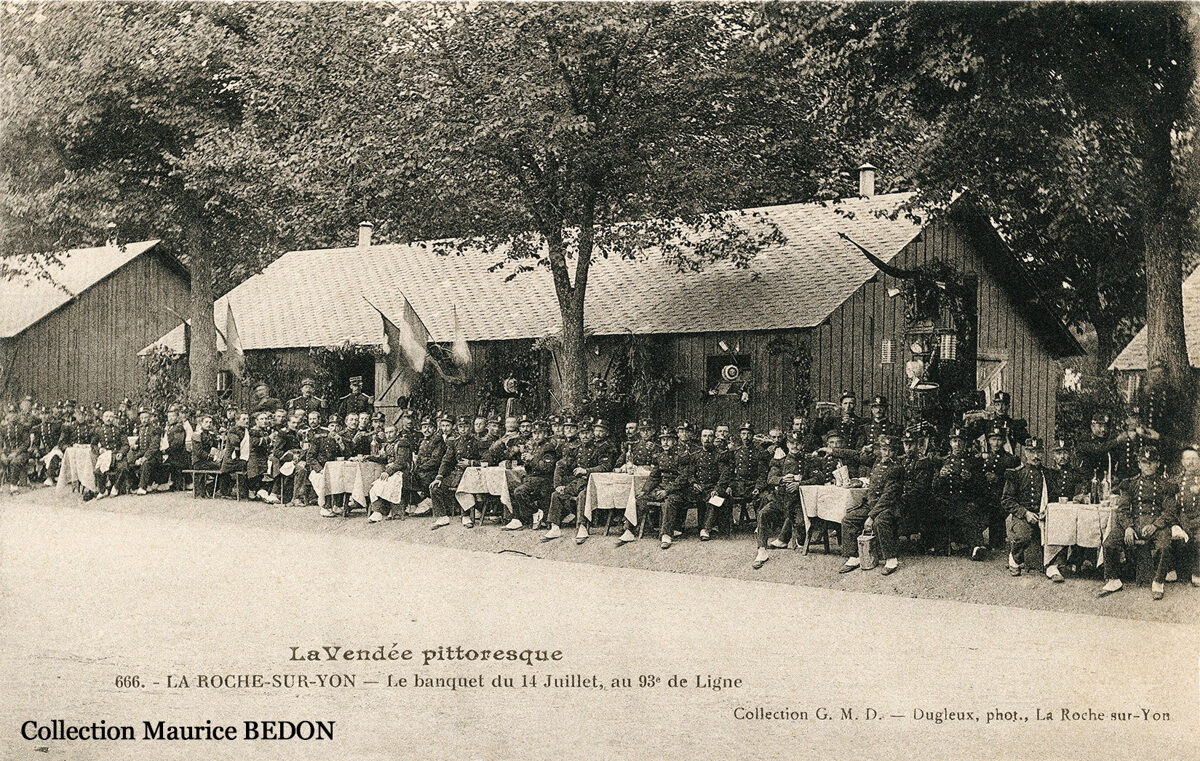 Le banquet du 14 juillet 1907 à la caserne de Mirville (N°666).
Le banquet du 14 juillet 1907 à la caserne de Mirville (N°666).
Malgré cette déception, il restera toujours très attaché au 93ème régiment d’infanterie de La Roche-sur-Yon, à l’armée en général et aux questions militaires qui seront toujours très présentes dans son œuvre photographique : vie à la caserne (N°371, 420, 666), exercices (N°119, 667, 668, 669, 708), cérémonies (N°581), départ en manœuvres (N°111, 254), retour de marche (N°540, 599, 600), défilés (N°704, 705, 706, 708, 763) etc….
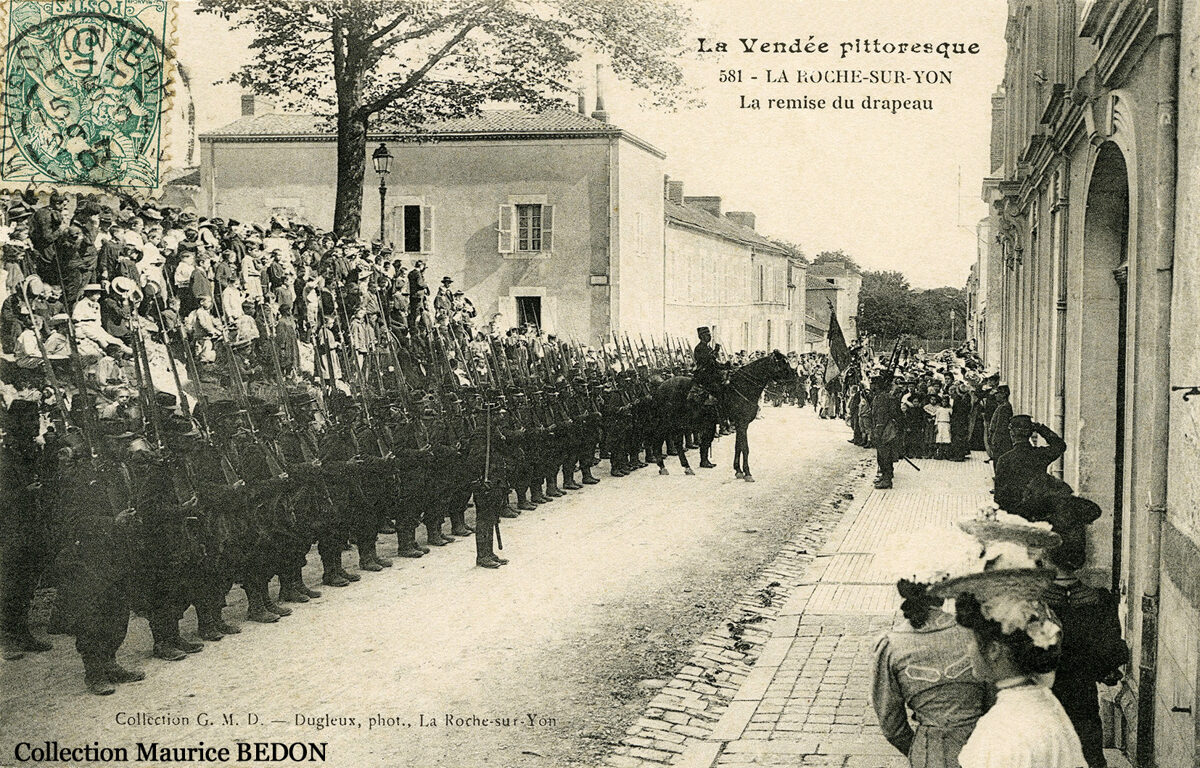 Remise du drapeau devant la maison du colonel (N°581), (actuelle rue du général Gallieni).
Remise du drapeau devant la maison du colonel (N°581), (actuelle rue du général Gallieni).
Entre temps il s’est marié avec Marie-Jeanne Bordeau, originaire de La Rochelle, fille d’Alexandre Bordeau et d’Eugénie Clair. Ensemble, ils auront deux enfants : Paul-Alphonse né le 20 février 1895 et Marguerite née le 11 novembre 1898. Malheureusement son épouse décède dès le 30 octobre 1902 et il se retrouve seul avec deux enfants âgés de 4 et 7 ans. Aussi, sans attendre les deux ans de veuvage considérés comme convenables à l’époque, il se remarie dès le 23 juin 1903 avec Marie Delphine Arrivé. Elle est fille d’Adolphe Arrivé et de Honorée Pluchon, exerce la profession de sage-femme et est son aînée de 2 ans (née à Beaurepaire en Vendée).
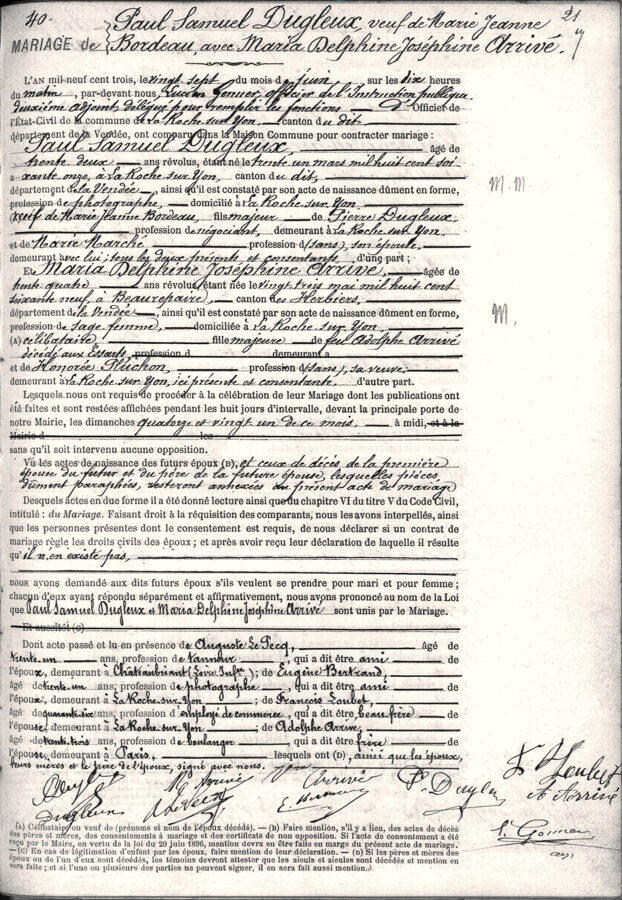 Acte de Mariage (Archives Départementales).
Acte de Mariage (Archives Départementales).
Sur le plan professionnel, Paul Dugleux a d’abord été employé, puis il se qualifie lui-même de négociant sur les papiers officiels et tient un magasin au N°1 de la rue de la Poissonnerie dans cette même ville de La Roche-sur-Yon. Il a pour ami proche Eugène Bertrand, photographe 9 rue Littré (près de la Gare), que l’on retrouve comme témoin lors des actes d’état civil familiaux. Il est vraisemblable que c’est ce dernier qui l’a initié à la photographie à la fin du XIXème siècle. En tous cas, en 1899, Paul Dugleux est déjà photographe au N°1 rue de la poissonnerie et commence à avoir les personnalités départementales comme clients.
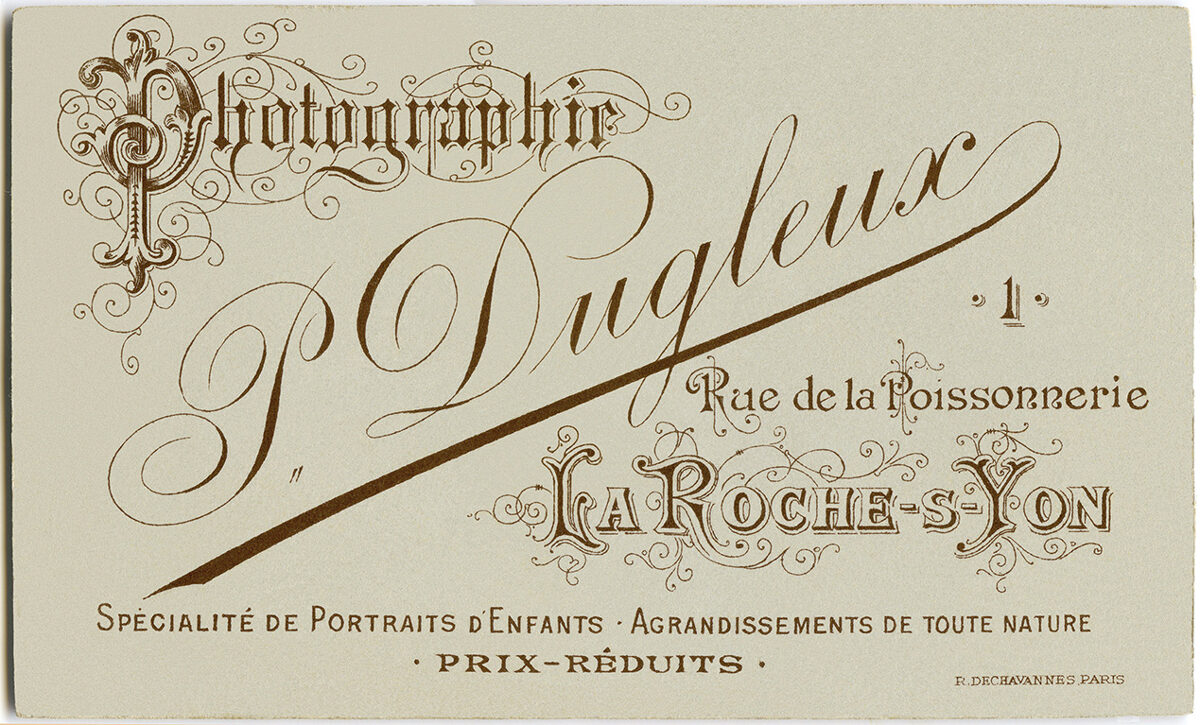 La publicité au verso d’une photo faite par Dugleux.
La publicité au verso d’une photo faite par Dugleux.
Après son remariage en 1903, il change l’adresse de son magasin et s’installe plus près du centre ville et de la place Napoléon, au numéro 14 de la rue Paul Baudry. Une adresse beaucoup plus stratégique pour ses commerces de photographie et de bureau de tabacs, puisqu’il est tout près de la clientèle des soldats de la caserne du château (actuelle cité Travot) Jusqu’à présent il n’avait fait que de la photographie en studio, l’année suivante, en 1904, il s’associe au photographe Gustave Moreau pour produire des cartes postales. Ce dernier avait auparavant été associé à Lucien Amiaud (GMLA) ; avec Dugleux l’inscription devient (GMD) puis bientôt ils créent la collection « La Vendée Pittoresque ».
 Le magasin Dugleux visible sur cette carte.
Le magasin Dugleux visible sur cette carte.
Paul Dugleux restera toujours et avant tout un photographe de studio, contrairement à beaucoup de ses collègues de cette époque dans le département. Il est visiblement d’une nature plus timide et se déplace beaucoup moins, peut être pour des raisons de santé ? En outre, il privilégie presque toujours les cantons autour de La Roche : Chantonnay, Les Essarts, Mareuil, La Mothe-Achard, le Poiré-sur-Vie etc…avec une exception : le canton de Chaillé-les-Marais.
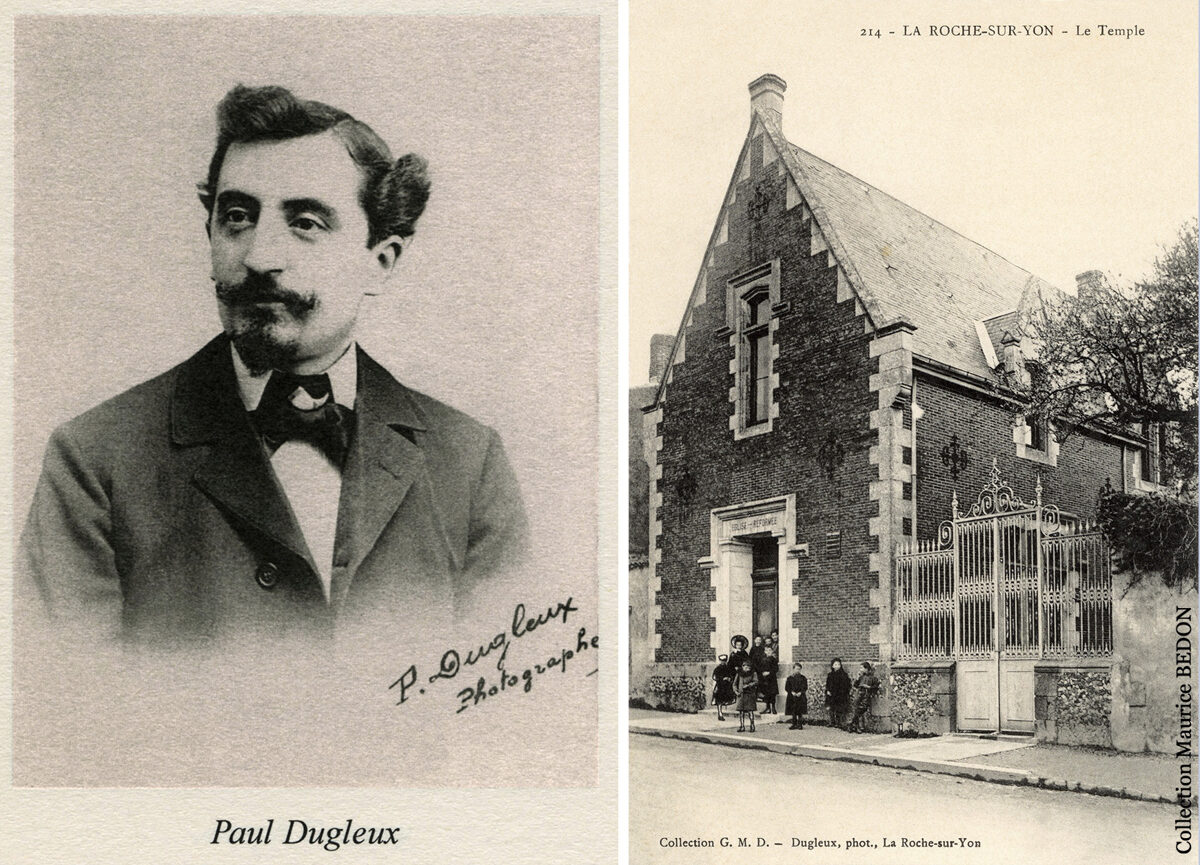 Une photo de Paul Dugleux et le temple protestant à La Roche-sur-Yon.
Une photo de Paul Dugleux et le temple protestant à La Roche-sur-Yon.
Ses propres photos sont techniquement d’une grande qualité et il semble préférer les scènes de rues prises d’une façon naturelle, plutôt que de rameuter tout le voisinage pour venir poser (comme le fait en particulier son collègue Eugène Poupin de Mortagne-sur-Sèvre).
Il ne semble pas avoir eu de véritable affinité avec la religion catholique et les œuvres paroissiales. On lui connaît seulement deux photos prises à l’intérieur d’une église (Luçon N°160, Sainte- Hermine N°341) et une seule représentant une cérémonie religieuse à Luçon (N°96), qui n’ont vraisemblablement pas été faites par lui. Il n’est pas allé dans les communes sièges des maisons mères des grandes congrégations : Saint Laurent-sur-Sèvre, Chavagnes-en-Paillers, ou Mormaison. Il est en outre le seul à avoir photographié le temple protestant de La Roche-sur-Yon (N°214). D’ailleurs au XVIIIème siècle, les familles Dugleux connues ont toutes été mariées au désert par un pasteur.
En revanche, il s’intéresse beaucoup au commerce local avec de nombreuses scènes urbaines, des vues de foires (N°95, 99, 416, 417, 418, 419, 483, 495, 659, 660) ou de marchés (N°16, 193, 248, 251, 304, 556), ou des ventes spécialisées (N°87) ou des images de publicité de commerces en particulier (N°235, 243, 251).
 Publicité au magasin Bonvalet à La Roche (sans N°).
Publicité au magasin Bonvalet à La Roche (sans N°).
On retrouve également de nombreux clichés consacrés aux manifestations à caractère sportif, principalement, mais pas uniquement, à La Roche-sur-Yon : équipes sportives (sans N°), haras (N°409), courses aux ânes (N°131), courses cyclistes (N°281), courses hippiques (N°127, 278, 279, 285, 286), stand de tir (N°236). Toutefois, il s’attarde d’avantage à photographier le public présent lors de ces spectacles que les exploits des sportifs eux-mêmes.
On ne lui connaît pas véritablement de reportages sur les grands évènements locaux ou les différents faits divers, si ce n’est les inondations de la rivière l’Yon à La Roche-sur-Yon en février 1906 (N°421, 422, 424, 425).
 Les tribunes lors des courses à Luçon (N°285).
Les tribunes lors des courses à Luçon (N°285).
Contrairement aux autres éditeurs de l’époque, il a été très peu passionné par les Guerres de Vendée en 1793 et il n’apparaît pas solidaire avec les combattants Vendéens. Il a consacré à ce sujet : la statue du général républicain Travot (N°60) place du marché à La Roche-sur-Yon et surtout le champ des Clouzeaux où est mort le général républicain Haxo (et il est le seul à voir pris ce cliché, N°53). De plus il vient aux Lucs-sur-Boulogne et sur le site du martyre du Petit-Luc, mais il y édite une carte intitulée « La chapelle », qui ne représente en réalité que la ferme voisine ! (N°24)
 Le pré des Clouzeaux (N°53).
Le pré des Clouzeaux (N°53).
Jusqu’au N°19 il commence par classer ses clichés en plusieurs séries différentes : les alentours de Bournezeau - Chantonnay, les environs de Champagné-les-marais et La Roche-sur-Yon. C’est cette dernière catégorie qu’il poursuivra finalement, en y incluant désormais tout le département. Cette numérotation unique ne dépasse pas, à notre connaissance, le numéro 718 (avec une exception au N° 763, peut être une erreur de chiffre), qui est atteint vers l’année 1908. Ce qui fait que son œuvre en matière de cartes postales se concentre en réalité sur seulement cinq années. Dans ce domaine, cela constitue une carrière assez courte, en tous cas moins longue que celles de ses collègues du département. Il se contentera ensuite, jusqu’à la première guerre mondiale de 1914, de commercialiser les clichés précédemment réalisés.
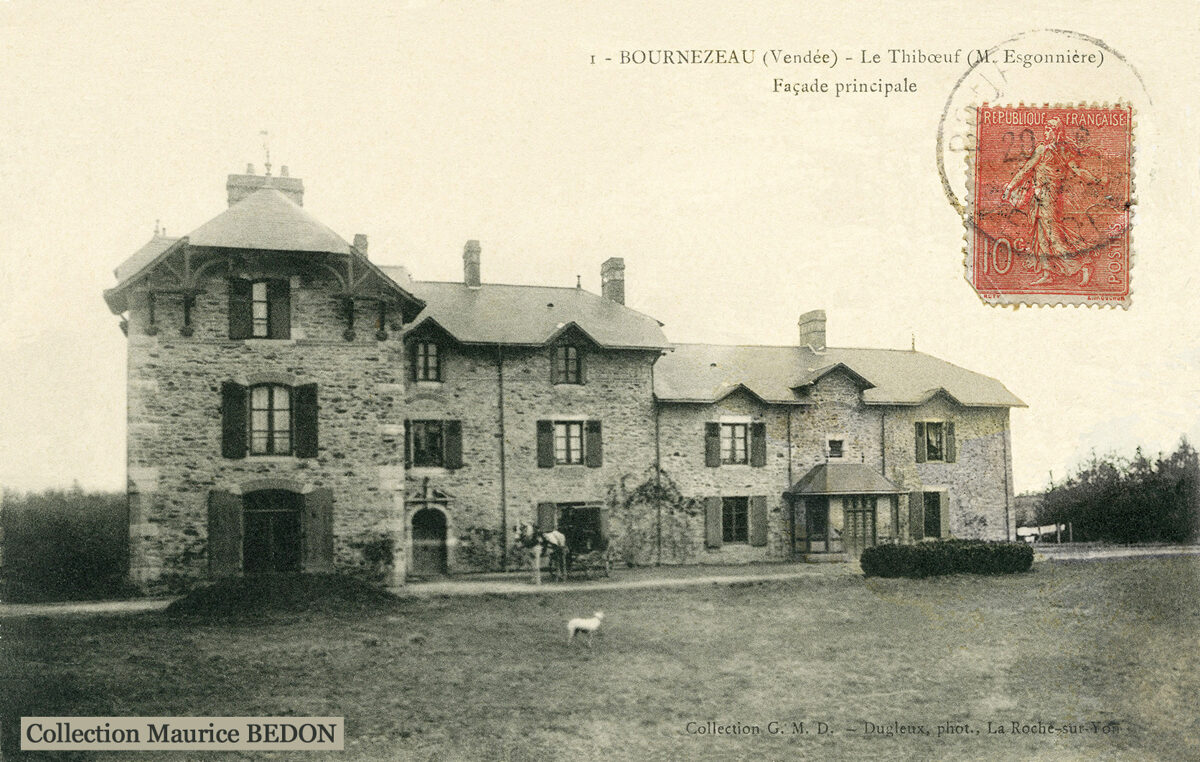 La carte N° 1 : le château du Thiboeuf.
La carte N° 1 : le château du Thiboeuf.
En plus des clichés photographiques faits par ses soins, il commercialise aussi dans sa collection « La Vendée pittoresque » des photos (celles de qualité) qu’il rachète souvent à ses collègues résidant sur place. Lucien Amiaud des Sables d’Olonne, Eugène Poupin de Mortagne-sur-Sèvre, Armand Robin de Fontenay-le-Comte, Victor Gouraud de Luçon, Robin (Papineau) de Chantonnay, Jules Denis de Clisson etc….
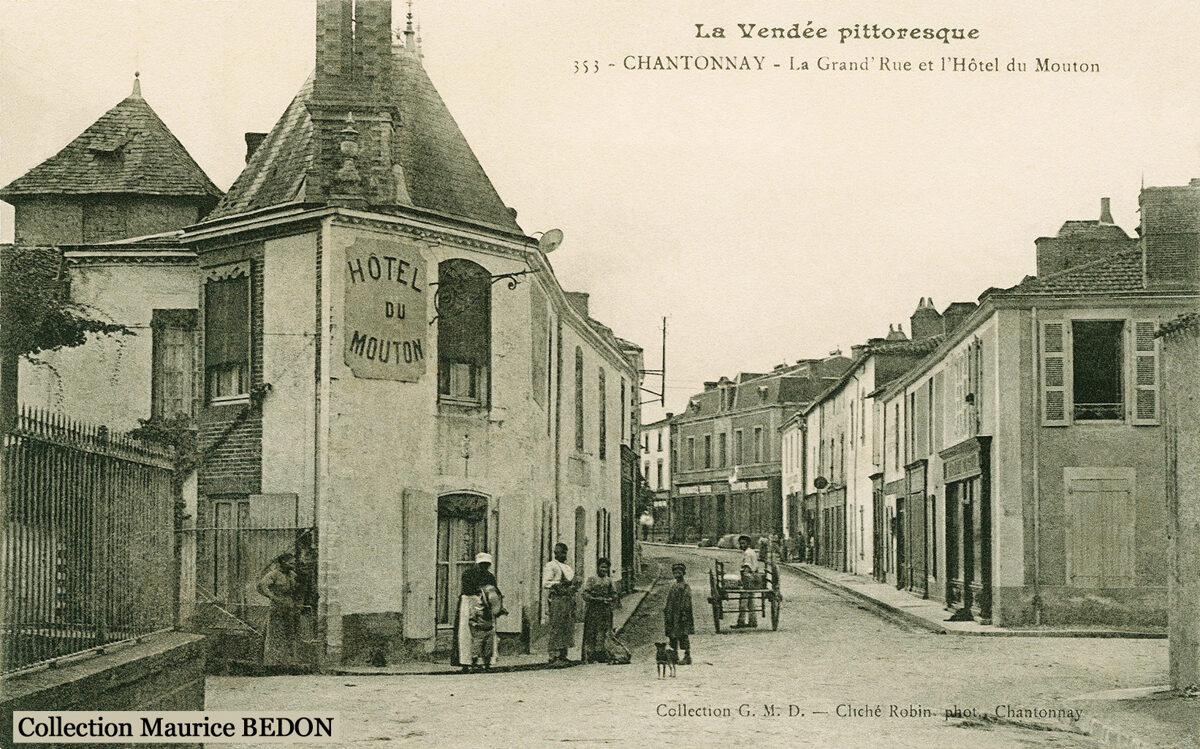
Une rue de Chantonnay, cliché Robin (N°353)
Au moment de la première guerre mondiale, en raison de son âge et de sa réforme, il n’est pas appelé aux combats mais il est tout de même incorporé à l’arrière le 21 mai 1915 et employé à des tâches à caractère commercial ou industriel, entre des périodes de sursis d’appel. Il s’installe alors à Paris 33 rue des Bois (19ème arrondissement) le 11 mai 1915. Il quitte ainsi définitivement La Vendée et ne reviendra pas s’y réinstaller. Il n’éditera plus de cartes postales. La suite de sa vie ne nous est pas connue. Il est mort à Mantes-la-jolie le 12 mars 1956.
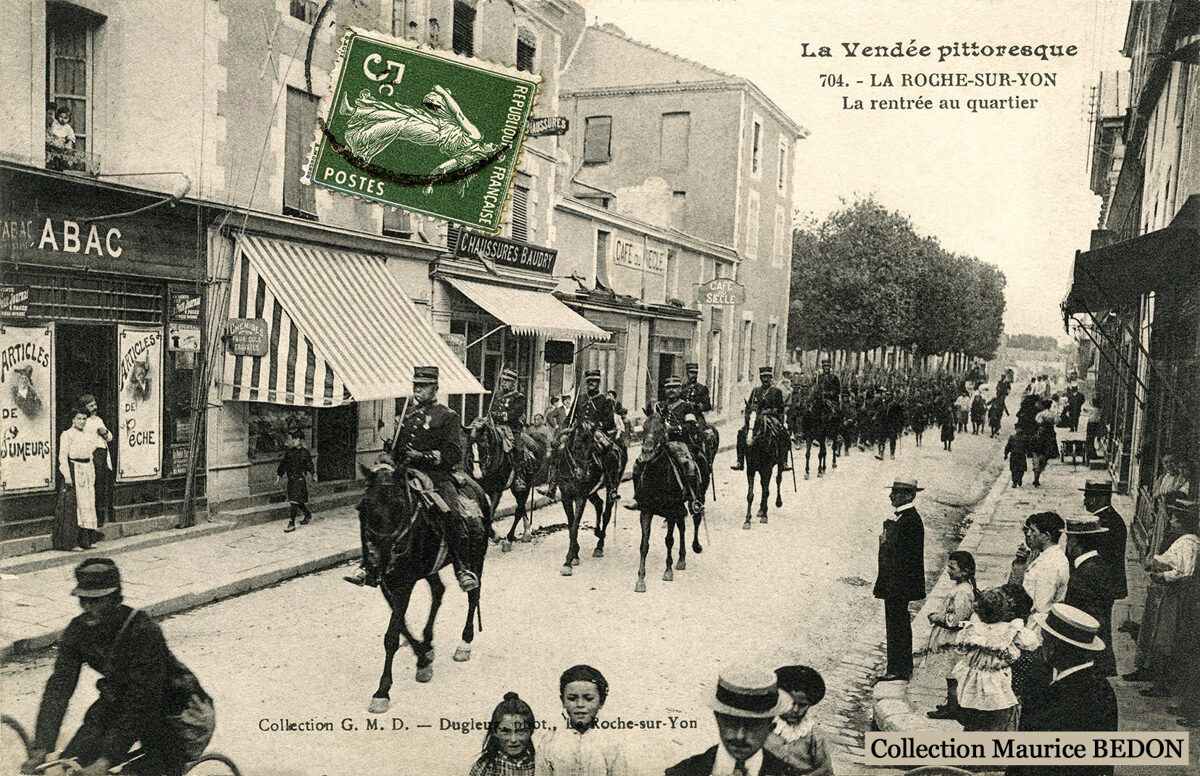
Le Régiment devant son magasin à la veille de la guerre (N°704).
La collection « Le Vendée Pittoresque » va lui survivre quelques années. Plusieurs photographes vont continuer à l’alimenter en poursuivant la même liste des numéros, mais avec des caractères d’imprimerie différents. Puis Eugène Poupin la prend en charge jusqu’à sa propre mort en 1917 et la lègue à son gendre Victor Jehly (Jehly-Poupin), qui s’en sert pour faire beaucoup de retirages successifs au-delà de la première guerre mondiale.
Chantonnay le 23 mars 2021

LE 21 JANVIER !
Nous sommes aujourd’hui le 21 janvier 2021. Il y a donc exactement 228 ans, le 21 janvier 1793 à 10 h 22 du matin que le roi Louis XVI était guillotiné à Paris sur la place de la Révolution. Cet endroit s’était d’abord appelé place Louis XV, puis place de la Révolution, avant de devenir notre actuelle place de la Concorde en 1795. Sur la gravure suivante on aperçoit d’ailleurs le socle de la statue déboulonnée.
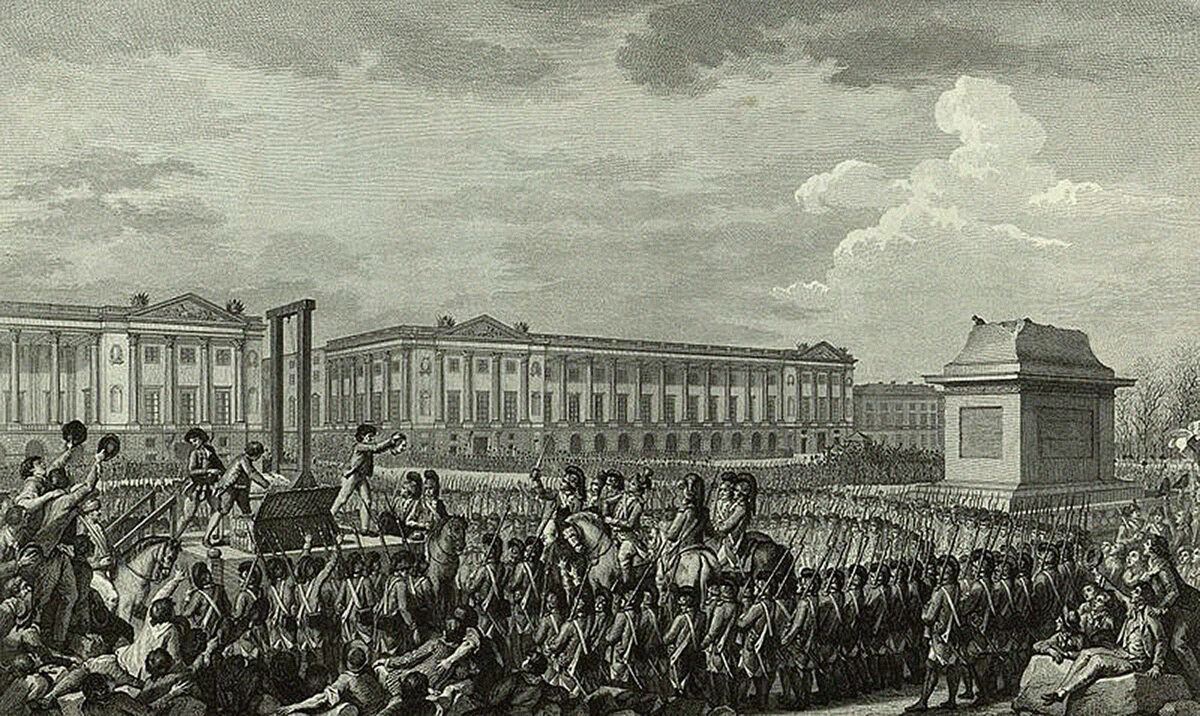 L’exécution de Louis
XVI (collection particulière).
L’exécution de Louis
XVI (collection particulière).
Cette date, 1793, importante dans notre Histoire de France, ne marque pourtant pas la fin de la Monarchie Française. Celle-ci est survenue par étapes. Louis le XVIème du nom est devenu Roy de France et de Navarre à l’âge de 20 ans par la mort de son grand père, le feu Roy Louis XV le 10 mai 1774. Les révolutionnaires lui ont retiré ce titre une première fois le 6 novembre 1789 pour ne lui laisser que celui de roi des Français. Et à la suite de l’attaque des Tuileries pendant l’émeute du 10 Aout 1792, ils l’ont aussitôt emprisonné au Temple et déchu de son dernier titre le 20 septembre suivant. Initialement, il était pourtant venu confiant demander à l’assemblée la protection qu’elle devait constitutionnellement lui offrir comme représentant le pouvoir exécutif.
Les plus enragés voulaient à tout prix une condamnation et une exécution de l’ancien monarque pour effacer tous les vestiges de l’ancien régime. C’était oublier qu’un nouvel ordre a peu de chance de rester stable, s’il a comme élément fondateur un crime politique. La culpabilité de ce meurtre Œdipien du père a laissé des traces dans notre inconscient collectif. Il constitue une des causes de certains comportements politiques collectifs, atypiques et paradoxaux que l’on trouve au sein de notre pays.
C’est dire si le jugement n’a pas été basé sur des preuves mais sur des suppositions, voire des combines, comme celle dite de l’armoire de fer. Les historiens modernes ont d’ailleurs démontré que certaines pièces étaient de faux documents fabriqués. Louis XVI une fois élimé, les montagnards auront désormais le champ totalement libre pour installer progressivement la Terreur qui sera la base de leur mode de gouvernement.
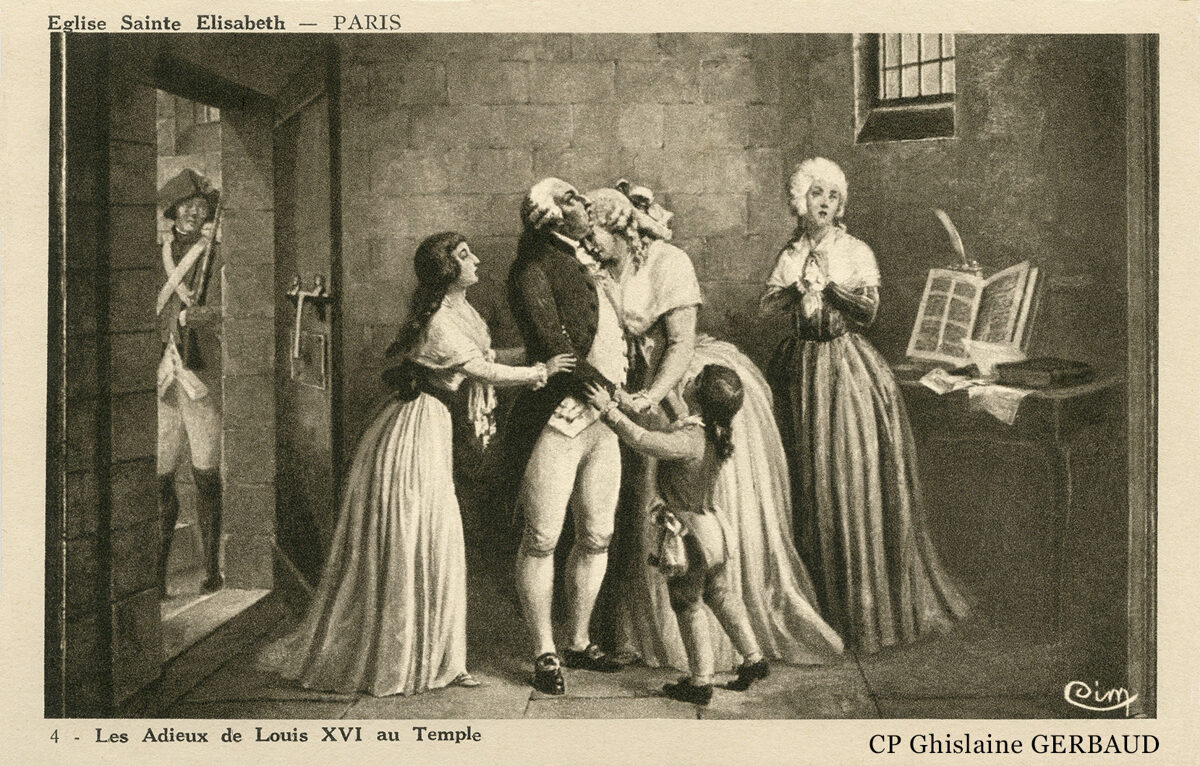 La
dernière entrevue de Louis XVI et de sa famille.
La
dernière entrevue de Louis XVI et de sa famille.
Le procès, dont le résultat était prévisible, aboutit naturellement à une condamnation à mort à la suite de votes successifs, qui s’échelonnèrent du 15 au 20 janvier 1793.
On n’accorda pas à « Louis Capet » le délai de 3 jours qu’il avait sollicité pour se préparer, on ne l’autorisa qu’à recevoir une dernière visite de sa famille.
Le 20 janvier au soir, le dîner fut servi à 19 heures. Puis Louis XVI reçut tout d’abord son confesseur avant de s’entretenir avec ses proches : la Reine Marie-Antoinette, son fils le dauphin Louis-Charles (futur Louis XVII), sa fille Madame Royale (future Duchesse d’Angoulême) et sa sœur Madame Élisabeth de France. Ceux-ci se retirèrent à 23 heures et le roi se coucha à minuit et demi.
Le lendemain matin le roi est réveillé à 5 heures par son valet de chambre Cléry. A 6 heures il assiste à la messe célébrée par son confesseur l’abbé Henri Edgeworth de Firmont et reçoit le Saint Viatique des mourants. A 8 heures, Antoine Santerre vient le chercher au Temple. Il est emmené dans la voiture à cheval du Maire de Paris Nicolas Chambon et quitte la tour du Temple à 9 heures. On se souvient que durant le trajet, Louis XVI, isolé de tout depuis des mois, demandera : « A-t-on des nouvelles de Monsieur de La Peyrouse ? » (navigateur parti en mission et jamais revenu).
Le cortège arrive sur la place à 10 heures 15 où a été construit l’échafaud, haut de 2 mètres, peint en rouge et entouré de 20 000 hommes de troupe. Et Louis XVI retire sa redingote marron, puis les aides du bourreau Henri Sanson lui coupent les cheveux, le col de la chemise puis lui lient les mains. Il donne alors son sceau portant les Grandes Armes de France à son confesseur pour le remettre à son fils, son alliance pour la donner à sa femme et son testament. Il ne conserve symboliquement que l’anneau du sacre.
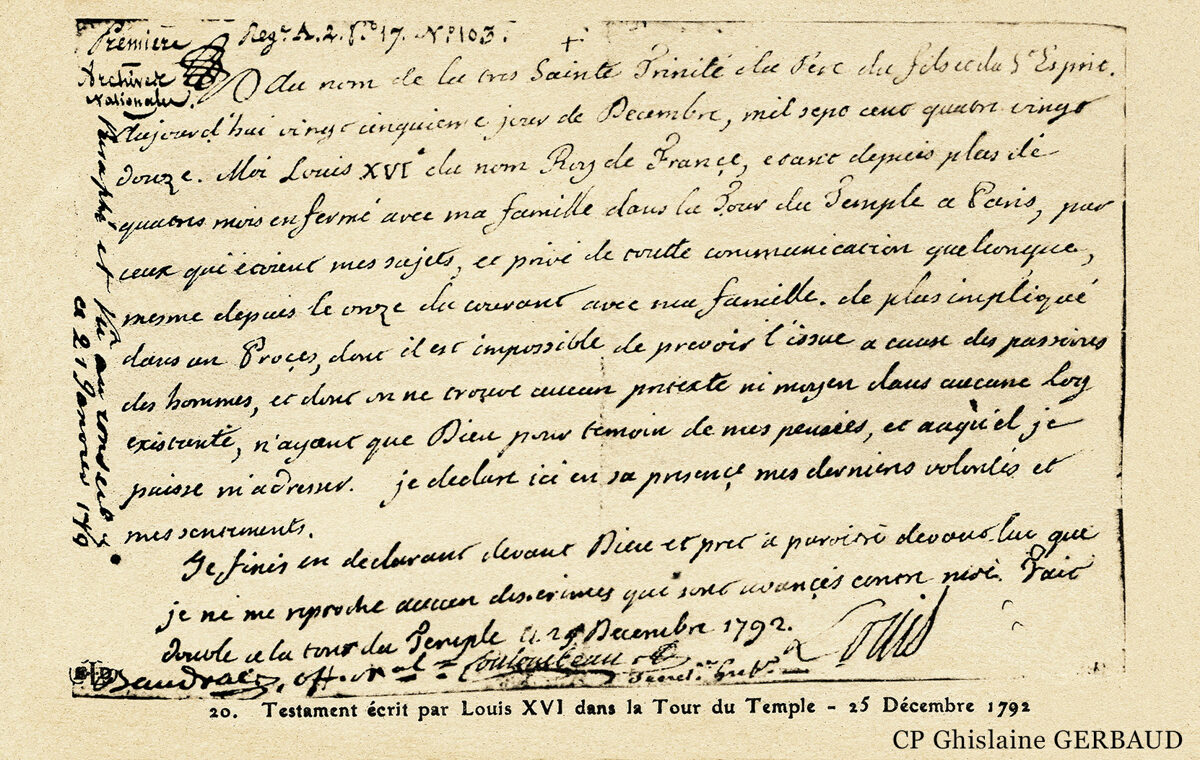 Photo
d’un extrait du testament de Louis XVI.
Photo
d’un extrait du testament de Louis XVI.
Ce testament avait été rédigé quelques temps plus tôt le 25 décembre 1792. Les phrases les plus importantes sont évidemment les suivantes :
« Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont faits mes ennemis sans que je leur en ai donné aucun sujet et je prie Dieu de leur pardonner, de même que ceux qui par un zèle malentendu m’ont fait beaucoup de mal », et
« Je recommande à mon fils, s’il avait le malheur de devenir roi, de songer qu’il se doit tout entier au bonheur de ses concitoyens, qu’il doit tout oublier, toutes les haines et tous les ressentiments ».
Mais l’ensemble du document révèle un grand chrétien qui fait montre d’une foi profonde et d’une rare élévation d’esprit. On comprend ainsi que pour être fidèle au serment de son sacre, il se soit toujours refusé à des répressions militaires contre ses sujets qui lui auraient pourtant permis de sauver sa vie et celle de sa famille. Cette âme si souvent décriée mériterait pourtant de figurer parmi celles des martyrs chrétiens.
Louis XVI s’avance alors en bord de la plate forme pour s’adresser à la foule :
« Je meurs innocent de tous les crimes qu’on m’impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort et je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe pas sur la France ».
Pour l’empêcher de poursuivre son ultime déclaration, on fait battre longuement les tambours qui couvrent ainsi sa voix. Peu après on entend le bruit sinistre du couperet retombant sur le socle. « Le Roy est mort,……….. ».
 Le
tombeau de Louis XVI à la basilique de Saint-Denis.
Le
tombeau de Louis XVI à la basilique de Saint-Denis.
Le corps de Louis XVI est emmené dans une charrette de bois et inhumé au cimetière de la Madeleine. On a pris la peine de l’enterrer plus profondément que les six pieds sous terre réglementaires (qui se sont perpétrés dans l’actuel 1,80 mètre) pour éviter les profanations, de le recouvrir de chaux, et de placer la tête à ses pieds. Des signes qui permettront d’identifier le corps plus tard.
En effet, à l’époque de la Restauration, son frère le nouveau Roy Louis XVIII, a fait placer les restes royaux à la basilique de Saint-Denis nécropole des rois de France et l’année suivante, a fait réaliser sa statue agenouillée sur un prie Dieu par le sculpteur Edme Gaulle.
 Messe
de Requiem dite traditionnellement à la mémoire du Roy Louis XVI.
Messe
de Requiem dite traditionnellement à la mémoire du Roy Louis XVI.
Depuis le début du XIXème siècle, il était d’usage dans certains milieux monarchistes de s’habiller en noir le jour du 21 janvier et surtout de n’organiser aucune réception mondaine ce jour là. Cette dernière tradition était respectée dans la haute société même non monarchiste, par souci de convivialité. Elle a survécu dans le fait de ne pas manger de galette des rois le 21 janvier !

LE 16 OCTOBRE !
Nous sommes aujourd’hui le 16 octobre (2020). Il y a exactement 227 ans, le 16 octobre 1793, peu après midi, que la reine Marie-Antoinette épouse du Roy Louis XVI était guillotinée à Paris, sur la place de la Révolution (actuelle place de la Concorde).
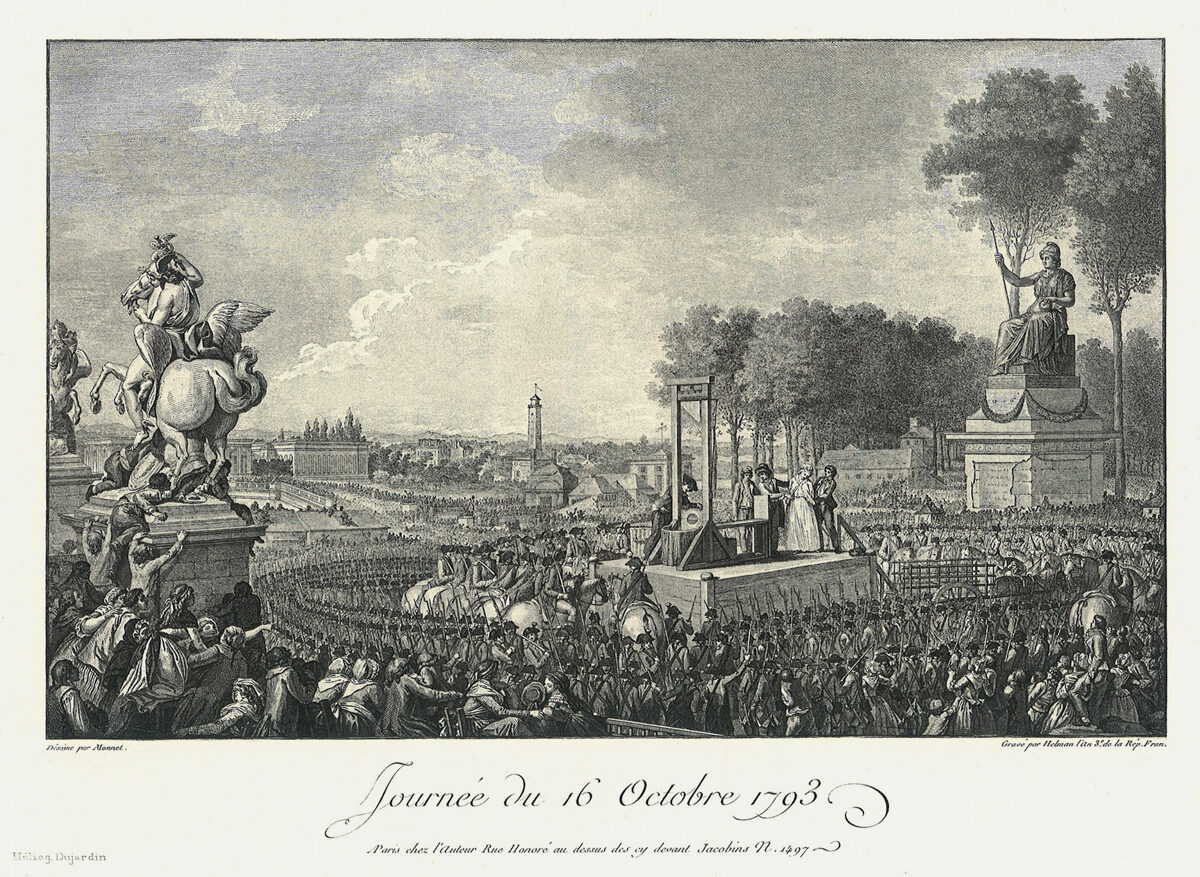 L’exécution de Marie-Antoinette (collection particulière).
L’exécution de Marie-Antoinette (collection particulière).
Il s’agit d’une date significative, puisqu’elle marque le début d’une des plus douloureuses et sanglantes périodes de notre Histoire, dite de la « Grande Terreur ». Période qui prouve que la Convention Nationale n’est décemment pas l’ancêtre de notre République et de ses principes, mais au contraire le précurseur des régimes totalitaires, aussi bien fascistes que marxistes (qui ont ensanglanté le XXème siècle). Ce n’est d’ailleurs pas, soit dit en pensant, une des moindres fiertés de la France, que d’avoir pu s’en débarrasser elle-même assez rapidement le 9 thermidor de l’an II, alors que les autres ont eu besoin du désastre d’une guerre mondiale ou d’un long naufrage économique pour pouvoir le faire !
Pour nous Vendéens, cette date annonce aussi le début du martyre pendant La Guerre de Vendée, la bataille de Cholet ayant eu lieu le lendemain 17 octobre 1793.
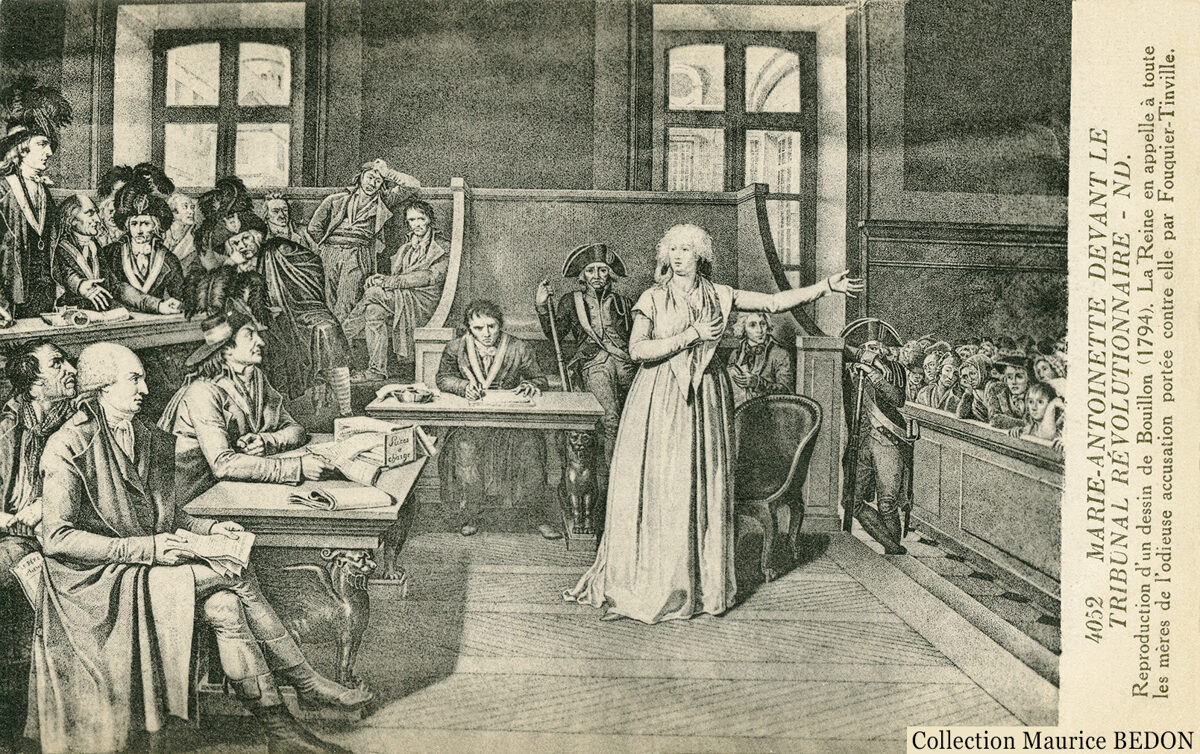
Le procès de Marie-Antoinette le 15 octobre.
Le procès et l’exécution pourraient faire l’objet de plus longs développements. Contentons nous de souligner le cynisme particulier de Robespierre. En effet, celui-ci savait que la « Veuve Capet » était atteinte d’un cancer, qui avec ses nombreuses pertes de sang ne lui laissait que deux mois à vivre environ. Aussi, il l’a fait soigner par son propre médecin et a parallèlement accéléré la tenue du procès. Sans oublier qu’il avait payé des comédiens pour insulter Marie-Antoinette sur son passage, de peur que la foule soit émue par le spectacle. Celle-ci est d’ailleurs restée silencieuse.

Le
chapelet utilisé par Marie-Antoinette à la prison de la Conciergerie.
(Collection
Particulière)
La reine avait, par avance, répondu à toutes les humiliations qu’on a voulu lui infliger, dans la dernière lettre qu’elle a écrit à sa belle-sœur Madame Élisabeth :
« C’est à vous, ma sœur, que j’écris pour la dernière fois. Je viens d’être condamnée non pas à une mort honteuse, elle ne l’est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre frère….… J’ai un profond regret d’abandonner mes enfants, vous savez que je n’existais que pour eux. Recevez pour eux deux, ici, ma bénédiction….. »

LUCIEN AMIAUD, ÉDITEUR DE CARTES POSTALES
Lucien AMIAUD n’est pas le premier photographe vendéen (c’est peut-être Jules Robuchon), ni la première personne à avoir édité des cartes concernant le département (c’est Daniel Neurdein de Paris « ND Phot » en 1893). En revanche il est le premier photographe vendéen à avoir édité des cartes postales, et ce en 1897.
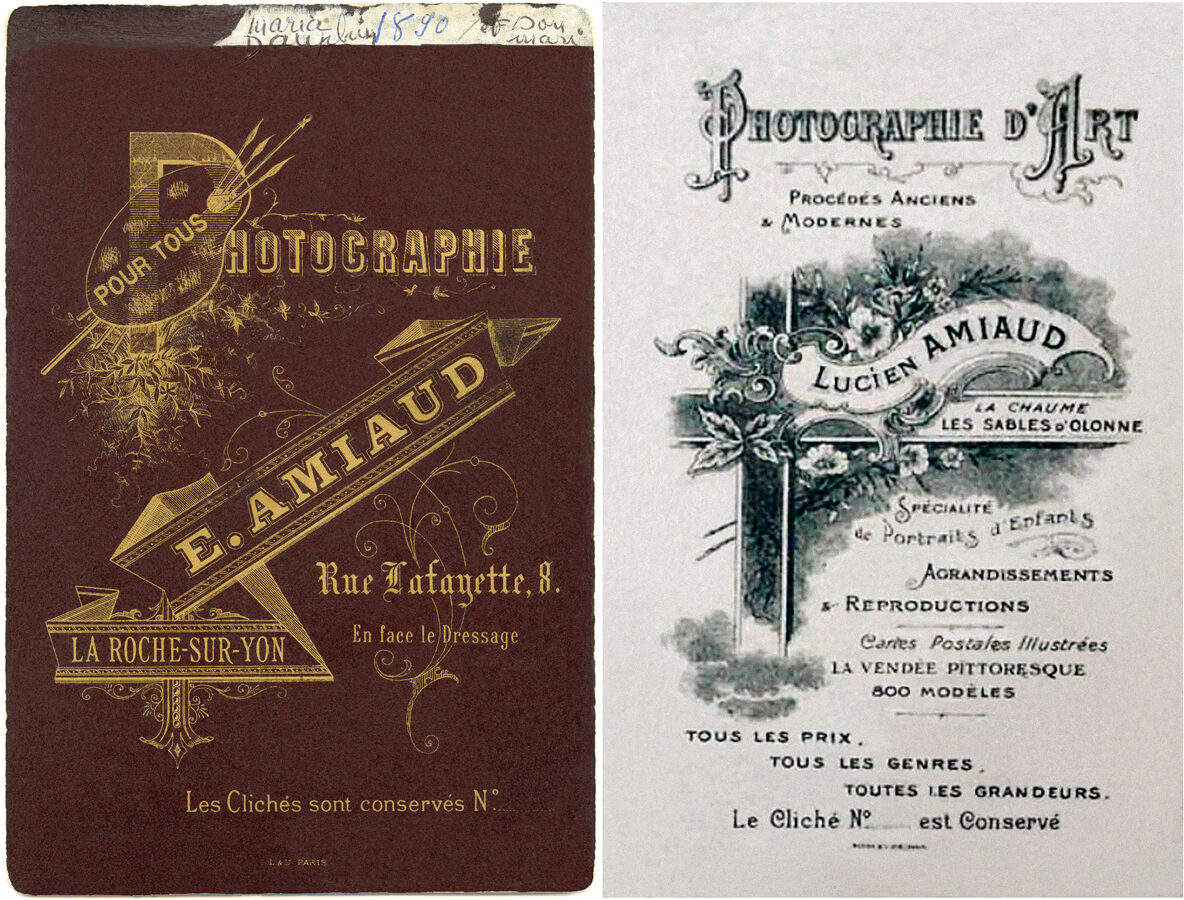 Les
décorations figurant au verso des photos faites par Émile
Amiaud le père et Lucien Amiaud le fils.
Les
décorations figurant au verso des photos faites par Émile
Amiaud le père et Lucien Amiaud le fils.
Il est issu d’une famille de La Roche-sur-Yon, son grand-père a exercé les professions d’aubergiste et de couvreur dans cette ville. Son propre père (Charles) Émile Amiaud (1848-1922,) après avoir fait son apprentissage de photographe chez Benjamin Troler rue de Bordeaux, s’était installé à son compte en 1866, âgé seulement de 18 ans. Son atelier se trouvait primitivement au N° 8 puis au N°10 de la rue Lafayette (en face du Manège pour les chevaux), rue parallèle à la rue des Sables (actuelle rue Georges Clemenceau) à peu de distance de l’Hôtel de Ville. L’année suivante, en 1857, il avait épousé Louise Merlaud.
Lucien Paul Émile AMIAUD est leur fils aîné et il naît le 9 décembre 1873 à La Roche-sur-Yon. Il aura par la suite deux frères et une sœur : Émile (1875-1921) peintre décorateur, Louise qui épouse Louis Dedieu (1876- ?) et René (1889-1968) photographe aux Sables-d’Olonne.
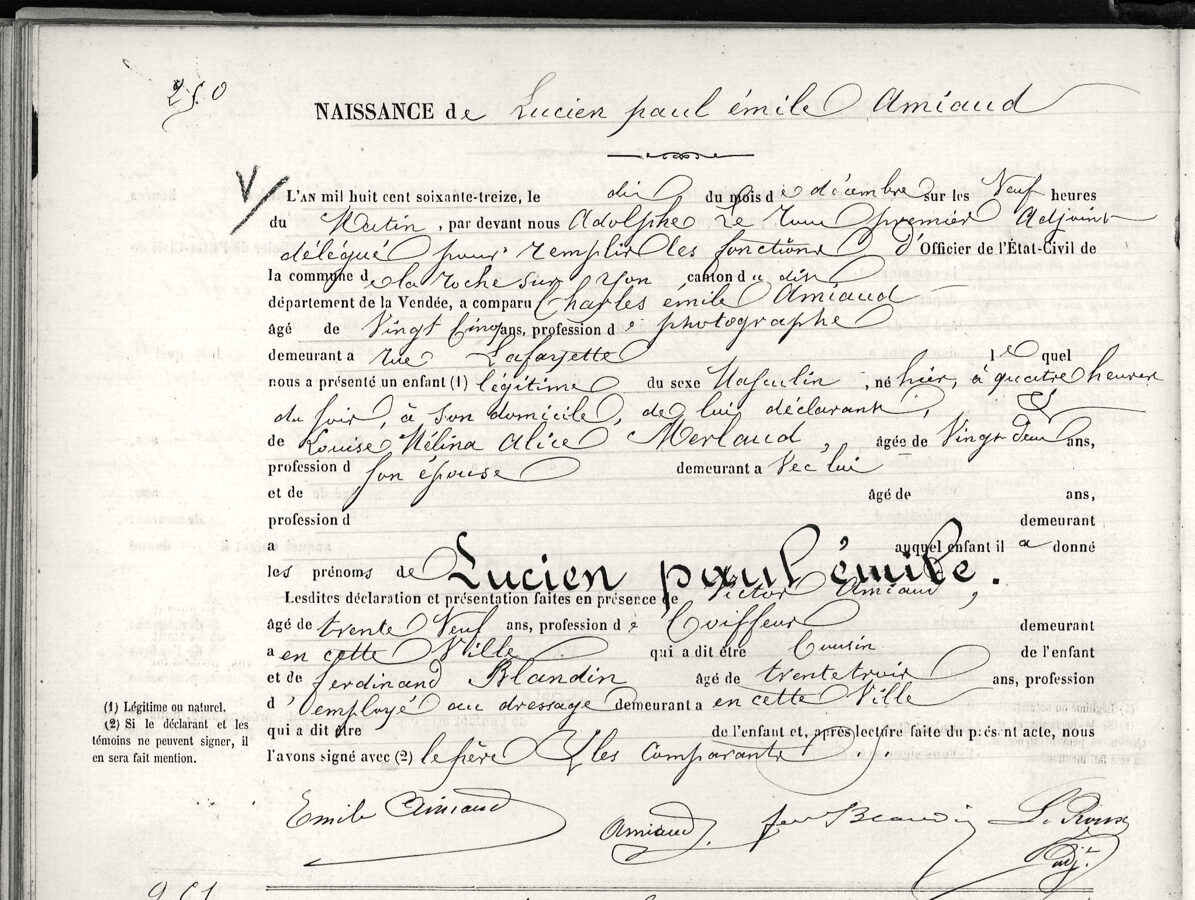 Acte
de naissance de Lucien Amiaud (Archives Municipales).
Acte
de naissance de Lucien Amiaud (Archives Municipales).
Lucien Amiaud fait ses études primaires puis secondaires à l’Institution catholique dite de Mirville qui était située sur l’actuel Boulevard des Belges (elle a été remplacée ensuite par le collège Richelieu, qui a lui-même déménagé plus tard au Bourg-sous-la-Roche).
Il restera toujours très attaché à cet établissement où il reviendra en 1900 pour faire un premier reportage photo assez complet (façades, réfectoire, ateliers, recréation, musique etc…). Il y retournera l’année suivante pour de nouveaux clichés sur les spectacles scolaires et les élèves acteurs. Il en tirera deux séries de cartes postales : 341 à 350 d’une part et 380 à 397 d’autre part.
 Le Réfectoire de
l’Institution Mirville (N°345).
Le Réfectoire de
l’Institution Mirville (N°345).
Vraisemblablement après le brevet, en 1888 à l’âge de 15 ans, Lucien Amiaud entre en apprentissage de photographe chez son père. Il s’y fait immédiatement remarquer par son aptitude et son intérêt pour le métier. Aussi son père lui confie rapidement des responsabilités. Comme ce dernier à deux succursales, l’une aux Sables-d’Olonne et l’autre à Luçon il y envoie régulièrement son fils. Ainsi, en 1891 à l’âge de 18 ans, il lui confie celle des Sables durant la saison d’été. Il s’en sort parfaitement bien sur le plan professionnel mais, ce que son père n’avait pas prévu, il fait la connaissance d’une jeune fille de 17 ans « gagée » comme domestique : Marie (Philomène) Vincent. Ils se sont souvent revus, si bien que la jeune fille attend bientôt un enfant. Il va aller naître dans la discrétion chez les propres parents de sa mère, à Mareuil-sur-Lay, le 8 mars 1892, sous le nom de Maximin Vincent. Il n’est pas sûr que la famille Amiaud ait été alors réellement mise au courant de l’évènement.
Pour Lucien, il est temps de penser aux affaires militaires. Lors du Conseil de Révision de 1893, il est jugé apte mais dispensé comme exerçant un métier artistique, celui de lithographe. Mais il est tout de même incorporé le 13 novembre 1894, année de sa majorité. Toutefois, son métier intéressant l’armée, il est incorporé au 93ème régiment d’infanterie à la caserne du château (actuelle cité Travot) à La Roche-sur-Yon (c'est-à-dire à moins d’un kilomètre de son domicile). Ce qui lui permettra d’avoir facilement des permissions et de retrouver sa petite amie. Il a terminé la période principale de son service militaire le 24 septembre 1895, mais il est appelé ensuite plusieurs fois pour des périodes d’exercices et notamment du 28 août au 19 septembre 1897. Et c’est durant ce temps que surgit un problème.
Sa petite amie se trouve de nouveau enceinte en 1897 ; mais cette fois-ci la famille Amiaud va prendre les choses en main. Marie Vincent vient accoucher à La Roche-sur-Yon le 8 septembre 1897 d’un fils dénommé Lucien Louis Robert Amiaud, car son père, âgé de 24 ans et désormais majeur, a pu le reconnaître. Toutefois la famille, qui excluait déjà le mariage quand ils étaient mineurs, le refuse toujours, selon l’expression de l’époque pour « inégalité de situation ». Lucien, dépendant encore financièrement de ses parents, doit s’incliner.
Il est finalement démobilisé peu après, en novembre 1897.
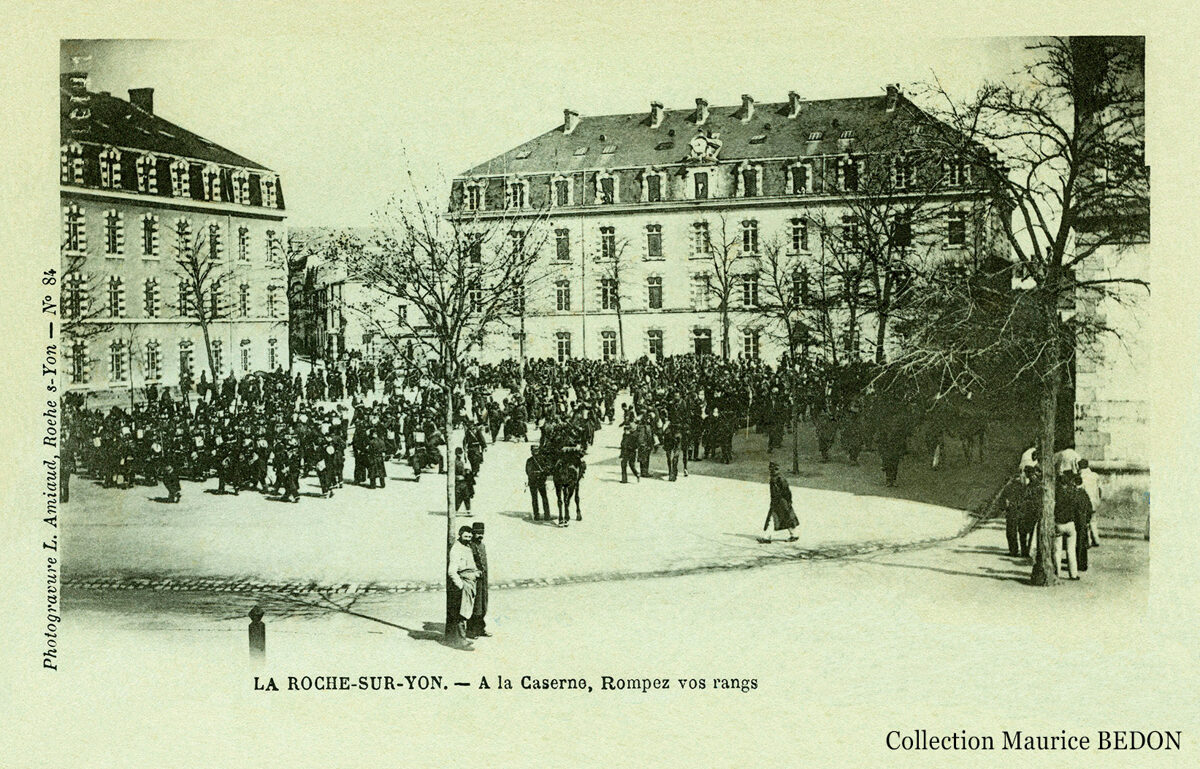 Dans la cour de la Caserne de La Roche. (Photogravure L.
Amiaud N°84).
Dans la cour de la Caserne de La Roche. (Photogravure L.
Amiaud N°84).
Il va conserver ensuite de nombreux liens avec la caserne et ses soldats. Ce qui explique qu’on retrouve régulièrement les différents aspects de la vie militaire dans ses clichés : aux numéros 04, 84, 229, 230, 298, 491, 499, 1628, 2351, 2373, 2374, 2400, 2406. Il immortalise ainsi : les parades dans la caserne à La Roche, l’arrivée des marches, le retour des exercices de tirs, le camp de manœuvres aux Sables etc…
Dès son retour à la vie civile, il recommence à travailler avec son père et dans les locaux de ce dernier, mais il s’est lancé à titre personnel et depuis le début de l’année dans l’édition de cartes postales. On peut dater ses premières réalisations et donc les premières cartes postales vendéennes de 1897. Il est probable qu’il en avait eu l’idée pendant son séjour à la caserne en voyant, dans le courrier, apparaître ces petits cartons venant d’autres départements.
Cette mode, qui consiste à mettre une illustration sur une petite partie du recto des cartes de correspondance, est venue d’Autriche et a commencé à se développer en France, timidement d’abord, après l’exposition universelle de 1889. A l’époque toute la partie verso était réservée à l’adresse. Le cliché n’occupait que le franc canton du recto, c'est-à-dire le quart en haut à gauche. Les trois quarts restants du même recto étaient utilisés par la correspondance. Ce type de cartes postales, parmi les plus anciennes, sont appelées « Cartes précurseurs en nuage » par les collectionneurs.
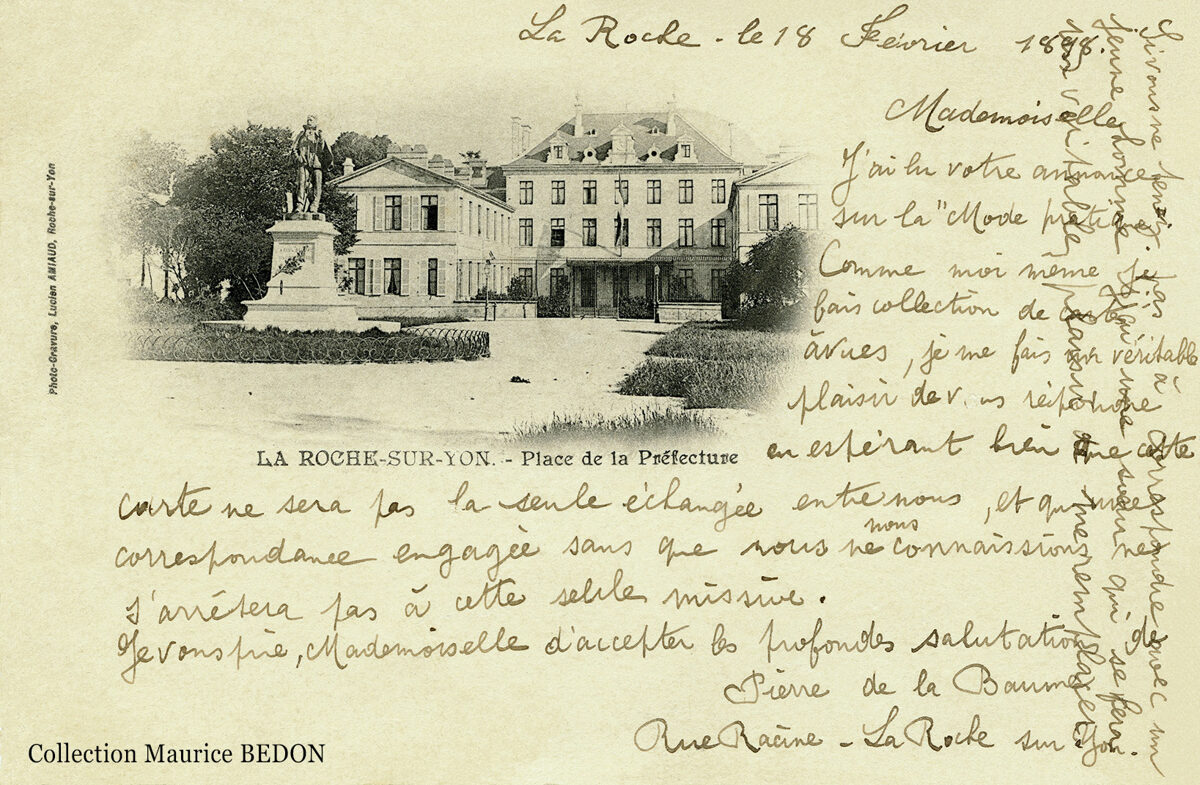 La Préfecture de La Roche-sur-Yon en 1897
(sans N°).
La Préfecture de La Roche-sur-Yon en 1897
(sans N°).
Sur ces premières cartes postales, le cliché est assez discret. Il porte le nom de l’éditeur sur le côté gauche écrit en tout petits caractères : « Photo-gravure, Lucien Amiaud, Roche-sur-Yon ». De 1897 à 1900 environ, il n’y a pas encore de numéro. C’est pour pouvoir classer et retrouver facilement les négatifs sur plaques de verre glissés dans des boites en bois aménagées, que les photographes se sont mis dans un deuxième temps à les numéroter.
L’exemplaire ci-dessus représentant la Préfecture de La Roche-sur-Yon en a été une des premières réalisations. Le cliché a été pris en 1897 et la carte a été postée en mars 1898 (par un collectionneur, déjà !).
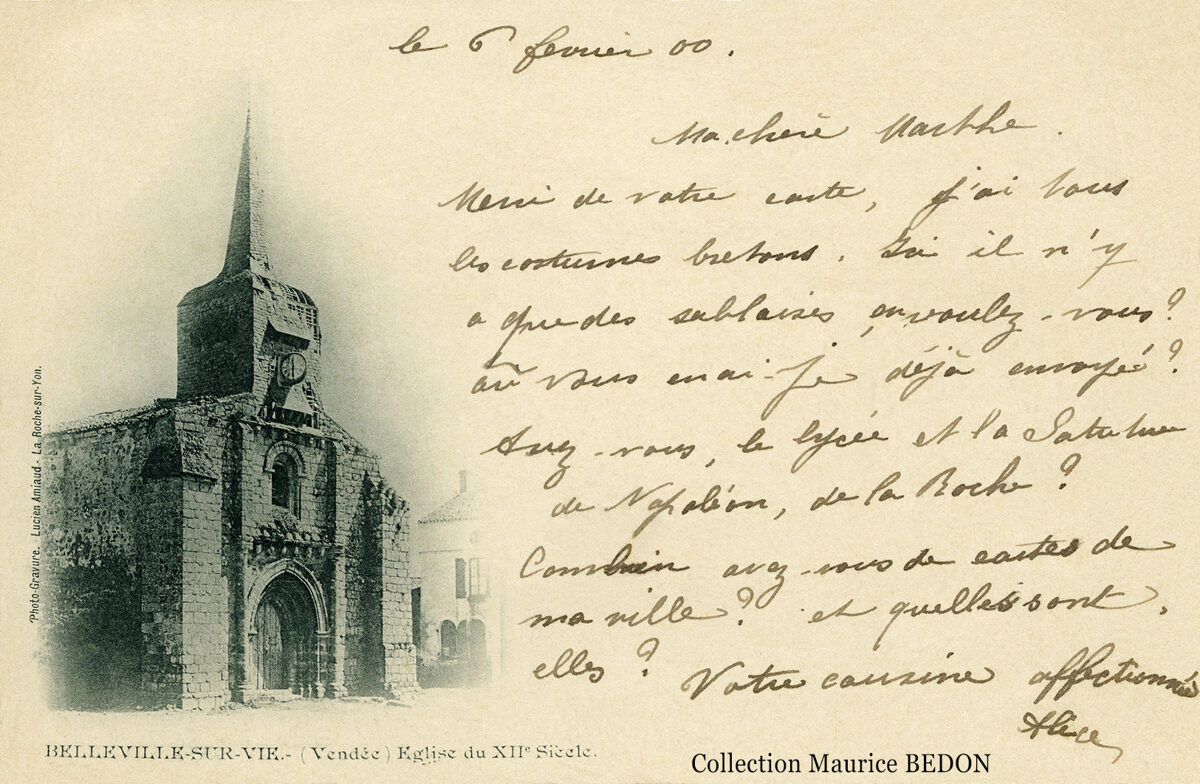 L’ancienne
église de Belleville-sur-Vie (sans N°, postée en 1900).
L’ancienne
église de Belleville-sur-Vie (sans N°, postée en 1900).
Un des principaux intérêts des œuvres de Lucien Amiaud, en début de carrière, est de nous apporter parfois les seules images d’édifices disparus. Par exemple :
- La chapelle des Ursulines à La Roche (N°6),- L’ancienne église de Belleville-sur-Vie (N°82),
- L’ancienne église de Sainte Flaive-des-Loups (N°153)
- Le château de Linières à Chauché (N°212, 323, 326, 329)
- L’ancienne église de Bazoges-en-Paillers (N°334) etc…
La carte postale reproduite ci-dessus figure également parmi les premières. Elle a été éditée en 1898 et expédiée par la poste en 1900. Elle ne porte naturellement pas de numéro, mais elle a ensuite été rééditée en 1900 et porte cette fois-ci l’inscription « Photogravure, L. Amiaud, Roche-sur-Yon, N° 82 ».
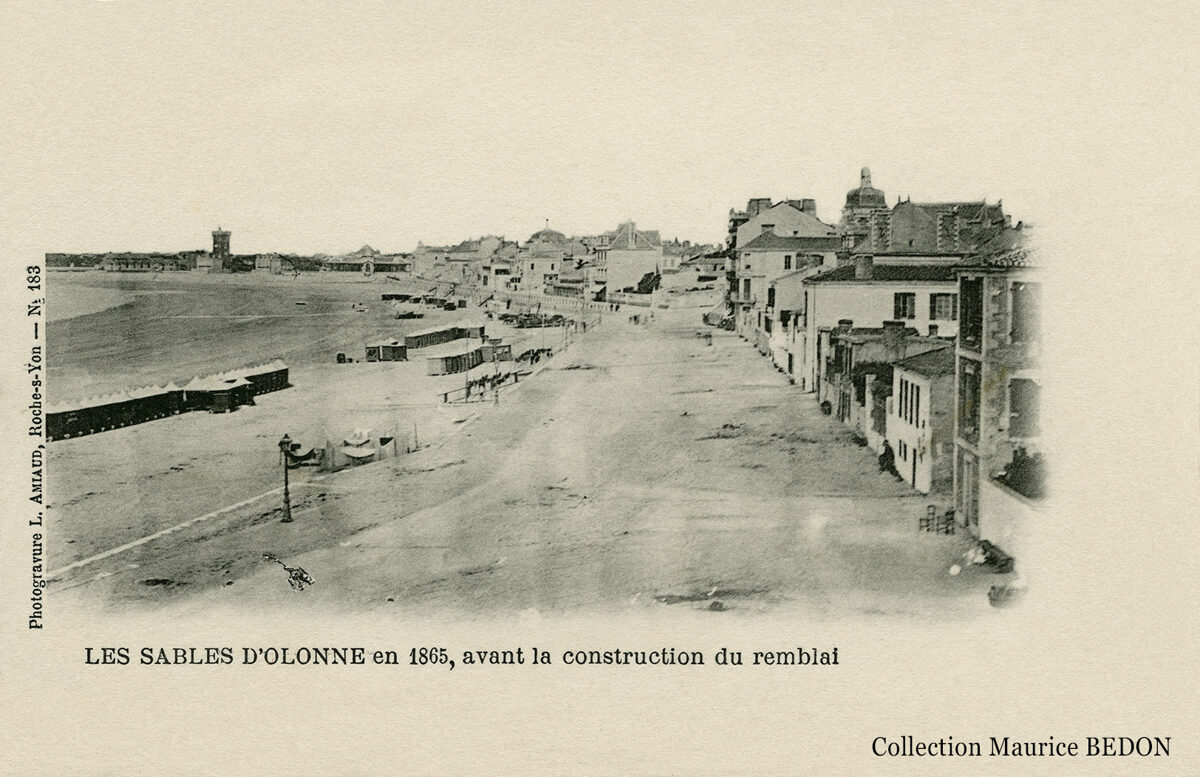 Le Remblai des Sables-d’Olonne
en 1865 (N°183).
Le Remblai des Sables-d’Olonne
en 1865 (N°183).
Pour éditer certaines cartes, il utilise parfois des plaques qui sont beaucoup plus anciennes. Ainsi, par exemple, l’image reproduite ci-dessus a été obtenue grâce à un négatif qui a du être pris par son père trente ans plus tôt. En tous cas, cette carte porte la nouvelle appellation avec le numéro (183). Elle est très intéressante car elle a été prise à l’emplacement du Remblai des Sables-d’Olonne qui n’existe pas encore vraiment.
 L’inauguration
de la statue de Luneau (N°155).
L’inauguration
de la statue de Luneau (N°155).
Dès le début de sa carrière Lucien Amiaud n’a pas voulu se contenter de photographier des édifices, des rues ou des personnalités, il s’est au contraire également affirmé comme le reporteur des évènements locaux.
Le 22 mai 1899 il va immortaliser l’inauguration de la statue élevée à la mémoire de Sébastien Désiré Luneau, ancien député de la Vendée et considéré par ses dons comme le bienfaiteur de l’enseignement primaire public. La statue, réalisée par Victor Falcondis professeur au lycée, est élevée dans la cour d’honneur de l’École Normale d’Instituteurs (au N° 156 de l’actuel boulevard Louis Blanc).
Son cliché (N°155) représente en fait la rencontre des personnalités, Préfet et Officiers militaires avant l’inauguration proprement dite. On remarquera que sur cette photo, comme sur la précédente, l’image occupe de plus en plus de place au détriment de la correspondance. Durant cette période autour des années 1900, Lucien Amiaud utilise pour ses tirages alternativement du papier légèrement beige, rosé ou vert comme sur l’exemple ci-dessus.
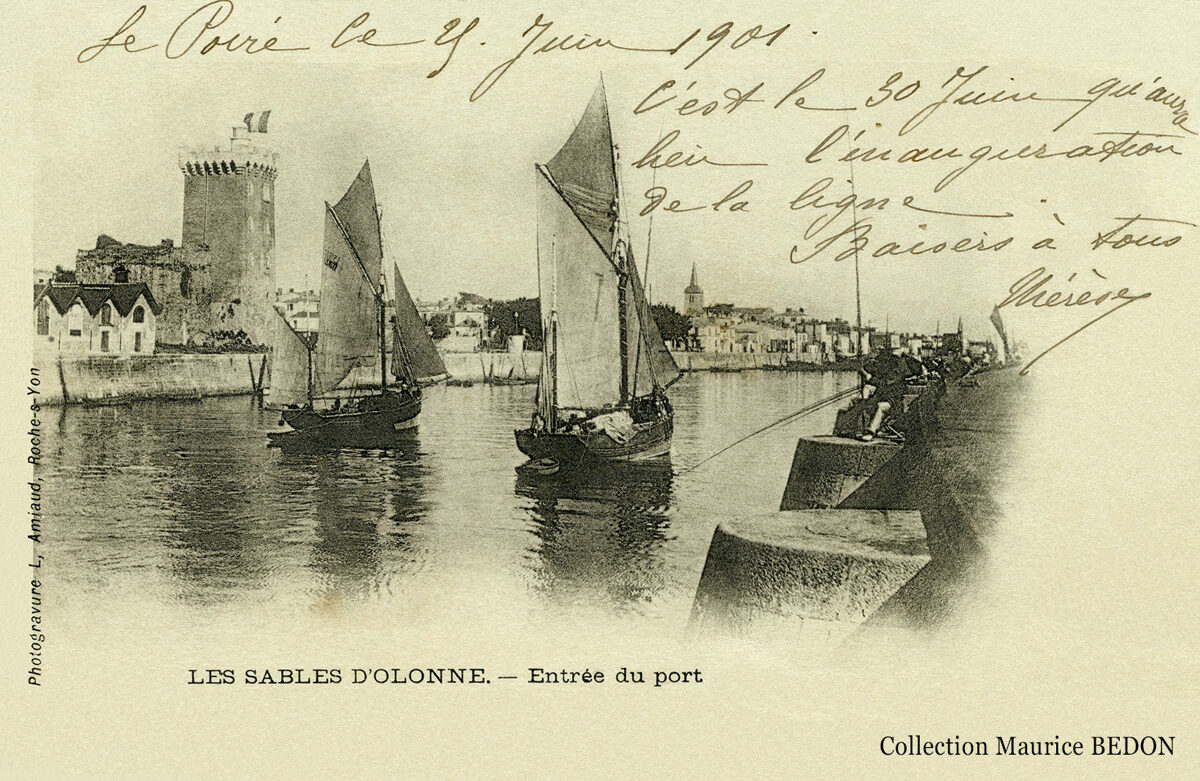 L’entrée du Port des
Sables-d’Olonne (N°114).
L’entrée du Port des
Sables-d’Olonne (N°114).
De toutes les cartes postales qu’il a éditées, certaines ont eu plus de succès que d’autres. On peut le savoir facilement car à l’époque, la réalisation étant manuelle, il en tire seulement au fur et à mesure des besoins commerciaux. La carte qu’il a constamment réédité et donc qu’il a le plus vendu est la Numéro 114 reproduite ci-dessus. Avec le port et la tour d’Arundel, elle symbolise parfaitement les Sables-d’Olonne et les deux bateaux à voile font rêver. Ce sont peut être les raisons de son succès.
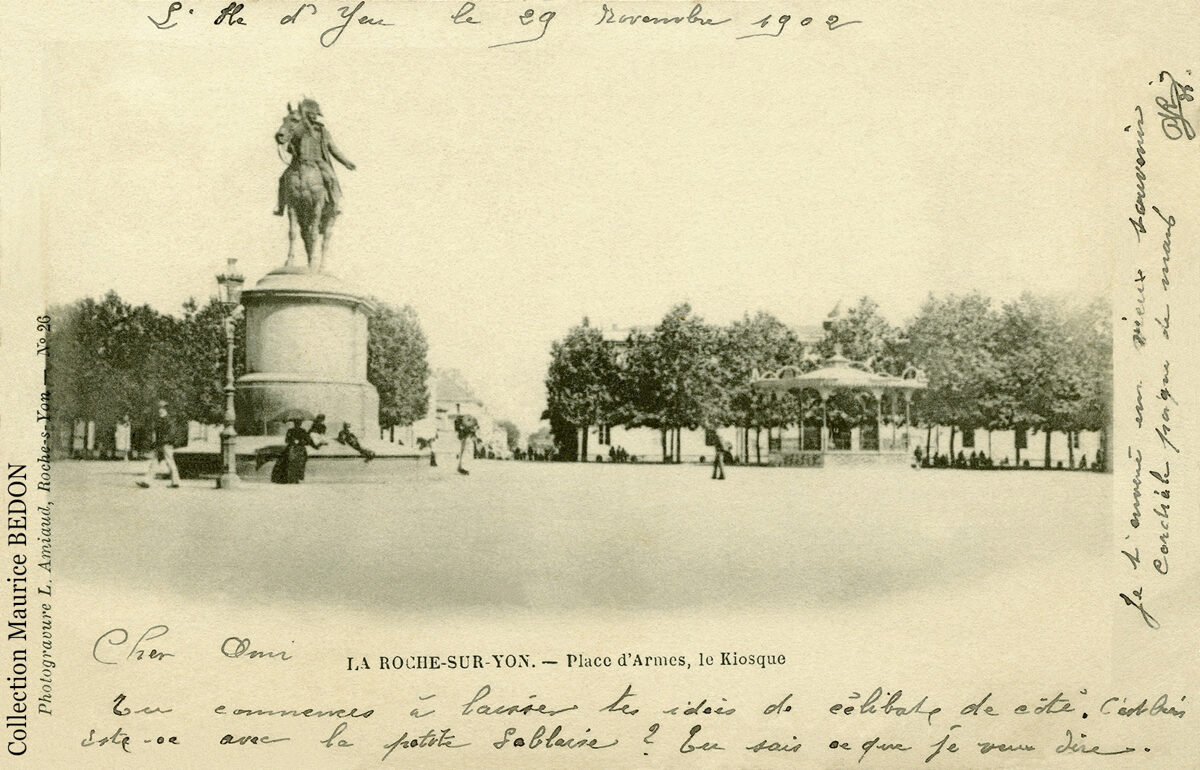 Erreur
de tirage de La Place
Napoléon à La
Roche-sur-Yon (N°26).
Erreur
de tirage de La Place
Napoléon à La
Roche-sur-Yon (N°26).
Si les cartes postales produites par Lucien Amiaud sont en général de grande qualité, il lui arrive, à lui aussi, de faire des erreurs, à moins que ce ne soit son fils en apprentissage ! Sur le document reproduit ci-dessus et représentant la place Napoléon à La Roche-sur-Yon vue de l’Eglise Saint Louis, le kiosque à musique situé devant l’hôtel de ville devrait se trouver logiquement à gauche. Or, en fait, curieusement, il est ici à droite. Ce qui prouve que le photographe a commis l’erreur de mettre sa plaque à l’envers. Cette dernière a ainsi perdu beaucoup de netteté. La carte a quand même été mise en vente, mais peu d’exemplaires ont été achetés, ce qui fait qu’elle est difficile à trouver par les collectionneurs aujourd’hui.
Comme Lucien Amiaud vient souvent aux Sables-d’Olonne pour des raisons professionnelles, il photographie aussi des Sablaises en costume traditionnel. Il le fera même de plus en plus au fil des années. Alors qu’à cette époque les photos sont toutes réalisées en noir et blanc, il est le premier à les coloriser à l’aquarelle dès 1901 (méthode qui sera à la mode plus tard, mais seulement dans les années 1950).
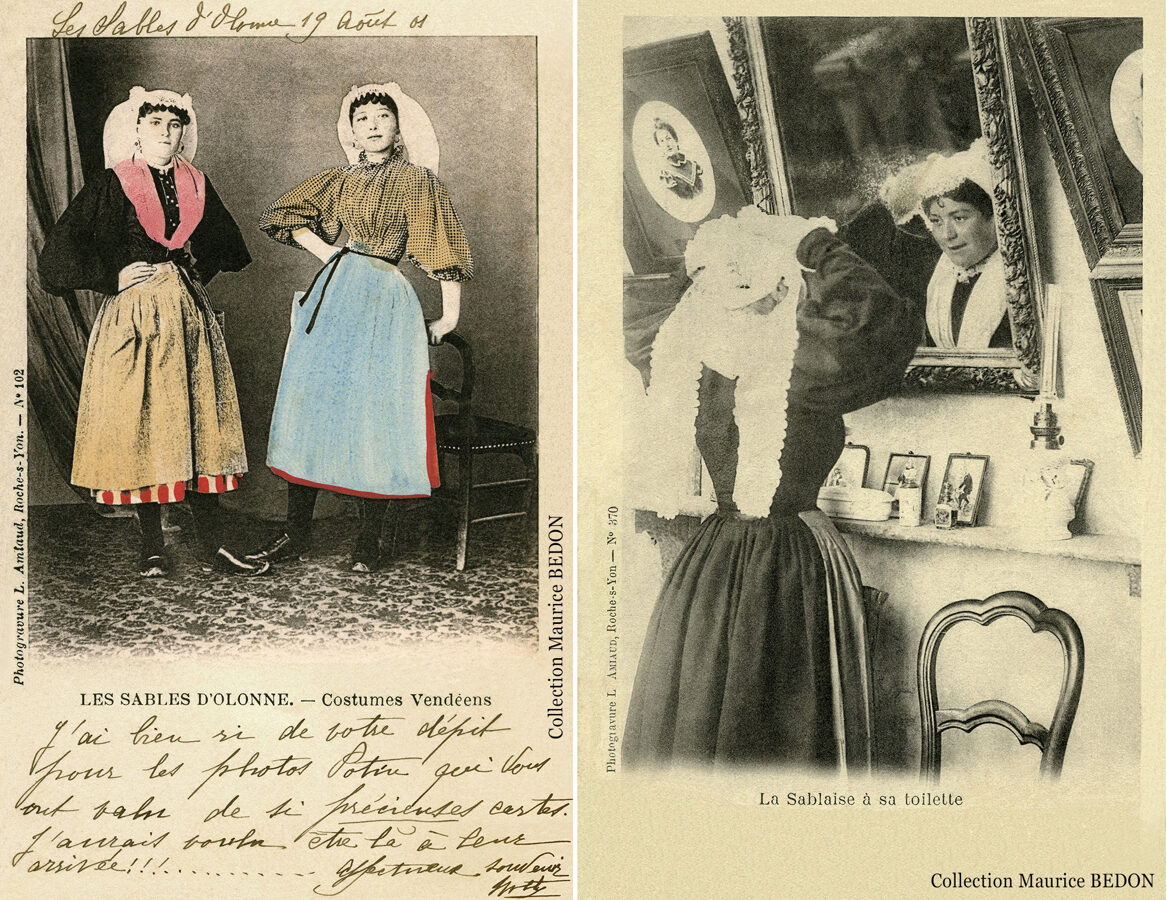 Carte
colorisée de deux Sablaises (N°102) et une
Sablaise à sa toilette (N°370).
Carte
colorisée de deux Sablaises (N°102) et une
Sablaise à sa toilette (N°370).
On se souvient qu’il avait reconnu son deuxième enfant en 1897, mais sous la pression de ses parents il n’avait pas épousé la mère. Six ans plus tard, il n’était plus aussi dépendant financièrement de ses parents et à chaque passage aux Sables-d’Olonne il revoyait Marie Vincent. Et une nouvelle fois elle allait se retrouver enceinte. Avoir un troisième enfant sans être marié, à l’époque, cela faisait vraiment beaucoup et dépassait largement les convenances. La Chaume était pourtant le bourg le plus tolérant de Vendée à ce sujet, sans doute à cause des longues absences des marins partis en mer.
Toujours est-il qu’ils décident donc de se marier tout de suite. La cérémonie a lieu le 15 juin 1903 aux Sables-d’Olonne, à la mairie annexe de La Chaume. Et le marié en profite pour reconnaître le premier enfant Maximin Vincent qui devient ainsi Maximin Amiaud. La famille Amiaud de La Roche-sur-Yon a marqué sa désapprobation en n’assistant pas à la cérémonie ; mais une réconciliation aura lieu plus tard.
Le 8 juillet 1903, Lucien quitte l’entreprise familiale de La Roche et s’installe à son compte aux Sables. L’enfant attendu naît le 17 octobre 1903 chez ses parents, installés alors chemin Saint-Antoine à La Chaume. Elle reçoit les prénoms de Louise Fernande Marie Henriette. D’ailleurs, le cliché de droite ci-dessus représenterait, parait-il, Madame Amiaud chez elle à La Chaume.
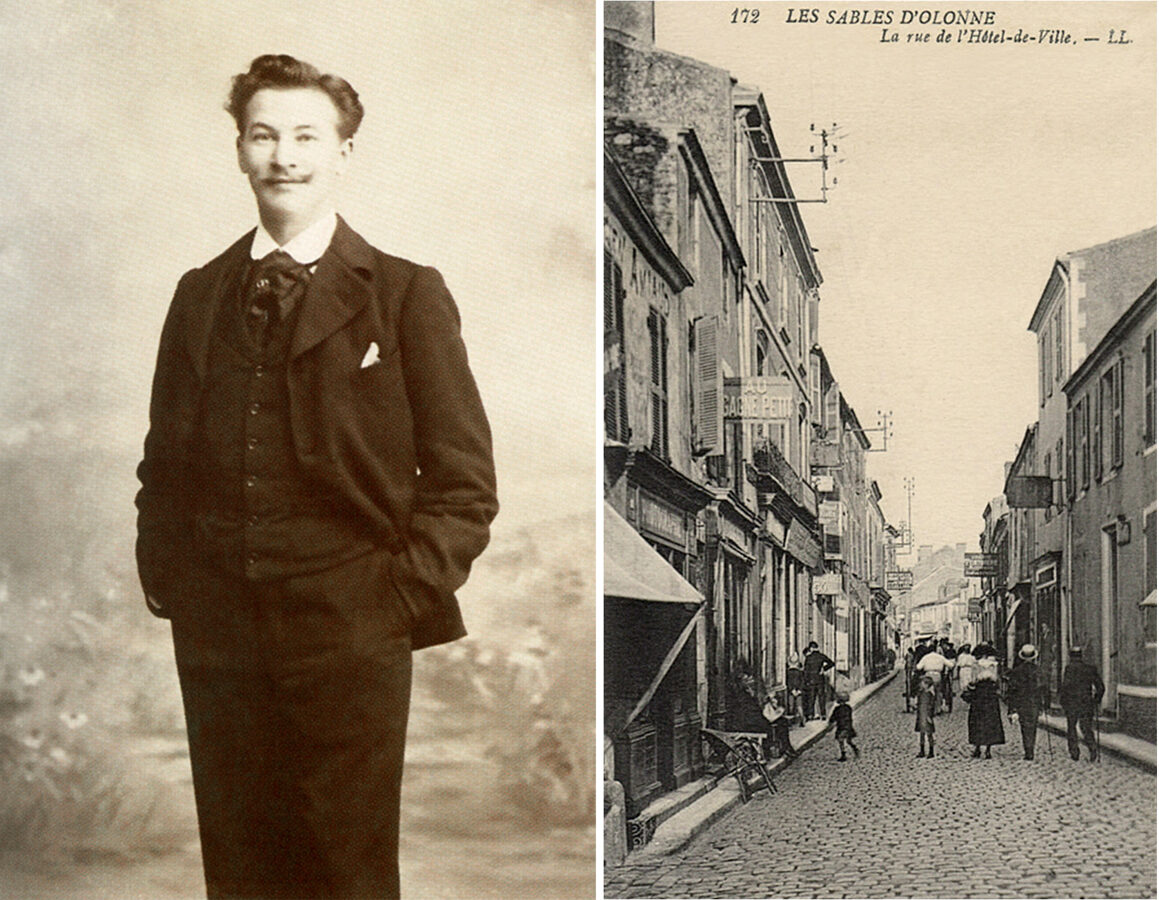 Photographie
de Lucien Amiaud et La
rue de l’Hôtel de Ville aux Sables.
Photographie
de Lucien Amiaud et La
rue de l’Hôtel de Ville aux Sables.
Il a tout d’abord installé son atelier et son magasin à La Chaume, mais il comprend vite que pour faire des affaires plus fructueuses, c’est aux Sables-d’Olonne qu’il faut être présent. Il transporte donc ses locaux dans cette ville, en essayant de se rapprocher du centre. Il trouve finalement une adresse plus prestigieuse, 18 rue de l’Hôtel de ville, dans une rue commerçante en face de la Mairie. C’est cette rue que représente la carte ci-dessus à droite, réalisée par un collègue. Le magasin Amiaud y est visible au premier plan à gauche.
Il continue bien entendu son activité de cartes postales mais l’appellation « Photogravure Lucien Amiaud -- Roche-sur-Yon » qui était arrivée aux alentours du numéro 568, a fait place à l’inscription « Collection L. Amiaud, Sables-d’Olonne ». La production totale de cartes postales aux Sables ira jusqu’à dépasser le numéro 8000. Toutefois on retrouve moins désormais le souci de sortir un document pouvant servir l’Histoire et d’avantage des préoccupations commerciales.
Peu de temps après son installation aux Sables, en décembre 1903, une instruction du Ministre des Postes va bouleverser l’aspect des cartes. Désormais l’image occupera tout le recto et le verso sera divisé en deux parties : celle de gauche pour la correspondance et celle de droite pour l’adresse. Les cartes postales d’avant cette date sont dites anciennes et les suivantes (1903-1914) appartiennent à « l’âge d’Or ».
 Une vieille maison de
Montaigu (N°225) et Le grand café aux
Sables (cliché vendu) à un collègue.
Une vieille maison de
Montaigu (N°225) et Le grand café aux
Sables (cliché vendu) à un collègue.
Durant sa carrière de photographe éditeur, il a été amené à croiser et à collaborer avec plusieurs de ses collègues du département. Il a rencontré Eugène Poupin de Mortagne-sur-Sèvre en 1901 à Montaigu. S’agissait-il d’un rendez-vous ou d’une rencontre fortuite lors d’un reportage ? En tous cas ils ont décidé de marquer cette journée, non pas d’une pierre blanche mais d’une photo évidemment. Sur celle-ci faite par Lucien Amiaud (ci-dessus à gauche) et censée représenter une maison, Eugène Poupin pose assis sur une borne à gauche au premier plan. Cette même photo figurera dans la collection Amiaud sous le N° 225 et dans celle de Poupin sous le N°232.
L’autre cliché, ci-dessus à droite, est amusant. Il a été vendu à un collègue mais en le regardant bien on aperçoit dans la glace Amiaud en train de faire le cliché.
Après son départ de La Roche pour Les Sables en 1903, Lucien Amiaud va vendre à ses collègues des plaques dont il ne désire plus assurer lui-même la commercialisation. Ainsi par exemples les cartes de :
- Montaigu vue de Mirville (Amiaud 222) va devenir (Poupin 207)- Chavagnes-en-Paillers, la grotte de Lourdes (Amiaud 211) va devenir (Poupin 2288)
- St Hilaire-de-Loulay, château de la Barilière (Amiaud 360) va devenir (Robin 1595)
- St Hilaire-de-Loulay, château de Bois-Corbeau (Amiaud 232) va devenir (Robin 1596)
- La Roche-sur-Yon, la caserne (Amiaud 84 cf ci-dessus) va devenir (Hamonnet 16)
- Les Sables-d’Olonne, le remblai (Amiaud 98) va devenir (Nouvelles Galeries 215)
- Tableau du général Cathelineau (Amiaud 247) va devenir (Ve Marsault 247 LA) etc ….
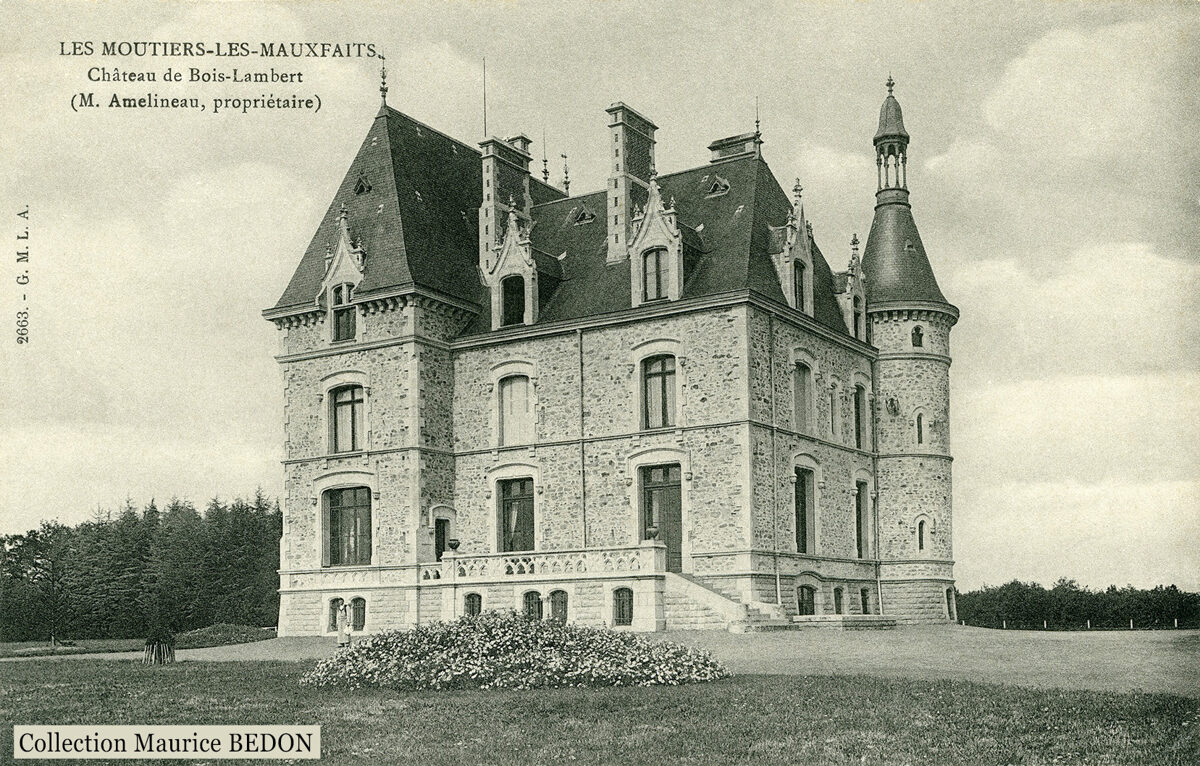 Le
château du Bois-Lambert aux Moutiers-les-Mauxfaits (G.M.L.A.).
Le
château du Bois-Lambert aux Moutiers-les-Mauxfaits (G.M.L.A.).
 Jard-sur-Mer, le
moulin et le calvaire de La
Croix (N°4016).
Jard-sur-Mer, le
moulin et le calvaire de La
Croix (N°4016).
Son fils Maximin étant en apprentissage avec lui, à la belle saison, ils partent ensemble faire des reportages photographiques au sud des Sables-d’Olonne. Ils y vont à bicyclette, à moins qu’ils utilisent la ligne de tram Les Sables - Talmond - Champ-Saint-Père pour effectuer une partie du trajet. Comme son fils est avec lui, c’est ce dernier qui prend le cliché et son père est ainsi visible sur la photo et parfois mis en scène. Nous avons de cette manière une sortie en 1907 à Talmond (N° 2161, 2162, 2163, 2164 et 2165), puis la même année à Avrillé (N°2857, 2858 et 2866) et enfin en 1910 à Jard-sur-Mer (N° 4016, 4046, 4047 et 4049). C’est sur le cliché 4016 qu’il est visible, en train de conduire sa bicyclette.
 Le château de la Jousselinière à
Chaillé-les-Ormeaux (N°2090).
Le château de la Jousselinière à
Chaillé-les-Ormeaux (N°2090).
Cédant une mode de cette époque, au cours de l’année 1905, il commence à ajouter des inscriptions manuscrites sur ses négatifs et même des motifs décoratifs. La carte postale reproduite ci-dessus et représentant le château de la Jousselinière dans la commune de Chaillé-les-Ormeaux (N°2090) est peut-être un des exemples les mieux réussis de cette pratique. Cette dernière doit quand même avoir connu un certain succès, car on retrouve encore aujourd’hui de nombreuses cartes de ce modèle. Au milieu de l’année 1906, il renonce définitivement à ce procédé.
 L’incendie de la rue
Fénelon à La Roche-sur-Yon
en 1906 (N°2106).
L’incendie de la rue
Fénelon à La Roche-sur-Yon
en 1906 (N°2106).
Comme nous l’avons déjà dit, Lucien Amiaud a toujours tenu à être le photographe des évènements. Aussi quand il a appris qu’un grave incendie était en train de ravager un entrepôt d’épicerie à l’angle des rues Fénelon et de Saumur à La Roche-sur-Yon dans la nuit du 9 au 10 janvier 1906, il s’est dépêché de venir sur place. Cela nous a valu une série de cartes postales : N°2104, 2105, 2106, 2107 et 2108.
 Manifestation
lors des Inventaires à l’église d’Olonne en 1906 (N°2110).
Manifestation
lors des Inventaires à l’église d’Olonne en 1906 (N°2110).
De la même manière il a réalisé une carte postale représentant les manifestations des catholiques opposés aux Inventaires des Églises faits par les services de l’État. Ce cliché unique a été pris à Olonne-sur-Mer en 1906.
En revanche il n’a pas fait de cartes postales, mais toute une série de photos sur une autre affaire politique dont ont été victimes les catholiques de l’époque : l’expulsion des congrégations enseignantes, comme celle des rédemptoristes aux Sables-d’Olonne (église Saint Michel).
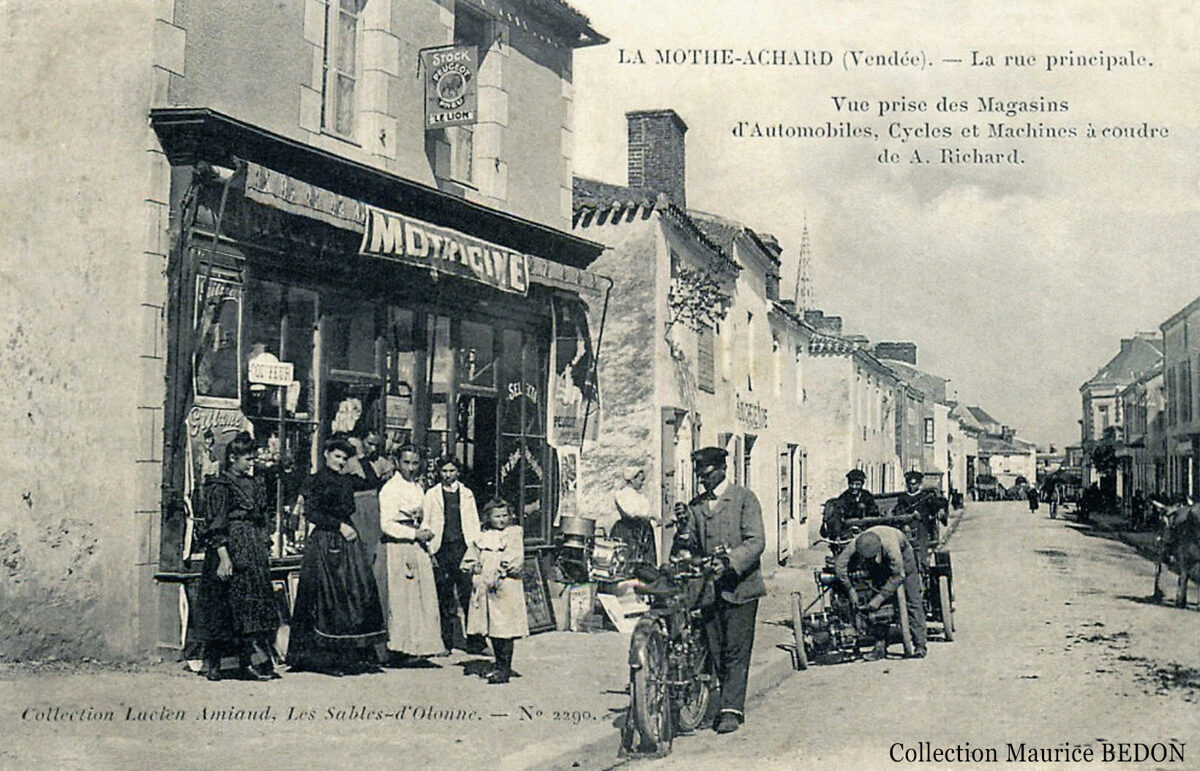 Un
Magasin de Cycles à La
Mothe-Achard (N°2290).
Un
Magasin de Cycles à La
Mothe-Achard (N°2290).
Intéressé par les techniques considérées comme d’avant-garde à l’époque, il est venu photographier en 1906 un magasin de la Mothe-Achard qui vendait et réparait des engins tout à fait improbables : une bicyclette avec un moteur, une espèce de tricycle motorisé, une automobile sans chevaux mais avec sièges en vis-à-vis. Il a ainsi produit deux cartes N° 2289 et 2290.
A partir de 1909 il décide de changer l’appellation de son entreprise sur ses cartes et inscrit désormais à la place « Nouvelle Collection Lucien Amiaud, Les Sables-d’Olonne ». Il gardera cette nouvelle dénomination jusqu’à la fin de sa carrière d’éditeur. Toutefois il n’interrompt pas sa numération qui se situait aux alentours de 3000, il la poursuit comme si de rien n’était.
C’est dans ce cadre qu’a été faite la vue des inondations de la Tranche-sur-Mer en décembre 1911 (4423) qui est reproduite ci-dessous. Pour cet évènement malheureux il a, en fait, créé toute une série de 10 cartes (N°4415 à 4424). Il avait déjà auparavant fait des reportages sur les inondations à La Roche-sur-Yon en février 1906, puis au Poiré-sur-Vie et à Saint-Mathurin en octobre 1909 (N° 2971 à 2976)
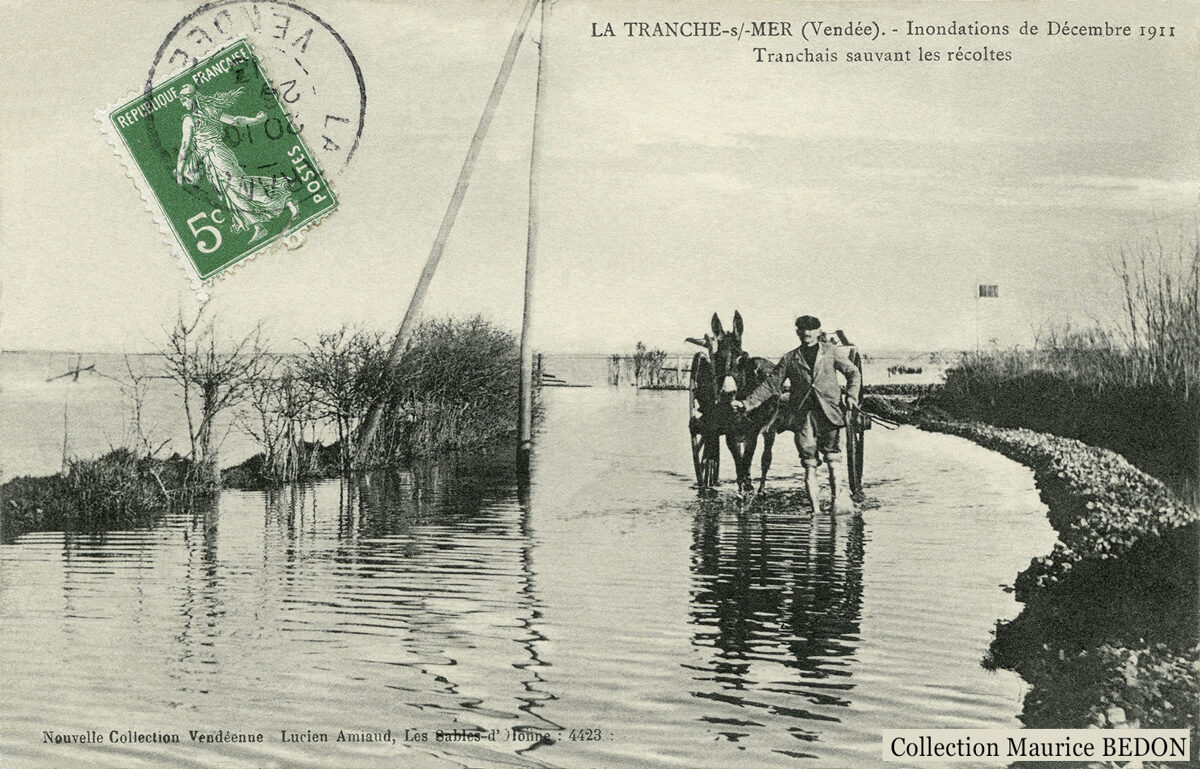 Les inondations à la Tranche-sur-Mer en
1911 (N°4423).
Les inondations à la Tranche-sur-Mer en
1911 (N°4423).
Comme des millions de français, le 3 août 1914, Lucien Amiaud doit interrompre ses activités professionnelles et partir à la guerre. Il est rattaché au 93ème régiment d’infanterie de La Roche-sur-Yon avec le grade de Sergent. Il restera sur le front français jusqu’au 24 octobre 1916, date à laquelle il est transféré sur le front d’Orient jusqu’au 4 juin 1918. Il revient alors sur le front combattant de Est jusqu’à l’armistice du 11 novembre 1918. Toutefois il ne rejoindra son foyer que le 9 janvier 1919.
Rentré aux Sables-d’Olonne, il reprendra son atelier et son magasin, photographiera en intérieur, continuera à vendre des cartes postales, mais ne repartira plus en reportage pour en produire de nouvelles. On ne lui connaît donc pas de cartes de couleur marron des années 1920-1930.
Ses enfants vont perpétrer les traditions familiales. L’aîné, Maximin Amiaud (1892-1958), sera photographe à Saint Gilles-Croix-de-Vie. Il fondra à cet endroit une véritable dynastie de photographes puisque son propre fils Lucien et son petit-fils Daniel prendront sa succession. Le cadet, Lucien Amiaud (1897-1942), en se mariant en secondes noces avec Berthe Auguin en 1922, s’installera comme photographe à Chantonnay rue de Bordeaux.
 Photo
de mariage faite par Lucien Amiaud (fils) à Chantonnay vers 1930.
Photo
de mariage faite par Lucien Amiaud (fils) à Chantonnay vers 1930.
Mais parallèlement, le dernier fils de Charles Émile, c'est-à-dire un cadet de Lucien, René Amiaud (1889-1968) est devenu également photographe. Il s’est installé aux Sables-d’Olonne sur le remblai au numéro 64 du quai Georges Clemenceau. Il aura beaucoup de succès en prêtant des costumes à ses clients pour les photographier en sablaise ou en marin.
Ce sont donc six générations de Amiaud qui, à partir de 1866 jusqu’à aujourd’hui, ont de cette manière immortalisé leurs concitoyens et La Vendée pendant plus de 150 ANS.
Chantonnay le 12 octobre 2020.

Les Inondations en Vendée vers 1900
Bien avant que l’on emploie les termes actuels de « dérèglement climatique » ou de « réchauffement de la planète », La Vendée a été victime d’un certain nombre d’inondations tout à fait catastrophiques au début du XXème siècle.
Elles sont restées célèbres grâce aux véritables reportages réalisés par les photographes de l’époque et éditées sous forme de cartes postales qui sont parvenues jusqu’à nous. Aux alentours de 1900, il était en effet fréquent de faire des séries de cartes pour toute sorte de grands évènements qui intéressaient le public. Une habitude qui est aujourd’hui totalement passée de mode. Il y a à cela plusieurs raisons :
- Tout d’abord l’alphabétisation des campagnes était à cette époque, et pour la première fois, globalement réussie. Après le Révolution de 1789 et les destructions des colonnes infernales en 1794, il avait fallu plus de 40 ans pour retrouver le niveau d’instruction du XVIIIème siècle en zone rurale. Mais, à la fin du XIXème siècle, sous l’impulsion de l’État, les enseignements publics et privés avaient fait le maximum pour parvenir à ce but, organisant même des cours du soir pour les adultes qui n’étaient pas allés à l’école dans leur enfance. Un public, ainsi beaucoup plus nombreux, s’intéressait désormais aux livres et à la Presse.
- Ensuite les journaux quotidiens de l’époque n’étaient pas encore vraiment illustrés. Il fallait pour cela s’abonner à des hebdomadaires sur papier glacé assez coûteux et qui ne connaîtront leur heure de gloire que pendant la guerre de 1914-1918.
- Enfin, très peu de gens à l’époque disposaient d’un appareil photographique ; et qui plus est, celui-ci était assez peu maniable (et ils n’avaient évidemment pas de téléphone portable faisant des photos numériques !).
Les cartes postales étaient donc très recherchées comme une documentation inégalée, en même temps qu’elles restaient un moyen de communication facile avec les amis ou la famille éloignée. Ces moyens ont été, en à peine plus d’un siècle, très largement dépassés.
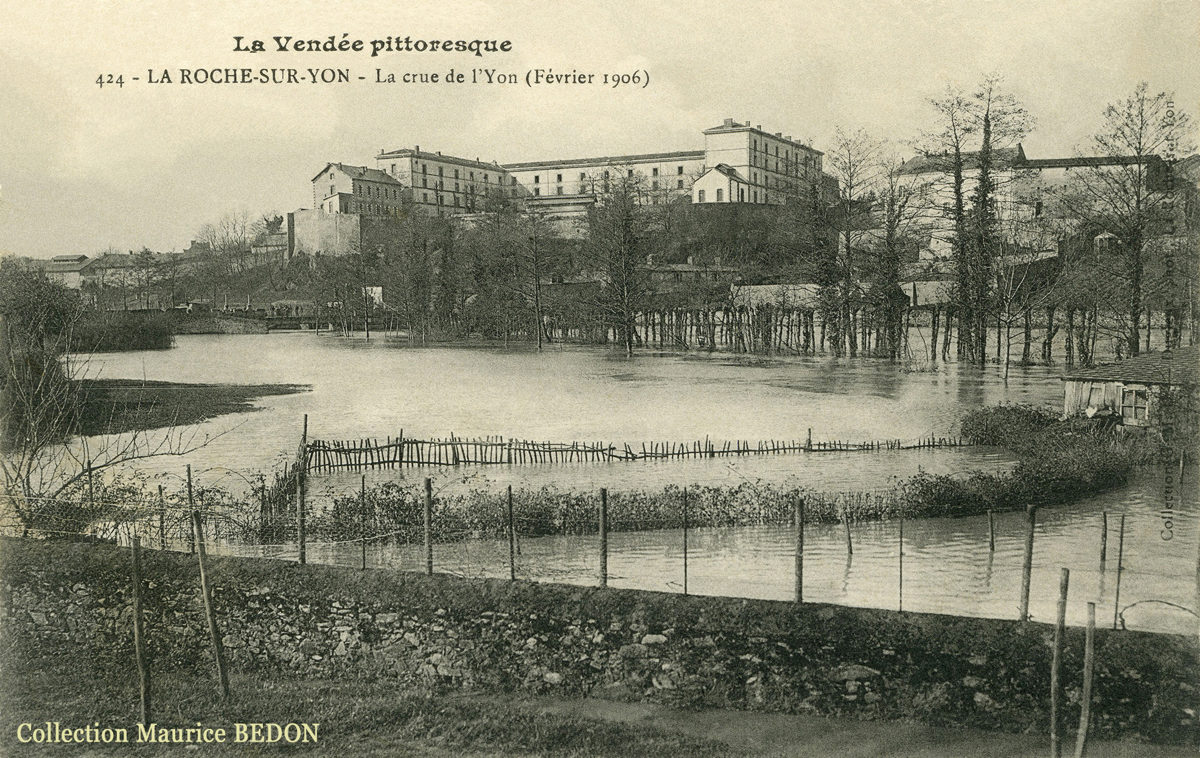
1. Vue générale de l’Inondation de l’Yon en 1906
Dans le domaine qui nous intéresse ici même, les premières cartes postales dont nous disposons concernent la crue de la rivière l’Yon en Février 1906. Ce fait n’était d’ailleurs pas vraiment exceptionnel. Cette rivière, qui traverse la ville de La Roche-sur-Yon, a plusieurs fois inondé les parties basses du quartier d’Ecquebouille, le lavoir, les jardins potagers et quelques habitations dont il a fallu évacuer les habitants. La première carte postale ci-dessus a été réalisée par le célèbre photographe yonnais Paul Dugleux (rue Paul Baudry) N°424 de sa collection « La Vendée Pittoresque » GMD.

2. L’évacuation des habitants lors de la Crue de l’Yon.
Plusieurs photographes locaux ont tenu à immortaliser la même scène que celle représentée sur la carte ci-dessus. Celle-ci nous est apparue comme la plus explicite sur le sujet. Elle a été réalisée par Lucien Amiaud, le premier en date des éditeurs Vendéens, yonnais d’origine, installé depuis son mariage en 1903 aux Sables d’Olonne. Ce cliché a été pris depuis le pont du boulevard de l’Est (actuel boulevard des Italiens). Les services de secours ne disposant pas de moyens de sauvetage, les voisins ont bricolé un système approximatif pour pourvoir évacuer leurs compatriotes. Une échelle a été posée horizontalement pour servir de pont et repose d’un côté entre les barreaux d’une autre échelle et de l’autre sur une chaise.
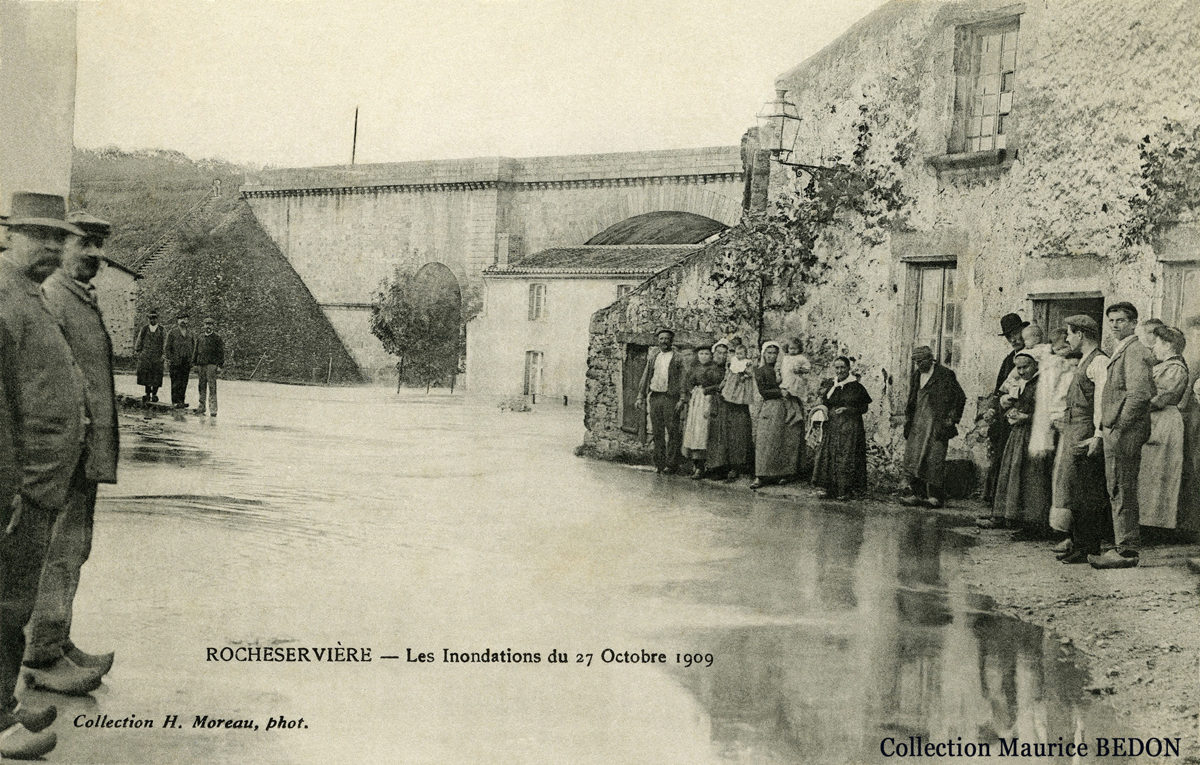
3. Les Inondations au pont de Rocheservière en 1909.
La situation était tout autre dans le Centre Nord du département de la Vendée le 27 Octobre 1909. Voici d’ailleurs ce qu’en disent ceux qui relatent l’évènement quelques années plus tard :
« La crue d'octobre 1909 est l’une des plus marquantes en Vendée. Malgré son ancienneté, elle reste présente dans l’esprit collectif. Les témoignages se sont transmis à travers les générations, notamment sur l’ampleur exceptionnelle des dégâts occasionnés. Il n’y a aucune description de l’événement météorologique ou de la pluviométrie, hormis les témoignages de l’époque : « Orage épouvantable…, la pluie torrentielle n’a cessé entre minuit et 4 heures du matin ». Les pluies se sont concentrées sur le nord du département de la Vendée ; les fortes crues concernent les bassins de la Vie, de l’Auzance et du Lay. Le bassin de la Sèvre Niortaise n’est pas ou peu touché. Les plus hautes eaux sont datées du 26 octobre. Les dégâts matériels sont particulièrement marquants : « vallées inondées, routes et ponts coupés, maisons écroulées ». Les ponts de la région ont été quasi-systématiquement emportés ou fortement endommagés. Sur le bassin de la Vie, sur six communes, six ponts et un aqueduc sont à reconstruire ou réparer… »
Les intempéries avaient été précédées d’un cyclone dans la nuit du 26 au 27 octobre 1909 et ont consisté en plus de quatre heures de pluie incessantes absolument torrentielles. Ce sont les cantons du Poiré-sur-Vie, Rocheservière et Palluau qui ont le plus souffert dans l’ensemble du département de la Vendée. .
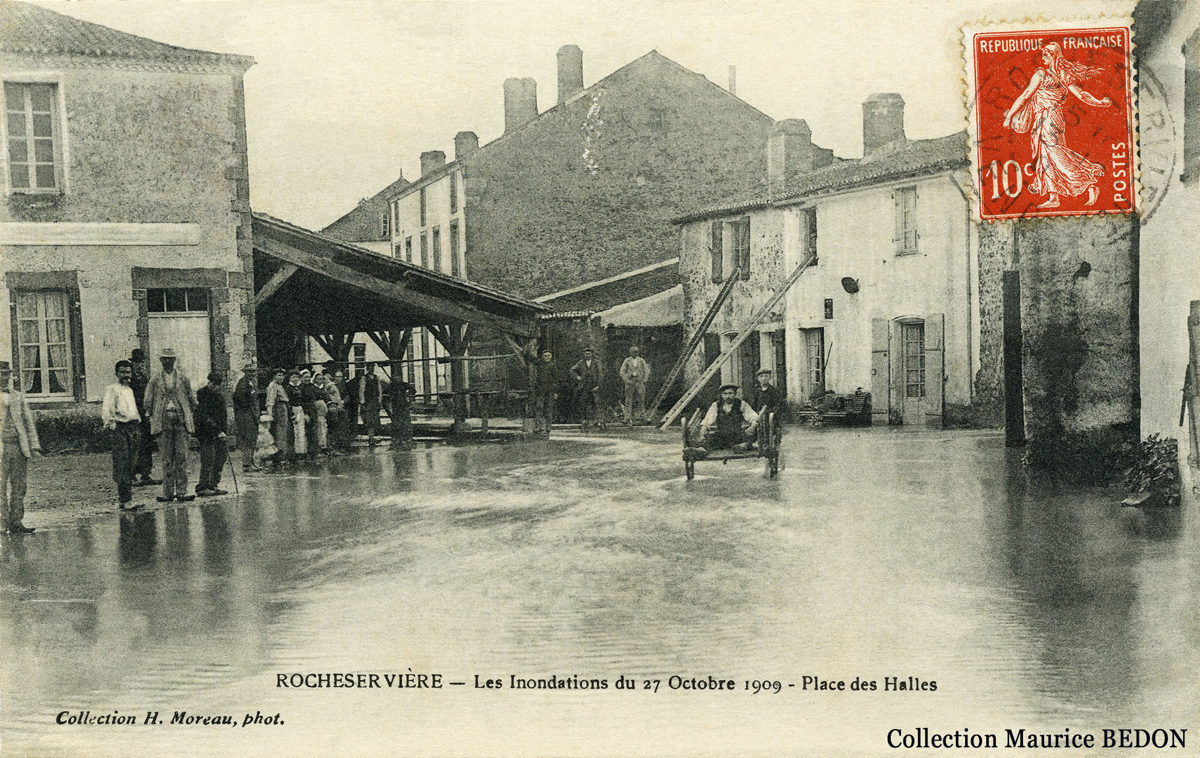
4. La Place des Halles inondée le lendemain 27 octobre 1909.
L’avant-dernière carte postale (N°03) nous présentait un groupe d’habitants devant la rivière la Boulogne, sortie de son lit, près du viaduc et menaçant gravement les premières maisons de Rocheservière (il existe une autre carte du même genre prise quelques instants plus tard, approximativement au même endroit).
Le document ci-dessus, pris place des halles est également l’œuvre du photographe local Henri Moreau de Rocheservière. Il nous montre cette fois-ci : - les habitants contemplant l’inondation, - les échelles posées sur les maisons qui ont servi pour l’évacuation des habitants réfugiés au premier étage - et une petite charrette qui précisément est utilisée pour le déplacement des sinistrés.
La photo ci-dessous a été faite dans les mêmes circonstances et par le même photographe. On y aperçoit une scène à peu près identique un peu plus loin dans la rue principale. A cet endroit, il ne semble pas que l’eau ait encore inondé l’intérieur des maisons. On retrouve la petite charrette servant aux évacuations.

5. Les inondations de Rocheservière dans la rue Principale
La commune du département qui a été la plus touchée par les intempéries est vraisemblablement celle du Poiré-sur-Vie, le même jour 27 octobre 1909.
A cet endroit, l’évènement le plus tragique a eu lieu à proximité du pont de la route d’Aizenay construit sur la rivière le Ruth. Madame Bourmaud, une dame impotente, a péri noyée, mais ses deux filles ont été sauvées par le docteur Lucas qui a pu les ramener à la nage malgré le courant violent. Cette carte postale (N° 2972) nous montre leur petite maison, située tout au bord de la rivière et complètement éventrée par la crue (Cf. illustration ci-dessous).

6. Les inondations au Poiré-sur-Vie : la maison effondrée.
A la suite du cyclone du 26 octobre 1909, les pluies ont été tellement importantes que les rivières avec un courant très fort ont charroyées des débris. Les cours d’eau ont alors fait pression sur les ponts en pierre et ont provoqué la destruction de 18 d’entre eux, dont 4 dans la commune du Poiré-sur-Vie.
La carte postale suivante (N°2973) nous présente le pont de la route conduisant à Palluau, au lieu dit la Braconnerie. Tout au moins ce qu’il en reste, c'est-à-dire pratiquement rien : la rivière La Vie a tout emporté. Les rails de la ligne du chemin de fer à voie étroite (le tram) qui circulait dessus sont restés suspendus en l’air.
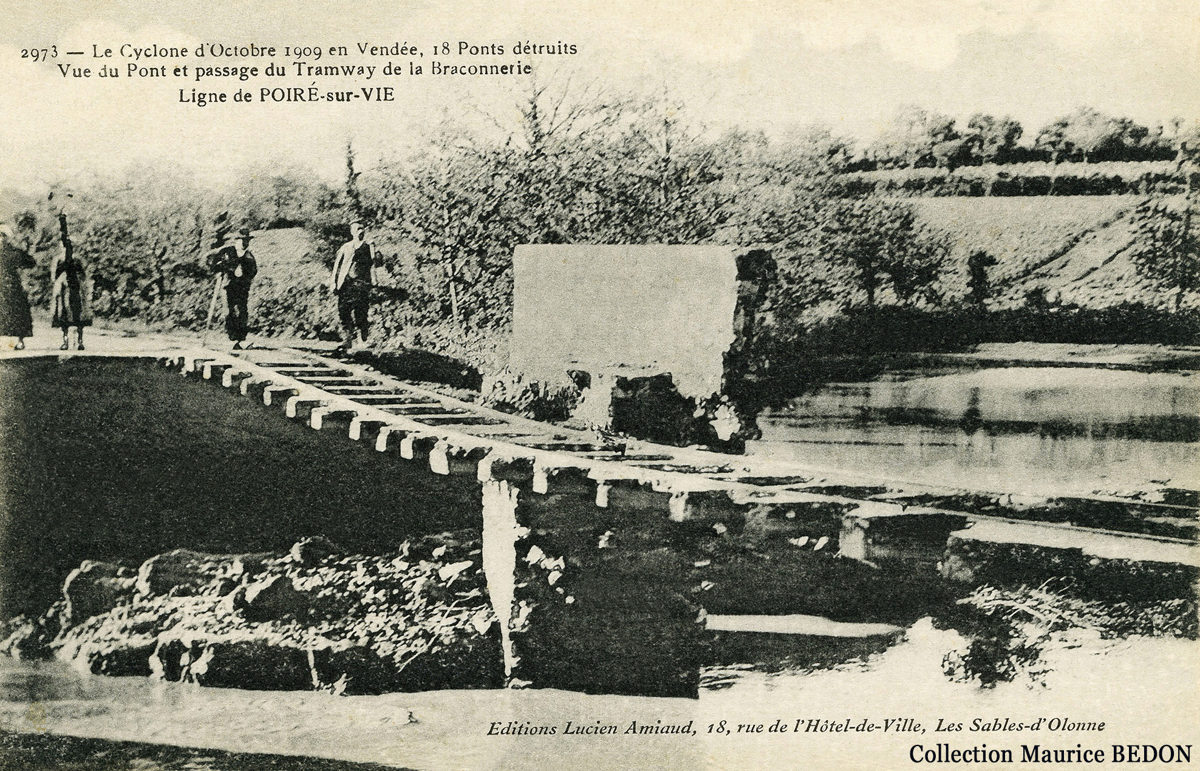
7. Au Poiré-sur-Vie, le pont écroulé de la route de Palluau.
Ces deux cartes postales précédentes et les trois suivantes sont toutes l’œuvre de Lucien Amiaud dont nous avons parlé plus haut. Il en a d’ailleurs consacré très exactement six à ce sujet (Numérotées 2971 à 2976).
Sur la suivante (N°2974) on peut voir les vestiges d’une des arches du pont de la route conduisant du Poiré à Aizenay. Le cliché a été pris de l’autre côté de la rivière le Ruth près de la maison de Tenailleau.

8. Au Poiré-sur-Vie, les vestiges du pont de la route d’Aizenay.
Appartenant toujours à la même série datant de 1909 (N° 2975), la carte postale ci-dessous nous présente cette fois la route du Poiré aux Lucs-sur-Boulogne, qui n’a rien à envier aux autres puisqu’elle a, elle aussi, perdu son pont enjambant la rivière La Vie. On y remarque la présence des ingénieurs de Ponts et Chaussées venus constater l’ampleur des dégâts et envisager les reconstructions qui s’avèrent indispensables.
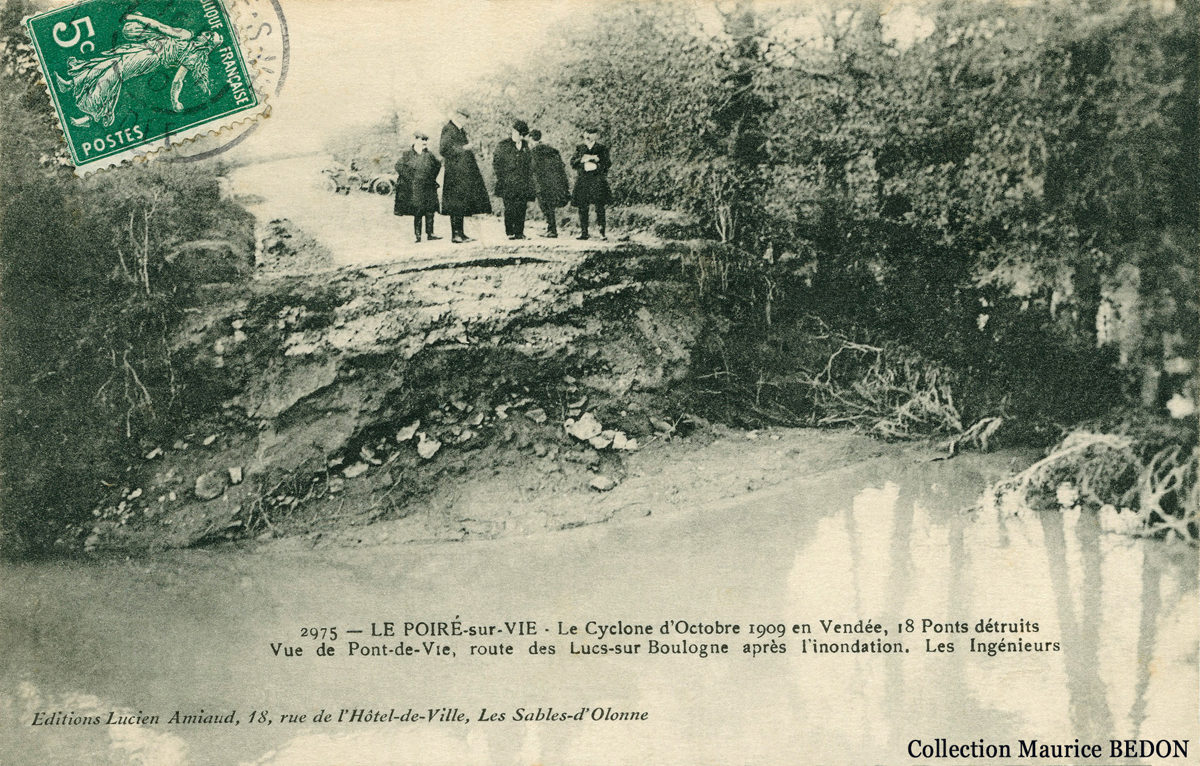
9. Les ingénieurs venus constater les dégâts.
Cette dernière carte représentant les inondations du Poiré-sur-Vie en 1909 (N°2971) a beau porter un numéro qui sous-entend une réalisation antérieure aux autres, en fait il n’en est rien, bien au contraire. Le cliché n’a pas été pris le même jour mais quelques semaines plus tard. On y reconnaît le pont de la route d’Aizenay, aperçu tout à l’heure, avec le vestige de son arche. Une passerelle provisoire en bois a été construite par les Ponts et Chaussées pour permettre le passage en attendant la reconstruction en dur d’un nouveau pont.
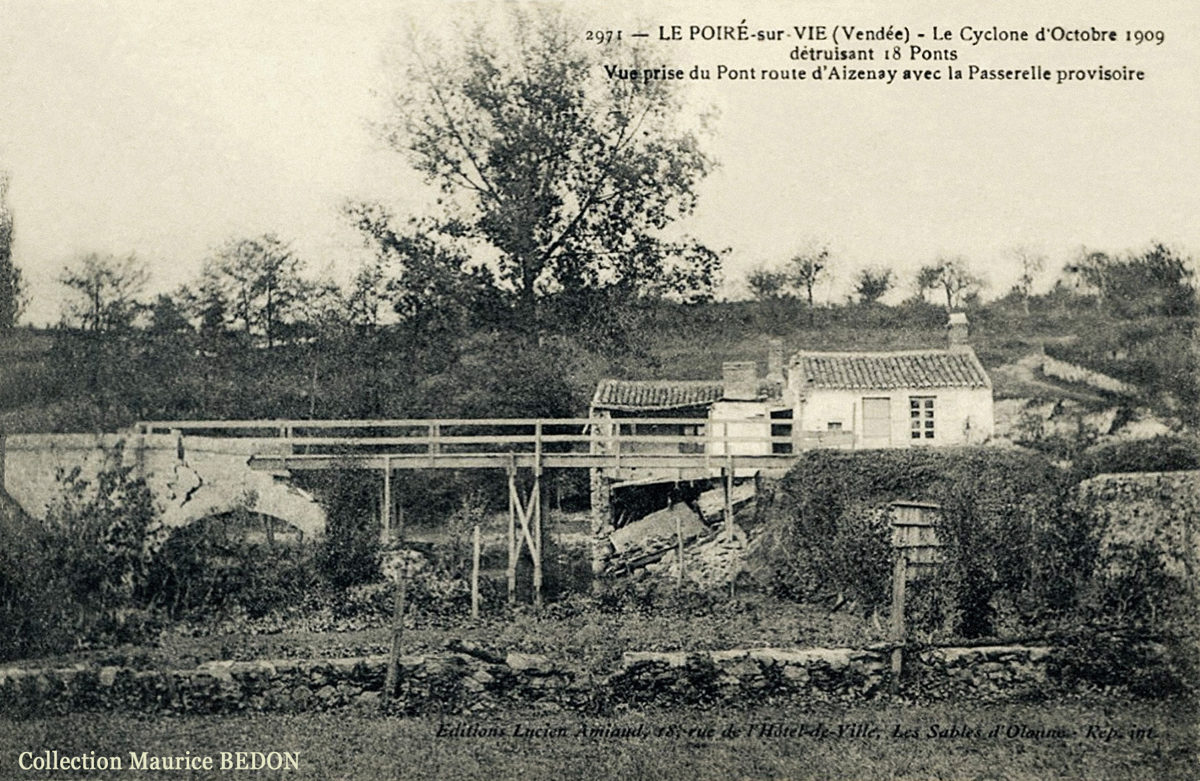
10. La passerelle provisoire établie sur la rivière le Ruth.
Palluau, le canton voisin, a lui aussi été touché par de graves intempéries à la même date. Dans la commune d’Apremont, le grand pont situé sur la rivière La Vie aux pieds du château et qui permettait le passage de la route de Challans à Coëx, a été lui aussi très gravement endommagé.
Cette carte postale a, cette fois-ci, été réalisée par Émile Boutain de Croix-de-Vie. Outre les vestiges du pont éventré, elle nous montre les habitants traversant en barque. La construction d’une passerelle provisoire en bois puis d’un nouveau pont donnera lieu à l’édition de nouvelles cartes postales.

11. Le pont d’Apremont en partie détruit par la crue.
Si les cantons du Centre Nord Vendéen sont ceux qui ont subi le plus de dommages, ils n’en sont pas pour autant les seuls. Revenons au récit déjà cité au début de cet article :
« Sur le bassin de l’Auzance, dans le canton de la Mothe-Achard et aux alentours, l’affluent la Ciboule emporte 17 ponts et en endommage un autre, de nombreuses routes sont coupées. L’Auzance détruit un pont sur la route départementale n°57 et un autre sur la route départementale n°21 dont il est précisé que l’eau a submergé le parapet. Plus au sud, sur le bassin du Lay, on ne relève que des inondations dans la partie basse de la ville de Talmont. »
Justement Lucien Amiaud a consacré la sixième et dernière carte de sa série (N° 2976) à la commune de Saint-Mathurin (Cf. ci-dessous) dans la même journée du 27 octobre 1909. On peut y voir l’emplacement du pont qui était situé sur la rivière La Ciboule et sous la Route Nationale 160 La Roche-sur-Yon aux Sables d’Olonne (actuelle RD 160), près du lieu dit la Millière. A proximité, la rivière l’Auzance avait aussi coupé, entre autres, le pont de la route allant de Saint-Mathurin à Vairé.

12. Le pont détruit sur la RN 160 à Saint-Mathurin.
Le photographe Lucien Amiaud, décidément « spécialiste » des inondations, a consacré une autre série de 10 cartes postales (N° 4415 à 4424) aux inondations que la commune de la Tranche-sur-Mer a subies en décembre 1911.
Cette série a toutefois connu un succès commercial moins important que la précédente, sans doute parce que les images étaient moins spectaculaires. Il y montre successivement : - Une voiture en panne sur la route (N°4418) – La route d’Angles coupée (N°4419), - Les jardins sous l’eau (N°4420), - Les Tranchais fuyant devant le fléau (N° 4422), - Un habitant essayant de sauver les récoltes (N°4423), - Une voiture surprise par l’inondation sur la route d’Angles (N° 4424), - Les soldats du 93ème réalisant des travaux de défense de la digue (N° 4415, 4416, 4417 et 4421).
Ces inondations n’étaient pas de même nature que celles de 1909 dans le Nord Vendée. A la Tranche-sur-Mer elles étaient relativement fréquentes l’hiver car le fleuve Le Lay inondait les marais. Celles de décembre 1911 ont été particulièrement importantes car elles se sont conjuguées avec des attaques de la mer pendant une grande marée.
La carte postale reproduite ci-dessous est la N° 4423. Sa légende nous indique qu’il s’agirait d’un « Tranchais sauvant les récoltes ». Il y avait peu de récolte à sauver au mois de décembre ! En fait il s’agit du sacristain, un personnage local original, connu pour partir à la mer pieds nus en toutes saisons.

13. Un habitant de la Tranche essayant de sauver sa récolte.
Lors de ces inondations de 1911, les soldats, effectuant leur service militaire au 93ème régiment d’infanterie cantonné à La Roche-sur-Yon, avaient été mis à contribution pour aider la population à lutter contre les dégâts causés par la mer. Même si, en contemplant les images, on a de prime abord l’impression que les moyens employés sont dérisoires (CP N°4417). Ici, au lieu dit « La Belle Henriette », en faisant la chaîne pour transporter des pierres, ils essayent de consolider la dune afin d’éviter que la mer ne la ravine totalement.

14. Les soldats réparant les dégâts causés par la mer.
Une autre série de deux ou trois cartes postales ont été réalisées à Palluau le 27 mai 1915 par un photographe anonyme. En effet, ce jour là, et en particulier au lieu dit l’Aumônerie, « la Petite Boulogne » est sortie de son lit et a inondé les parties de la ville proches de la rivière (Cf. carte postale ci-dessous à gauche).
Dans la ville de Talmont, ces genres d’évènements, relativement fréquents, étaient familièrement surnommés « les baignades ». Ils intervenaient lors d’une marée d’un fort coefficient pendant une période extrêmement pluvieuse. Les eaux de la rivière La Payré ne pouvaient alors plus s’écouler vers la mer et refoulaient en inondant la ville basse de Talmont. Cette carte postale, non datée, dont le photographe est anonyme a été éditée par J. Le Brasseur à Talmont (Cf. carte postale ci-dessous à droite).

15. Palluau inondé en 1915. 16. Les Inondations à Talmont.
Les inondations survenues dans la période 1900-1914 nous sont bien connues par la force des images, puisqu’elles ont été immortalisées par les cartes postales. Mais d’autres évènements similaires sont évidemment survenus après cette dernière date...
Chantonnay le 7 mai 2020

"LES FAITS" DE LOUBLANDE

L’Église paroissiale de Loublande.
La commune de Loublande est située à l’extrémité nord du département des Deux-Sèvres à proximité de la frontière avec le département du Maine-et-Loire et de celui de La Vendée, ce qui la place ainsi à environ sept kilomètres au Sud de Cholet et quatre kilomètres à l’Est de Saint-Laurent-Sur-Sèvre, c'est-à-dire dans un secteur où la foi catholique est particulièrement vive au tout début du XXème siècle.
La personne concernée par les apparitions est une jeune fille du nom de Claire Ferchaud. Cette dernière est née le 5 mai 1896 et baptisée le même jour. Elle est en outre l’une des six enfants (trois filles et trois garçons) d’un couple d’agriculteurs de la ferme des Rinfillières. Elle fait naturellement ses études primaires à l’école privée du Sacré-Cœur dans sa paroisse (à l’époque on disait l’école libre).
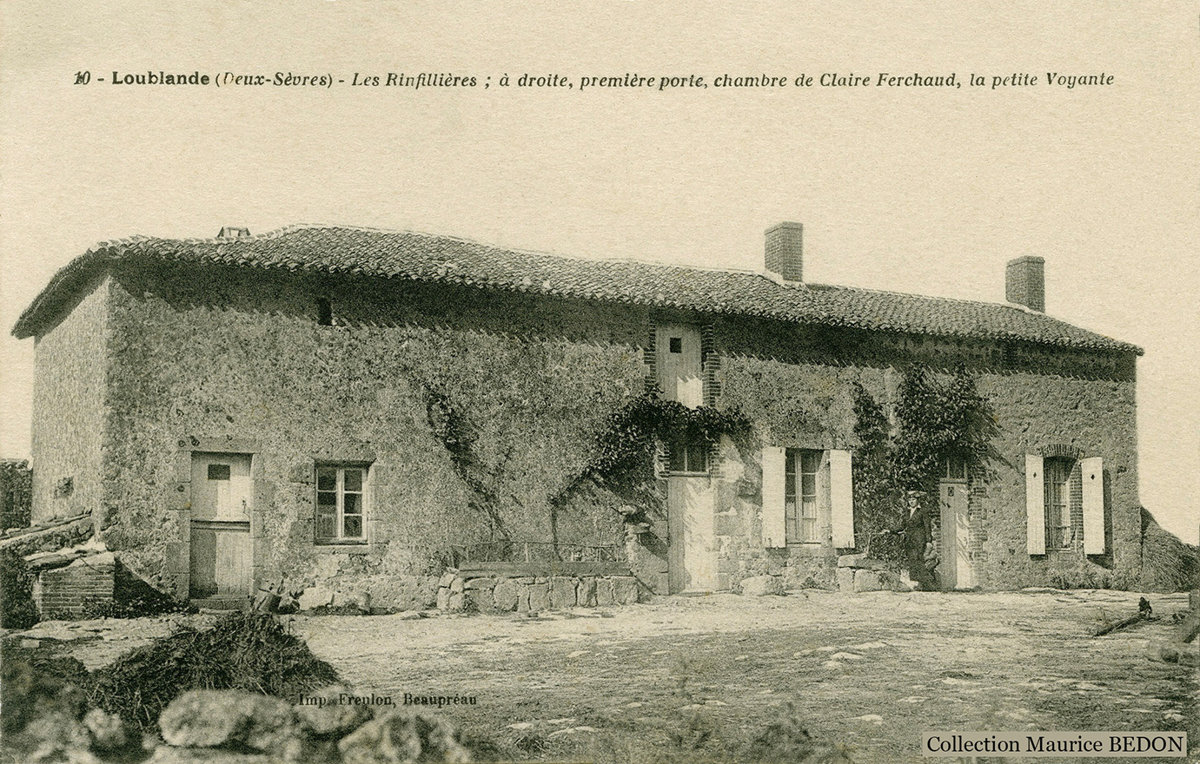
La Ferme des Rinfillières à Loublande vers 1905.
Dès son enfance, après sa première communion, elle affirme voir fréquemment le Christ et la Vierge Marie venus la visiter et la soutenir spirituellement ; mais cela ne lui paraît pas extraordinaire car elle est persuadée que les autres enfants de son âge connaissent naturellement des expériences similaires. Elle finit cependant par en informer son confesseur l’abbé Audebert, qui est surpris tout d’abord, mais pas trop finalement, car il connait la spiritualité importante qui règne dans cette famille. Celle-ci avait en effet pris l’initiative de faire construire en 1862, à ses frais et sur son terrain, une petite chapelle dédiée à Notre Dame de la Garde et appelée la chapelle des Rinfillières.

La chapelle des Rinfillières.
La nouvelle de ces premières apparitions, tenue cachée au début, finit tout de même par s’ébruiter dans la paroisse et les environs assez proches. Des personnes intéressées sont de plus en plus nombreuses à faire le déplacement vers la ferme des Rinfillières pour rencontrer la jeune Claire Ferchaud. Et une certaine dévotion commence à s’organiser à cet endroit, avec l’accord plus ou moins tacite du clergé local.
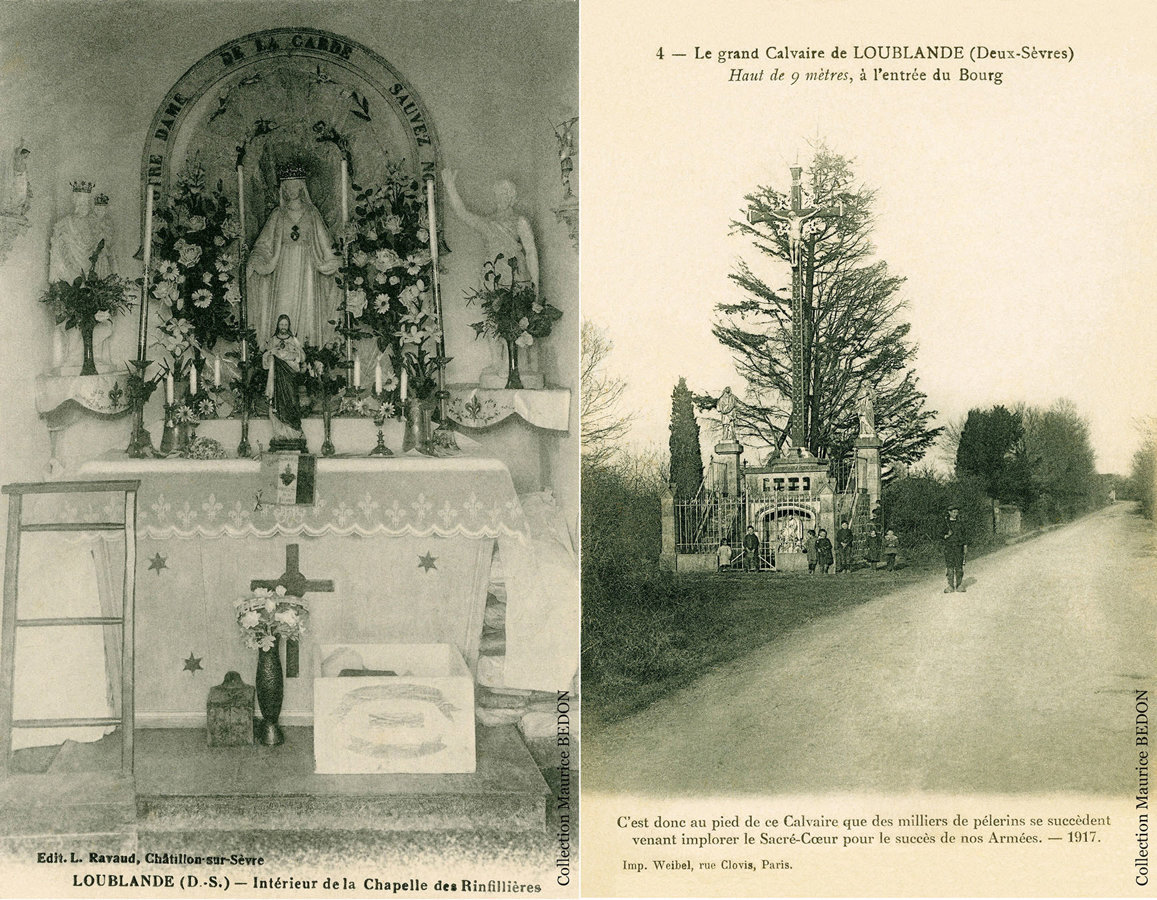
L'intérieur de la chapelle des Rinfillières et le grand calvaire de Loublande.
Pendant la guerre de 1914-1918, alors que deux de ses frères sont mobilisés et sur le front, Claire part faire une retraite spirituelle. Elle a alors 20 ans. Elle en revient en 1916 et à partir de là, sa mission se précise. Elle affirme que le Christ lui est apparu le 28 novembre 1916 et de nouveau le 16 décembre 1916. Il lui a montré son Sacré-Cœur avec une plaie ouverte lui disant : « Cette plaie ouverte m’est faite par la France officielle, la Franc-maçonnerie ». Il lui aurait en outre donné pour mission d’aller demander au Président de la République de faire apposer le Sacré-Cœur sur le drapeau tricolore de la France.
Une demande de cette nature était inattendue, mais n’en était pourtant pas complètement nouvelle. C’était même la reprise du message reçu lors de l’apparition du 17 juin 1689 par Sainte Marguerite-Marie Alacoque à Paray-le-Monial (canonisée en 1920). Ce message était destiné, à cette époque, au roy de France Louis XIV. Mais il n’avait pas été suivi d’effet.
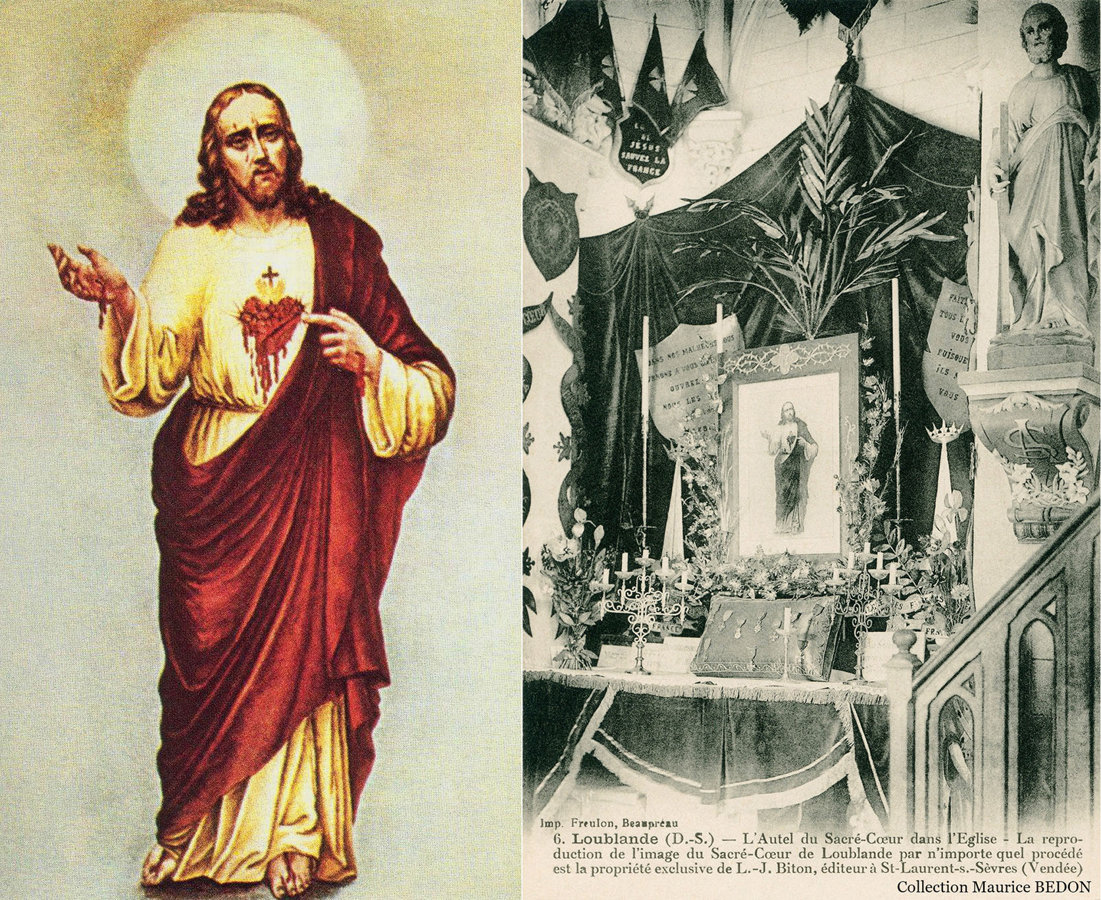
L’Image du Sacré-Cœur et sa présentation dans l’église de Loublande.
Claire Ferchaud, totalement pénétrée par sa mission divine, décide donc de demander un entretien au Président de la République Raymond Poincaré et dans cet objectif, elle lui écrit la lettre suivante le 16 janvier 1917 :
« Monsieur le Président,
Une humble fille du Poitou vient de recevoir du Ciel une mission qui fait frémir sa nature bien timide, mais qui, en but du salut de notre cher pays, ne peut reculer devant aucun sacrifice. J’ai donc l’honneur de m’adresser au chef premier de la nation française. C’est à vous, Monsieur le Président, que Dieu m’envoie. Le mot Dieu doit vous rappeler quelques souvenirs de notre sainte religion. Ce Dieu qui est chassé de notre pauvre France par la Franc-maçonnerie, persécuté de toutes façons, est cependant jaloux de posséder ce pays qui est appelé la Fille ainée de l’Église.
Monsieur, veuillez s’il vous plaît me prêter votre attention. Ce que j’ai à vous dire n’est pas invention de ma part. La chose est grave pour vous d’abord, ensuite pour l’avenir de la France. C’est de la bouche divine du Dieu du Ciel que j’ai reçu l’ordre de vous transmettre le désir exprès de Jésus. ….
Vous aurez le salut d’abord, si vous renoncez à cette vie de luttes contre la religion. Vous êtes le chef, vous avez en main la clef du Gouvernement. Il vous appartient donc d’aller dans le droit chemin qui est la civilisation chrétienne, source de toute morale. Vous devez montrer le bon exemple en combattant contre la Franc-maçonnerie…..
En second lieu, et c’est là le but de ma mission, Jésus veut sauver la France et les Alliés, et c’est par vous, Monsieur le Président, que le Ciel veut agir, si vous êtes docile à la voix divine. Il y a des siècles déjà, le Sacré-Cœur avait dit à sainte Marguerite-Marie : « Je désire que mon Cœur soit peint sur le drapeau national, et Je les rendrai victorieux de tous leurs ennemis ». Dieu semble avoir dit ces paroles pour nos temps actuels. L’heure est arrivée où son Cœur doit régner malgré tous les obstacles. Ce Cœur Sacré, j’ai eu la grâce d’en contempler la face adorable. Jésus m’a montré son Cœur broyé par l’infidélité des hommes. Une large plaie divise son Cœur. Et de cette plaie profonde, Jésus m’a dit : « C’est la France qui me l’a faite ». Cependant, malgré les coups dont le Cœur de Jésus est martyrisé, il s’avance vers vous, M. le Président, en offrant sa miséricorde.
À plusieurs reprises différentes, entre autres le 28 du mois de novembre 1916, Jésus, dans une lumière spéciale, me fit voir M. le Président, l’âme fortement travaillée par la grâce d’abord à demi écoutant Dieu et votre conscience. Il m’a semblé voir Dieu vous adressant ces paroles « Raymond, Raymond, pourquoi me persécutes-tu ? » À cette voix, vous avez tressailli ; puis la grâce étant plus forte que vos passions, vous êtes tombé à genoux, l’âme angoissée et vous avez dit : « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?... »….
. Monsieur, voici les paroles sacrées que j’ai entendues de la bouche même de Notre-Seigneur : « Va dire au chef qui gouverne la France de se rendre à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre avec les rois des nations alliées. Là, solennellement, les drapeaux de chaque nation seront bénits, puis le Président devra épingler l’image de mon Cœur sur chacun des étendards présents. Ensuite, M. Poincaré et tous les rois alliés à la tête de leur pays, ordonneront officiellement que le Sacré-Cœur soit peint sur tous les drapeaux de chaque régiment français et allié. Tous les soldats devront être recouverts de cet insigne de salut ». D’accord, ensemble, la France et les alliés, le même jour, à la même heure, s’élanceront à l’assaut, munis de leurs insignes. L’ennemi prendra la fuite et ils seront repoussés au-delà de la frontière avec de grosses pertes. En peu de jours le Sacré-Cœur nous rendra victorieux. ……
Je rappelle à votre souvenir votre pieuse mère, décédée il y a quelques années. Sans elle, oui, vous seriez maintenant couché dans la tombe, et hélas ! Votre âme, où serait-elle ? - Je l’ai vue dans les gloires du Ciel, parmi les saintes de Dieu, se distinguant par sa tristesse profonde. … Votre mère suppliait Dieu de vous faire grâce encore ; alors, à sa demande, Jésus lui donna un délai. Le sang de Jésus et les larmes de votre mère se mêlèrent, et, mystiquement, se répandirent sur vous. Puis, cette mère que vous avez pleurée me montra son fils, ce cher Raymond, au jour de sa première communion, beau comme les anges du Ciel, embaumé de cette présence du premier baiser de Jésus à son âme. ….Mais hélas avec les années qui se sont succédé, les compagnies fausses et dangereuses ont été l’objet de votre recherche et, par ce chemin, vous êtes devenu ce que vous êtes à l’heure présente. Votre mère pleurait toujours. Elle me donna un regard de supplication et me dit « Va, va sauver mon fils, je suis sa mère ! » Monsieur, ne serez-vous pas touché quand je vous rappelle le souvenir de votre mère ? Votre cœur serait-il d’airain pour ne pas être attendri à la voix suppliante d’une mère qui, même dans la gloire du Ciel, pleure sur son fils égaré !
Monsieur, je vous l’ai dit : « De vous dépend le salut de tous. Vous avez sur vos épaules tout le poids du Gouvernement. N’entendez-vous pas aussi toutes les voix de ces glorieuses victimes tombées au champ d’honneur :….Le sang des enfants de France est comme un cri qui s’élève vers vous. Ces voix retentissent plus fortement que le bourdonnement du canon qui gronde sur le front. Ces voix, je les entends vous dire : « Raymond, chef de la nation française, si tu veux obtenir la victoire, reviens à ton Dieu ». Ces paroles ne sont-elles pas plus pénétrantes que la voix des impies qui persécutent la religion ? …. Monsieur le Président, vous êtes perdu si vous persistez dans les erreurs qui empoisonnent votre vie. Ah ! je frémis ! Pauvre France ! D’elle, nous n’aurons plus que le souvenir. »
A cette première lettre, Claire Ferchaud ne reçoit pas de réponse mais elle ne se décourage pas pour autant et en écrit une seconde. Et cette fois-ci les milieux catholiques lui conseillent de faire intervenir en sa faveur, pour obtenir le rendez vous, le marquis Armand Charles de Baudry d’Asson député conservateur de la Vendée, habitant le château de Fonteclose à La Garnache. C’était le fils et successeur du député de Baudry d’Asson, qui en pleine Assemblée Nationale, avait coiffé le président du Conseil Emile Combes d’une casserole en cuivre pour symboliser celles qu’il trainait !
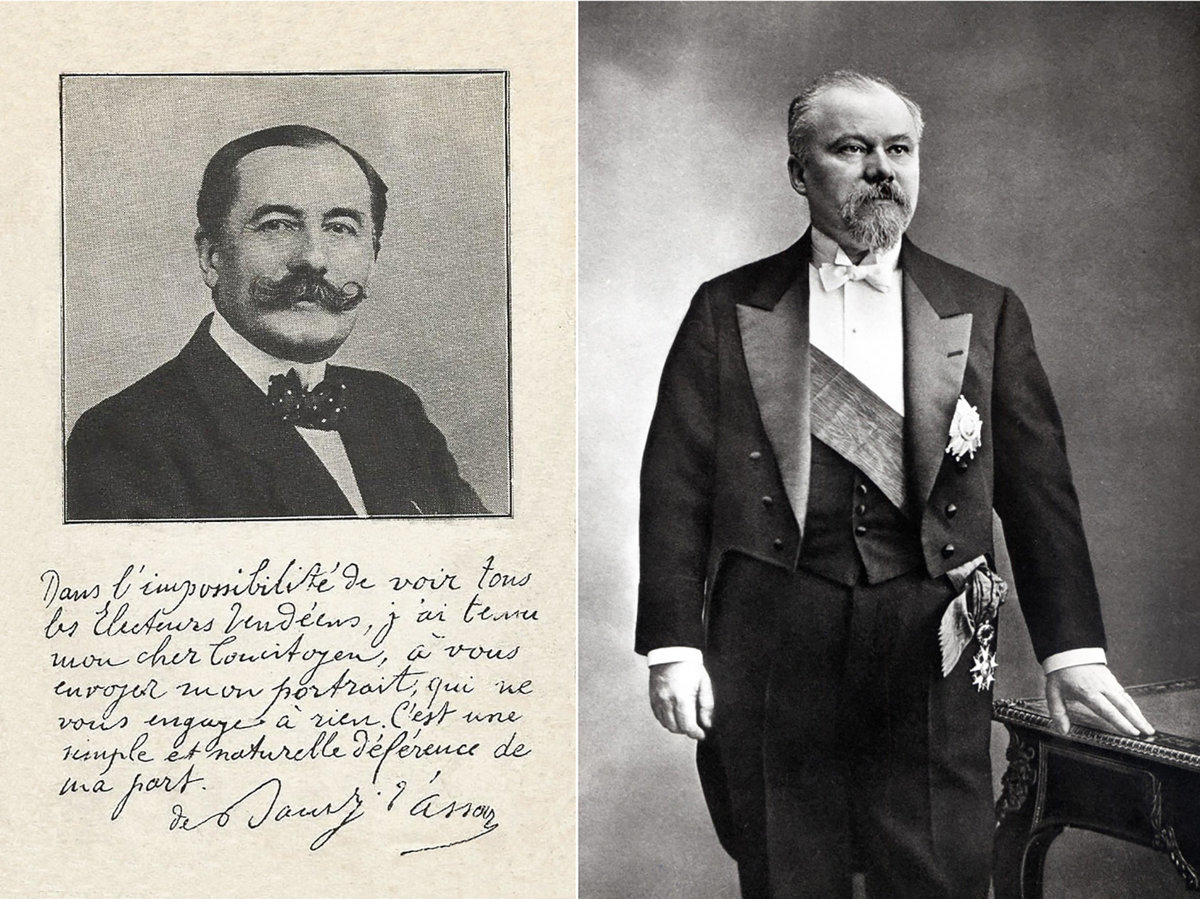
En tous cas, Claire Ferchaud obtient un rendez vous avec le Président de la République le 21 mars 1917 à Paris au palais de l’Elysée. Ceci est déjà extraordinaire en soi et nous indique l’état d’inquiétude du pouvoir en cette période de la première guerre mondiale. Nullement impressionnée par le personnage et le décorum, la petite paysanne lui expose clairement la mission qui lui a été confiée. Elle a été écoutée attentivement et a eu l’impression d’avoir même ému son interlocuteur. Toutefois celui-ci lui expose qu’on ne peut ainsi défaire les lois, ni toucher au drapeau national et que de plus un Président de la République de la IIIème République dispose de peu de pouvoir. Il lui laisse tout de même poliment un espoir, en lui disant en substance qu’il verrait ce qu’il peut faire.
En réalité que pouvait-il faire, alors que les lois relevaient des Assemblées et le pouvoir du Président du Conseil ? Et dans ce domaine, on était alors en période de crise ministérielle. Le 21 mars 1917, le Président du Conseil était, depuis la veille, Alexandre Ribot. Ce dernier céderait sa place dès le 12 septembre 1917 à Paul Painlevé, qui ne resterait que jusqu’au 13 novembre 1917. Et le 16 novembre 1917 c’est le vendéen Georges Clemenceau qui arrivait au pouvoir. Ce qui était une très mauvaise nouvelle pour Claire Ferchaud, puisque ce dernier était un anticlérical viscéral, qui précisément s’était opposé farouchement à la construction de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.
Cette affaire, connue progressivement dans les milieux catholiques, suscite alors beaucoup d’émoi. Beaucoup de paroisses font fabriquer le fameux drapeau avec le Sacré-Cœur sur la partie blanche centrale et les inscriptions « Cœur Sacré de Jésus, Espoir et Salut de la France » et l’utilisent lors des processions. Ils décoreront l’intérieur des églises pendant longtemps et ne disparaitront qu’après le concile Vatican II. Lors de notre communion solennelle personnelle en 1957, celui de Chantonnay se trouvait juste au dessus de notre tête. L’État avait assez rapidement pris la précaution d’interdire sa présence lors des cérémonies officielles.

Sa démarche n’ayant pas abouti auprès des autorités politiques, Claire Ferchaud va en tenter une auprès des militaires. Elle écrit une lettre à 14 généraux, le 7 mai 1917, demandant « que l'image du Sacré-Cœur, signe d'espérance et de salut, brille officiellement sur nos couleurs nationales ». Le courrier est adressée à : Hubert Lyautey ancien ministre de la Guerre, Philippe Pétain généralissime, Joseph Micheler 1ère armée, Adolphe Guillaumat 2ème armée, Georges Humbert 3ème armée, Henri Gouraud 4ème armée, Paul Maistre 6ème armée, Antoine Baucheron de Boissoudy 7ème armée, Augustin Gérard 8ème armée, Denis Duchêne 10ème armée ; ainsi qu'à Édouard de Castelnau, Robert Nivelle, Marie-Émile Fayolle, et Ferdinand Foch.
Il semble que Marie-Emile Fayolle fut le seul à lui répondre, mais le général Ferdinand Foch (commandant le 20ème corps d'armée de Nancy, puis commandant suprême des forces alliées) a été le seul, au cours d'une cérémonie privée le 16 juillet 1918, à consacrer les troupes françaises et alliées au Sacré-Cœur. Les fidèles de Claire Ferchaud ne manquèrent pas de faire remarquer que c’est lui qui remporta la victoire finale quelques mois plus tard. De toute façon, les images du Sacré-Cœur, reproduites à des millions d’exemplaires, étaient très présentes dans les vêtements des combattants, au point que le ministre de la Guerre en interdit l’exhibition le 6 août 1917.
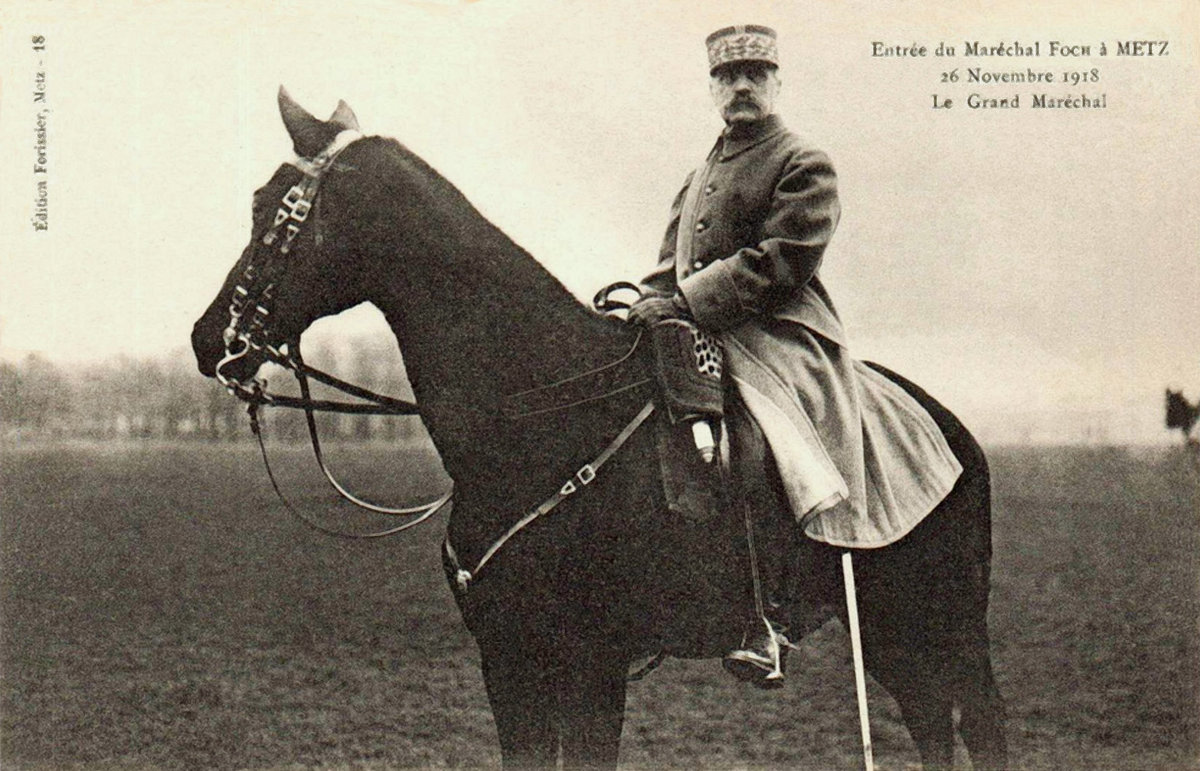
Le Général Ferdinand Foch.
A la fin de l’année 1917, Claire Ferchaud décide de fonder une communauté de « vierges repentantes » regroupant cinq religieuses à Loublande. Elle l’intègre elle-même en prenant le nom de « Sœur Claire de Jésus Crucifié ». Pour cette fondation, elle reçoit le soutien de S. E. Monseigneur Humbrecht évêque de Poitiers, qui vient inaugurer et bénir la chapelle de son couvent le 12 juin 1918. Une statue de la bienheureuse Jeanne d’Arc surmonte le portail d’entrée (canonisée en 1920), sans doute parce que la supérieure était surnommée « la Jeanne d’Arc de la guerre de 14 ». Durant cette période, après la fin de cette première guerre mondiale, les visiteurs et les pèlerins se font de plus en plus nombreux à Loublande.
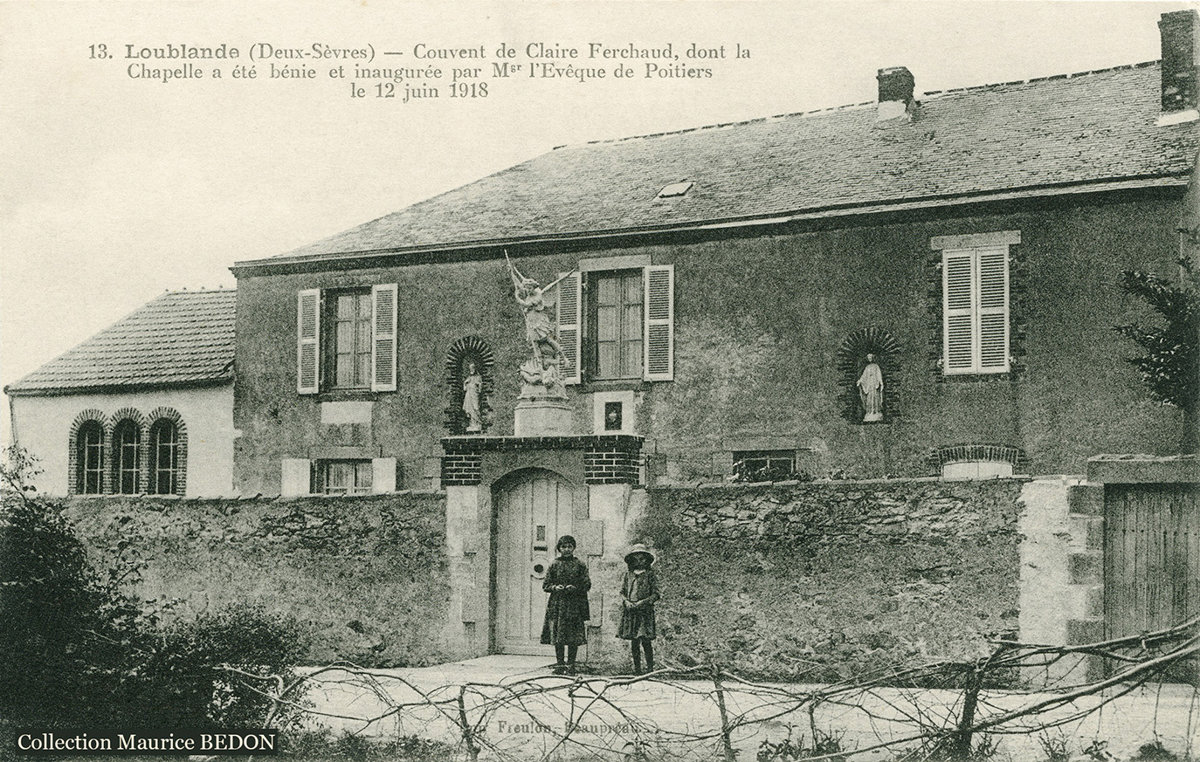
Le petit couvent de Loublande.
A cette époque la politique de l’Union Sacrée instaurée au début de la première guerre mondiale se poursuit et va aboutir à un assouplissement des lois anti catholiques votées de 1903 à 1905. Les congrégations religieuses vont être autorisées à rentrer en France. Dans ce climat de dégel, le message sans nuance de Claire Ferchaud et la condamnation frontale de la franc-maçonnerie ne peut qu’embarrasser la hiérarchie catholique française. S. E. le cardinal Léon Amiette cardinal archevêque de Paris, avait déjà écrit qu’il regrettait de « n'avoir pu découvrir une inspiration surnaturelle » dans les déclarations de Claire Ferchaud.
De plus, la décision de Rome arriva sous la forme d’un décret de la congrégation pour la doctrine de la foi (Saint-Office) au Vatican. Daté du 12 mars 1920 et publié dans les Acta Apostolicae Sedis sous la signature de S. S. le Pape Benoît XV, il estimait que « les faits de Loublande » …« ne peuvent être approuvés ». C’était un véritable désaveu pour Claire Ferchaud, mais pas une condamnation formelle. Elle plaça tout de même les catholiques désormais dans l’expectative à ce sujet.
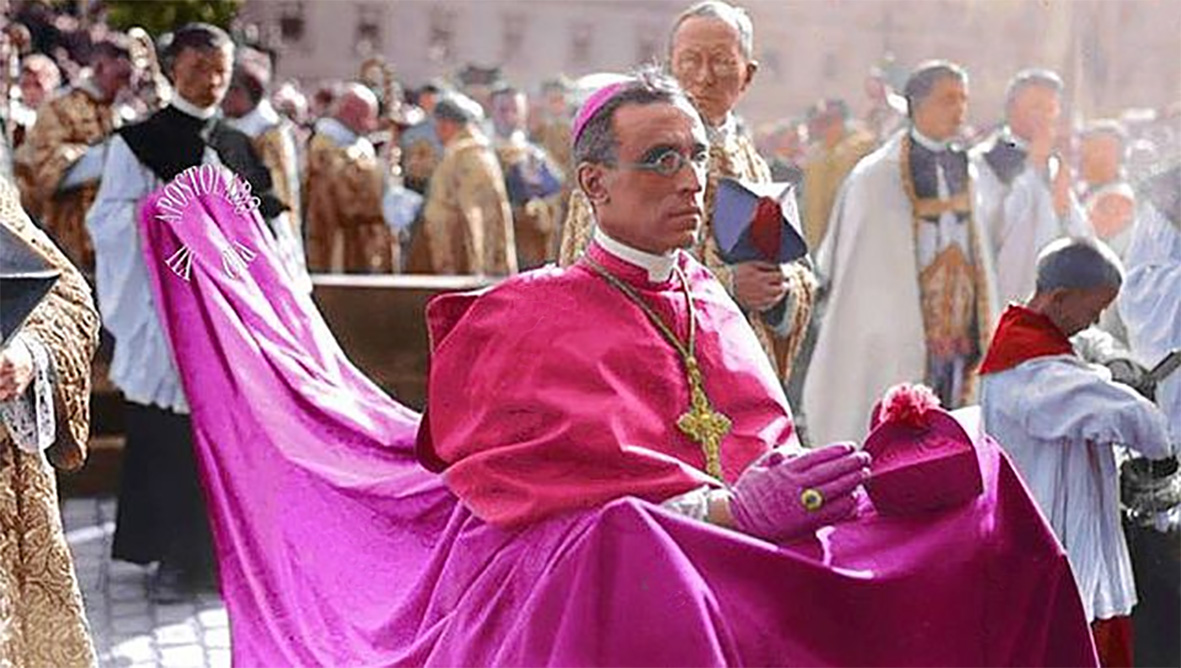
Le Cardinal Pacelli Nonce Apostolique
La présence du Sacré-Cœur sur le drapeau n’était pas la seule mission de Claire Ferchaud. Elle militait aussi pour la messe perpétuelle c'est-à-dire un office réalisé par un groupe de prêtres se relayant pour célébrer un triduum de messes en continu. Or, sans que cela ait de rapport avec elle, une expérience de cette nature a été tentée à Lourdes du 25 au 28 avril 1935, sous la présidence de S. E. le cardinal Eugenio Pacelli Légat du Pape (et futur Pape Pie XII). Quand cette initiative fut connue de la S. S. le Pape Pie XI, elle le souleva d’enthousiasme et quand il prit connaissance du projet de Loublande sur le même sujet, il invita Claire Ferchaud à venir le rencontrer à Rome. Malheureusement le Pape mourut le 10 février 1939, à la veille de la seconde guerre mondiale et avant que le rendez-vous ne se soit concrétisé.
Par la suite, Claire Ferchaud devait décéder dans son petit couvent de Loublande le 29 janvier 1957. Des pèlerins viennent encore tous les ans au mois de septembre pour lui rendre hommage.
Chantonnay le 22 décembre 2019

UN SCHISME A CHANTONNAY ?
Après les sanglantes persécutions antireligieuses de la Révolution Française, le concordat de 1801, à l’époque du Consulat de Napoléon Bonaparte, ramena la paix dans les campagnes. Mais, la renaissance religieuse dans le pays ne se fit pas toujours sans soubresauts. Certains curés jureurs étaient parfois restés en place dans les paroisses ; les prêtres réfractaires (ceux qui avaient survécu) rentraient d’un exil d’une dizaine d’années ; de nouveaux desservants s’avéraient nécessaires. De plus, en 1830, après la chute de la monarchie restaurée en la personne du roy Charles X puis l’avènement de Louis-Philippe, le personnel politique au pouvoir était souvent hostile aux membres du clergé qu’il accusait d’être restés royalistes légitimistes.
Dans un tel contexte les évêques avaient fort à faire pour réinstaller un fonctionnement harmonieux. C’est durant cette période qu’éclatèrent localement certaines affaires qui ont tendance à nous faire sourire aujourd’hui et évoquent irrésistiblement « Clochemerle ».
 L’église et le presbytère de Pouillé.
L’église et le presbytère de Pouillé.
La plus importante et la seule restée célèbre est celle qui est survenue dans la commune de Pouillé dans le canton de l’Hermenault. Elle a même fait l’objet d’un petit livre intitulé : « Précis historique de la prétendue Église Française dans les communes de Pouillé et de Petosse (Vendée) », écrit par Louis-Pierre Charon (paysan vendéen) et édité en 1843 à Paris.
Ce petit ouvrage raconte l’histoire de la paroisse de Pouillé à qui l’évêché de Luçon n’avait pas encore nommé de desservant. Les habitants décidèrent d’« élire » pour cette fonction un charlatan nommé Guicheteau qui se disait « prêtre français ». Ce qui entraina par la suite une situation très embarrassante et des péripéties incroyables pendant une dizaine d’années.
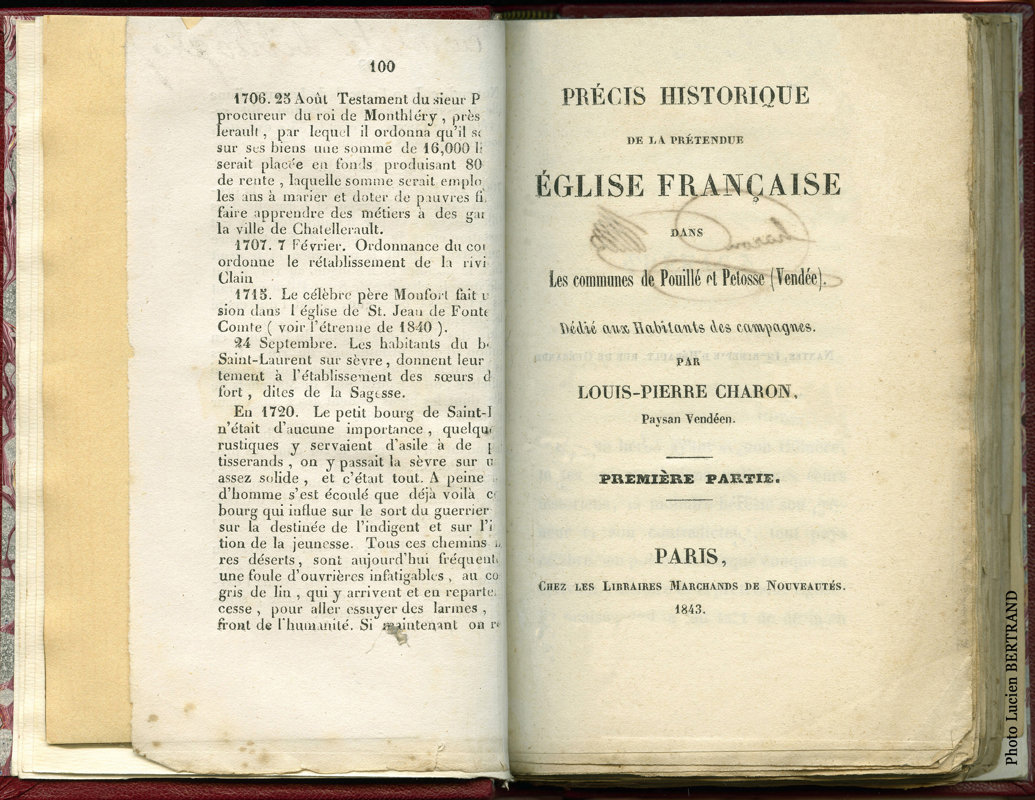 Le
petit livre sur Pouillé.
Le
petit livre sur Pouillé.
« En voyant la prospérité toujours croissante des écoles libres, la fureur des bourgeois sectaires ne connut plus de bornes ; ils persécutèrent tellement le bon M. Esnard qu’il fut obligé de donner sa démission. » (Henri ESNARD curé de Chantonnay de 1834 à 1842)
« M. de Liniers, curé de Bazoges, lui succéda vers 1843 et ne resta qu’un an » (François de LINIERS curé de Chantonnay de 1842 à 1843).
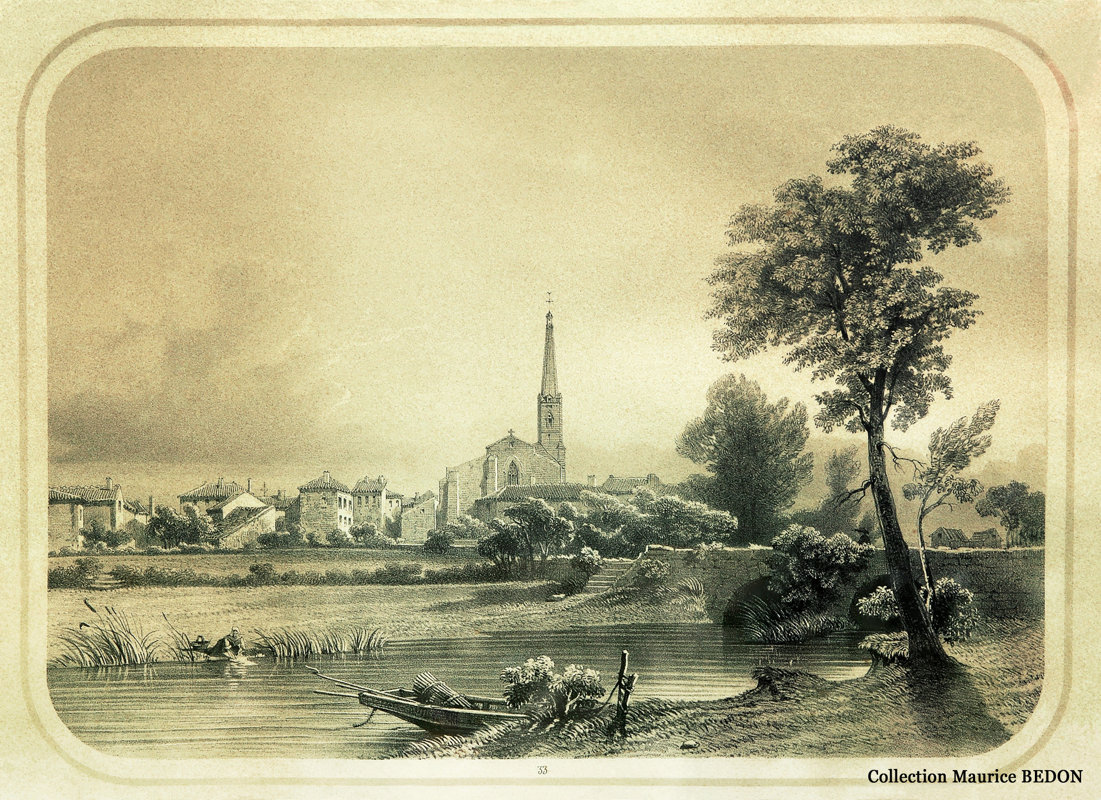 Vue de
Chantonnay vers 1840.
Vue de
Chantonnay vers 1840.
« C’est M. Hamel, curé de Thiré, qui le remplaça » (Édouard HAMEL curé de Chantonnay de 1843 à 1848). « Grâce à beaucoup de qualités extérieures, il fut très bien reçu tout d’abord, mais hélas ! Faut-il le dire ? Il fut un curé néfaste pour Chantonnay. Il laissa complètement de côté les écoles libres des Frères et même des Sœurs et fit bientôt sa compagnie habituelle des bourgeois voltairiens. Il se laissa surtout conduire par M. Imbert boulanger, qui lui fit faire bien des sottises. Il est vrai qu’ils se fâchèrent plus tard, et que M. Imbert fut un des plus persécutés par les amis du curé (M. IMBERT conseiller municipal de 1843 à 1852).
Les pauvres Frères, se voyant complètement délaissés du curé, quittèrent un jour Chantonnay sans rien dire, et retournèrent à St Laurent (sur-Sèvre). Leurs supérieurs après les avoir blâmés les firent retourner, et quelques jours après, M. l’abbé Soyer, vicaire général, vint à Chantonnay faire des reproches à M. Hamel.
La leçon ne dura pas longtemps, et ce pauvre M. Hamel, qui manquait de plus en plus de jugement, continua par sa manière d’agir, à mécontenter tout le parti religieux de Chantonnay. C’est à cette époque, en 1846 et 1847, qu’eurent lieu les fameuses histoires de « la Vache à Colas ». La bande de la vache à Colas était formée par tous ceux qui étaient contre le curé. Il y eut un grand nombre de chansons impies et même obscènes, composées par les bourgeois irréligieux et même par M. de St Mars (Calixte Lebœuf de Saint Mars, habitant le logis de l’Ernière, conseiller municipal de 1833 à 1846) et tournant en ridicule tout ce qu’il y avait de bien, toutes les personnes respectables (sous des noms d’emprunt), même l’Évêque. Ce fut alors à Chantonnay un vrai schisme.
Enfin M. Hamel fut interdit le 8 décembre 1847. C’est M. de Liniers, missionnaire de St Laurent, qui fut chargé par Monseigneur de notifier cette interdiction en chaire. Il avait l’ordre de rester à Chantonnay pour administrer la paroisse, avec M. l’abbé Audin comme vicaire, et d’habiter chez M. Trottin près de l’église.
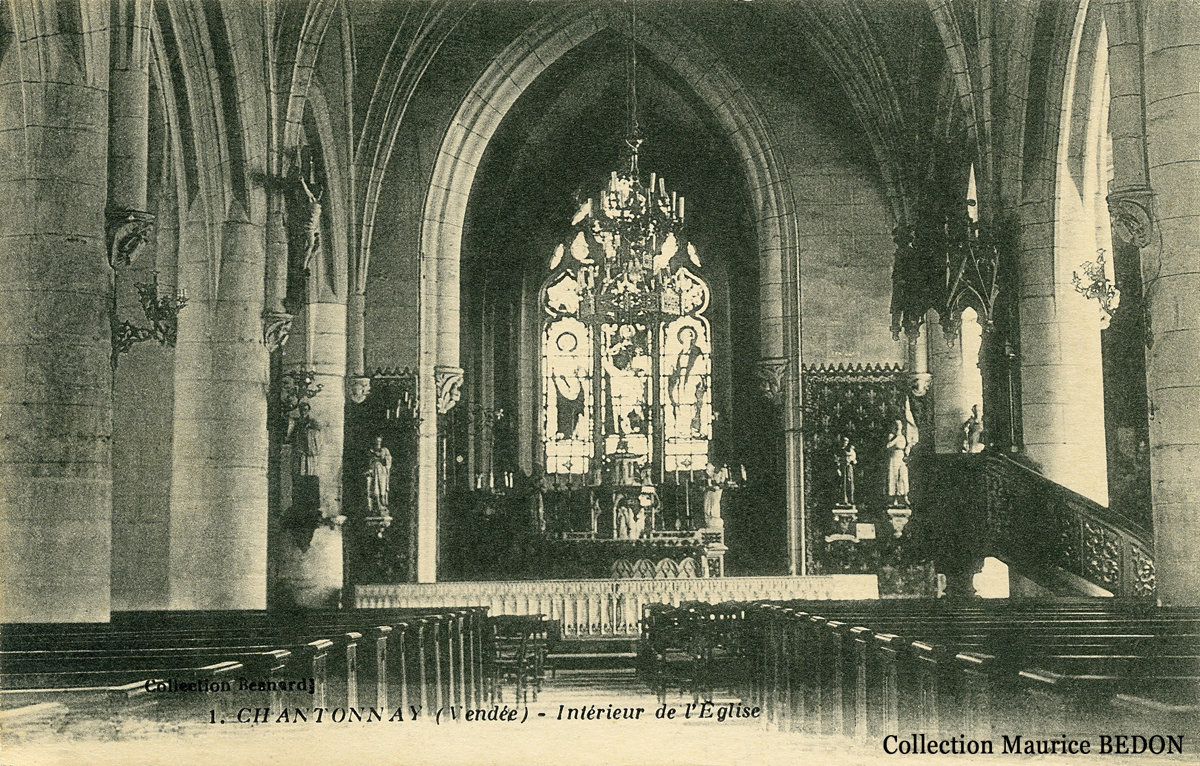 Intérieur de l’église
de Chantonnay vers 1905 (la chaire était déjà présente en 1847).
Intérieur de l’église
de Chantonnay vers 1905 (la chaire était déjà présente en 1847).
Quand M. de Liniers voulut lire en chaire la lettre de Monseigneur, ce fut un tapage infernal provoqué par la bande des bourgeois sectaires qui s’étaient donné rendez vous à l’église pour la circonstance. On dit même qu’un groupe de « charmantes jeunes filles », tenant leurs deux sabots dans leurs mains, les frappaient l’un contre l’autre pour empêcher M. de Liniers de se faire entendre. A partir de ce jour, M. Hamel assista à la première messe au fond de l’église avec les fidèles.
La révolution de 1848 enhardit les révoltés de Chantonnay. Le père de Liniers fut obligé de retourner à St Laurent et le pauvre vicaire de demander l’hospitalité au curé de Saint Mars des Prés. Donc plus de messes à Chantonnay et M. Hamel va à la messe à St Mars. Que le carême de 1848 fut triste. Quelques personnes cependant se réunissaient le soir à l’église pour dire le chapelet. Les commerçants trouvant que cette situation ne favorisait pas beaucoup leurs affaires commençaient à réclamer.
A la fin de mai 1848, M. l’abbé du Tressay, curé de l’Ile d’Elle, est nommé Curé Doyen de Chantonnay. M. Hamel occupant toujours le presbytère sous la protection des autorités, M. du Tressay fut obligé d’habiter au bas de la rue du Commerce. Sa vieille mère, qu’il avait avec lui, ne pouvait se faire à ce modeste logement ; mais lui, qui ne voyait que le bien, attachait peu d’importance à ce détail. (Georges du Tressay, curé doyen de Chantonnay de1849 à 1862).
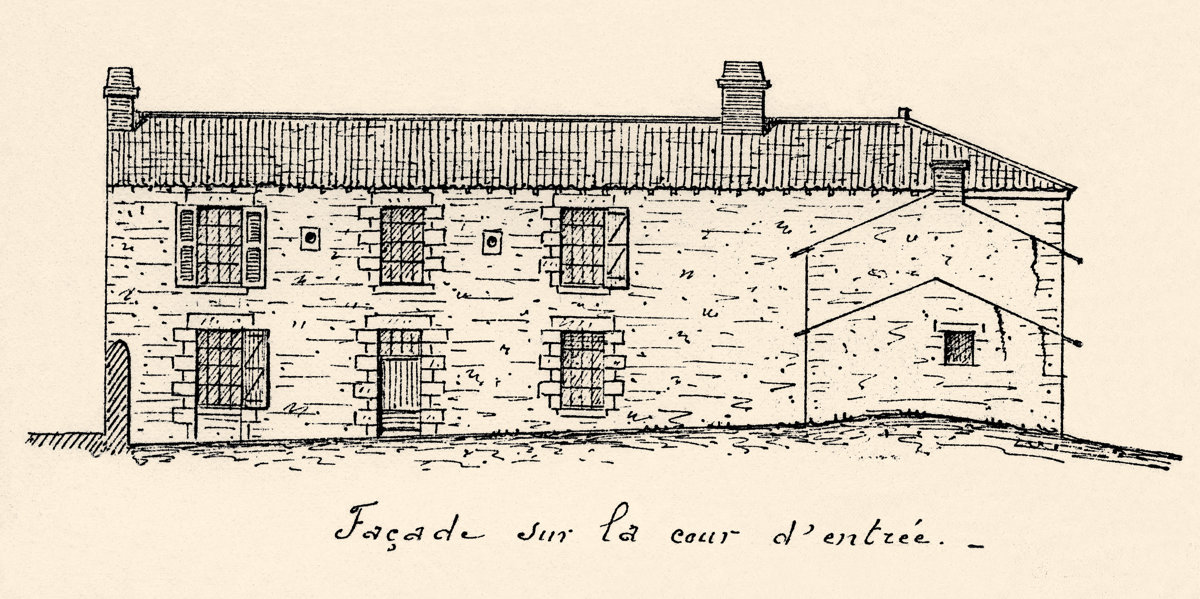 L’ancien presbytère de
Chantonnay avant 1876.
L’ancien presbytère de
Chantonnay avant 1876.
Ce n’est qu’au bout d’un an que M. Hamel reçut de la Préfecture l’ordre de se retirer du presbytère. Il eut encore le courage de rester pendant quelques temps à Chantonnay, dans un appartement situé place de la Mairie. Mais M. du Tressay gagnant de plus en plus l’estime de la population, le pauvre dévoyé vit peu à peu ses partisans l’abandonner. Il fit enfin sa soumission à Monseigneur, et après avoir passé un mois chez les Trappistes, il se retira aux Sables. Peu de temps après, la pacification religieuse se fit complète.
 La façade de la nouvelle
église.
La façade de la nouvelle
église.
C’est vers 1856 ou 1857 (c’est en fait au début de 1856) que M. du Tressay entreprit la reconstruction de l’église …/...Le conseil municipal fit tout d’abord une opposition, très violente à ce projet de reconstruction ; mais le préfet, qu’on était allé trouver, ayant dit de passer outre, les autorités y mirent ensuite toute la bonne volonté possible, et cédèrent même la petite place du nord pour faire une troisième nef (la nef du Sacré-Cœur) ».
Par délibération en date du 25 octobre 1856, le conseil municipal et son Maire Benjamin Liébert acceptèrent même de détruire la prison et la maison de Justice situées à cet emplacement (il est vrai en ruines et inutilisés depuis 10 ans !). L’ordre et la sérénité régnait de nouveau dans la paroisse de Chantonnay.

LE TRAM MONTAIGU-L’AIGUILLON
Le « tram » ou même le tramway n’étaient pas l’appellation officielle de ce moyen de transport, puisqu’on devait dire au contraire chemin de fer à voie étroite ou chemin de fer à voie métrique. Il se différenciait du chemin de fer ordinaire par une largeur de voie plus faible 1 mètre au lieu de 1,40 mètre (en France) et par des infrastructures beaucoup plus légères. La confusion venait du fait que sur les wagons de ce petit train était écrit « Compagnie des Tramways de Vendée ».
Le train (actuel SNCF) était apparu pour la première fois en Vendée le 24 décembre 1866 avec l’inauguration de la première ligne du département Nantes / Napoléon-Vendée (c'est-à-dire La Roche-sur-Yon). Le premier petit train pour sa part avait fait son apparition le 11 août 1896 sur la première ligne à voie étroite Challans / Fromentine. La compagnie qui gérait ce dernier avait aussi créé en 1898 un véritable tramway reliant le remblai des Sables d’Olonne au casino des pins de la Rudelière.
En réalité, la ligne qui nous intéresse ici, celle de Montaigu à l’Aiguillon-sur-Mer (du Nord au Sud du département) n’a pas été ouverte en une seule fois ; elle a été construite par tronçons, inaugurés à des dates successives : 1 - Chantonnay / Sainte-Hermine (le 10 juin 1900), 2 - Sainte-Hermine / Luçon (le 15 septembre 1900), 3 - Montaigu / Les Quatre-Chemins de l’Oie (le 15 mai 1901), 4 - Luçon / L’Aiguillon (le 14 août 1901) et enfin Les Quatre-Chemins / Chantonnay (seulement le 1er janvier 1908).
 La gare de Montaigu.
La gare de Montaigu.
Sur la carte postale ci-dessus, réalisée par Artaud-Nozais de Nantes vers 1905, le train, arrivant de La Roche-sur-Yon, entre en gare de Montaigu. Dans cette ville, la gare était commune au grand et au petit train, il s’agissait de celle de la ligne Nantes / Bordeaux. Cette station est encore aujourd’hui située au nord de la ville près de la Route Nationale 137 (aujourd’hui RD 137). A partir de là, le petit train contournait complètement l’agglomération par l’Ouest pour rattraper l’accotement de la 137 au sud de la ville. Une deuxième gare se trouvait ensuite 4 kilomètres 700 plus loin, à Saint-Georges-de-Montaigu en bordure de la même route. Sur la carte postale ci-dessous on aperçoit la bifurcation permettant éventuellement à deux trains de se croiser et l’aiguillage. Nous allons retrouver plusieurs fois le long de cette ligne le même type de gare avec deux locaux : une salle d’attente avec guichet et un hall pour les marchandises.
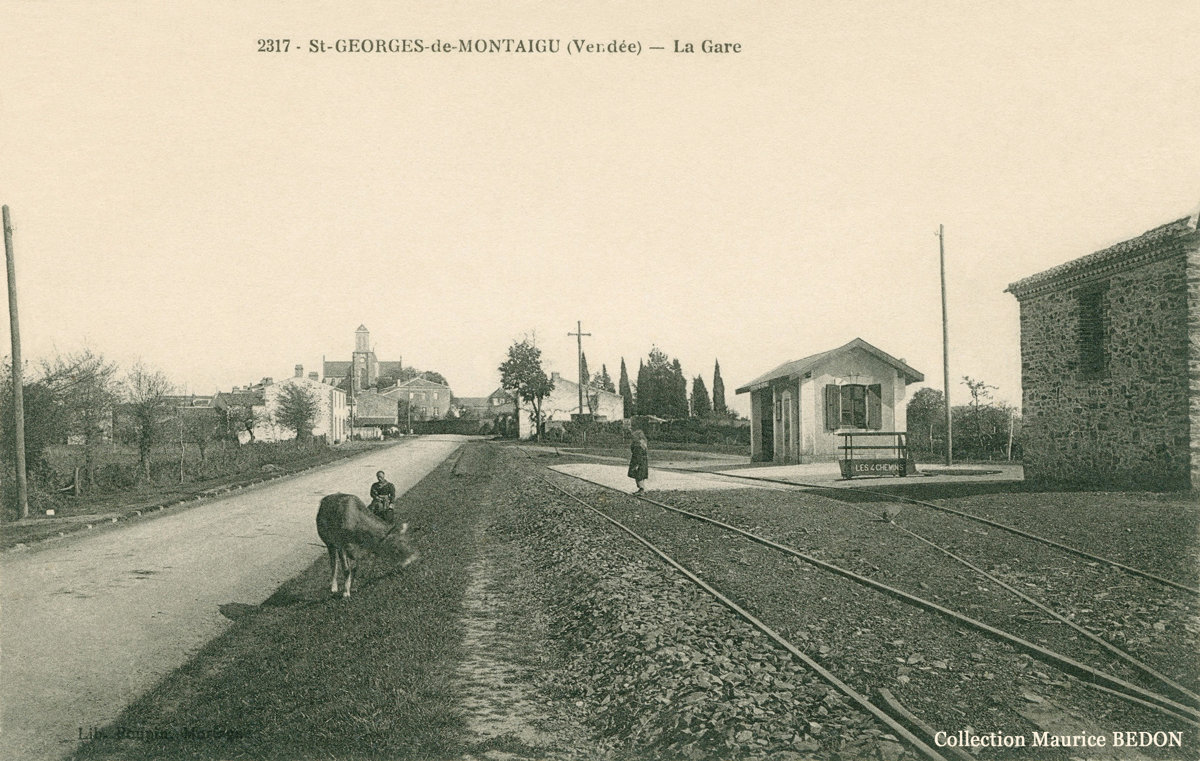 La gare de Saint-Georges-de-Montaigu.
La gare de Saint-Georges-de-Montaigu.
Après Saint-Georges-de-Montaigu le tram poursuivait son chemin toujours sur l’accotement de la route 137. Huit kilomètres plus loin, il arrivait à la gare de Chavagnes-en-Paillers. En fait il n’avait pas fait l’effort de se rendre au centre de cette commune qui comprenait, pourtant, deux séminaires, plusieurs établissements religieux et en particulier l’importante communauté des Ursulines de Jésus (sœurs de Chavagnes). Le tram s’arrêtait donc au bord de la route à 2 kilomètres du centre bourg. Il poursuivait ensuite son trajet en direction de Saint-Fulgent. Six kilomètres plus loin il atteignait la gare station de Saint-Fulgent située au nord de la ville, à la hauteur de l’ancien château du Puy-Greffier. Le bâtiment de cette gare constituait incontestablement une taille au dessus par rapport à ceux déjà rencontrés, avec en particulier un logement à l’étage, des toilettes et une grande salle d’attente. Reparti, le tram traversait la ville de Saint-Fulgent, tout le long et sur le côté droit de la chaussée. Toutefois ici la situation était beaucoup moins délicate qu’à Challans, par exemple, où le tram circulait dans une voie étroite, sans trottoir et au ras des maisons. Il a, dans cette position, fait l’objet de belles cartes postales qui sont actuellement d’une grande valeur marchande. Un kilomètre après, notre petit train rencontrait une halte dénommée « Saint-Fulgent-Bourg ».
 La Gare de Saint-Fulgent.
La Gare de Saint-Fulgent.
Dans cette même commune de Saint-Fulgent, au lieu dit le Pont-Girouard, la ligne connut un grave accident assez spectaculaire en 1906. Les wagons déraillèrent et la locomotive se coucha entrainant la mort du mécanicien et du chauffeur. Le cliché de la carte postale ci-dessous a été pris grâce au pharmacien de la commune Monsieur Morat.
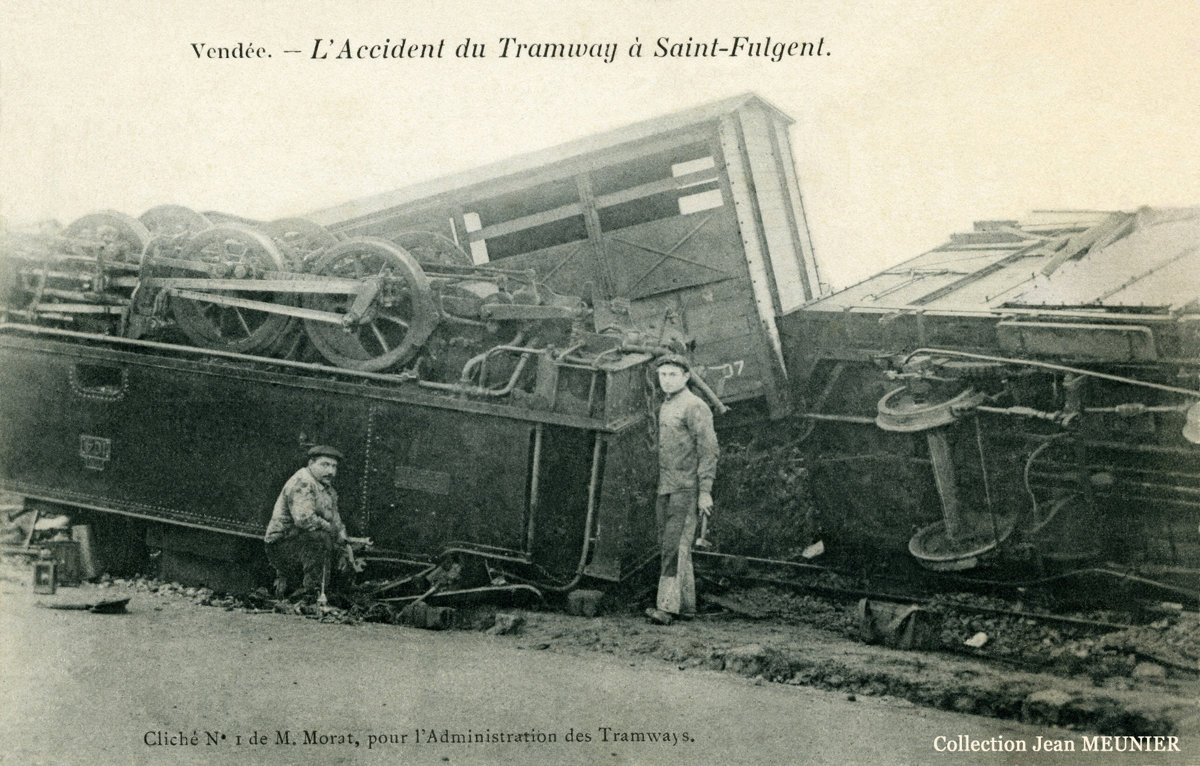 L’accident de Saint-Fulgent
en 1906.
L’accident de Saint-Fulgent
en 1906.
Le tram poursuivait ensuite son périple jusqu’aux Quatre-Chemins de
l’Oie qu’il atteignait cinq kilomètres plus loin. Au village de la Brossière,
dans un virage, il obliquait sur la gauche pour aller ensuite en diagonale
rejoindre la gare d’une autre ligne de tram (la Roche-sur-Yon / les Herbiers)
située sur la route de Vendrennes (c'est-à-dire la RN 160). On peut
l’apercevoir sur le plan ci-dessous. Les rails sont matérialisés par une ligne
avec des petits traits sur un côté. Le long de la route, cette ligne se confond
avec celle de la route et seuls les petits traits dénotent sa présence. Il y a
un point noir au bout d’un trait à chaque fois que le tram coupe une route et
en principe un petit rectangle noir à l’emplacement des gares.
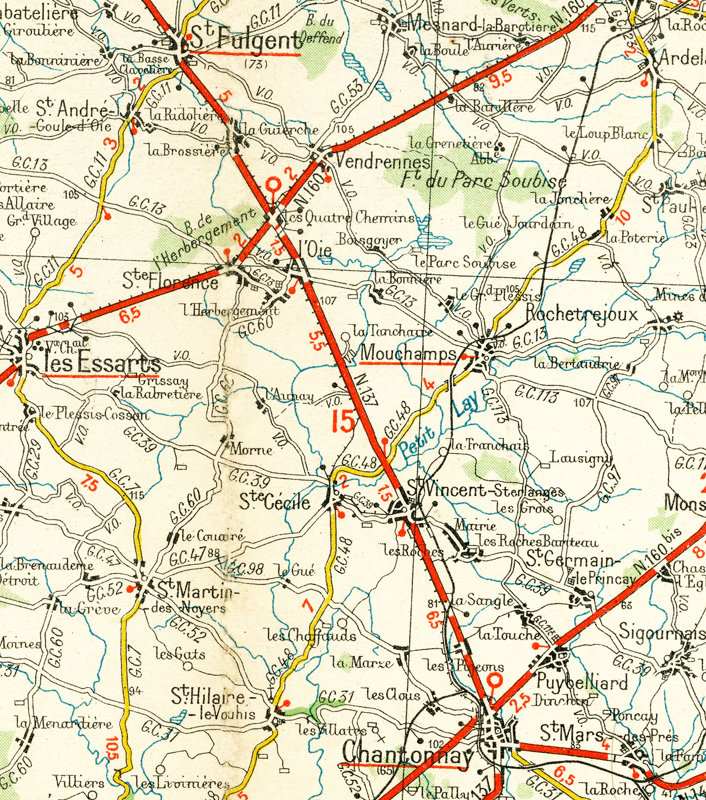 Extrait de la carte
Michelin de 1927.
Extrait de la carte
Michelin de 1927.
Le voyage Montaigu / Les Quatre-Chemins avait coûté 1 Franc 90 aux voyageurs de 1ère classe et 1 Franc 40 à ceux de 2ème classe. Le tram parti de Montaigu avait déjà parcouru 26 kilomètres en 1 heure ¼, ce qui ne constituait pas une grosse moyenne mais qui était en plus aggravé par des retards très fréquents. On comprend mieux pourquoi ce moyen de communication était surnommé ironiquement « le tortillard » ou bien « le tacaud ». On allait jusqu’à prétendre qu’on pouvait le doubler en roulant à bicyclette et que les voyageurs devaient descendre pour le pousser dans les côtes !!!
Aux Quatre-Chemins de l’Oie le train emprunté depuis Montaigu repartait dans l’autre sens. Il fallait donc changer de train et la correspondance n’était pas immédiate. Nous avons dit que cette portion de ligne (Les Quatre-Chemins / Chantonnay) avait été réalisée 7 ans après les autres tronçons parce qu’on la soupçonnait de ne pas être rentable. En repartant, le tram traversait la RN 160 et recoupait de nouveau la RN 137 (par une sorte de passage à niveau tout juste signalé mais non gardé) pour revenir à la direction d’origine et s’arrêter 1 km 500 plus loin.
 La halte de l’Oie-Bourg.
La halte de l’Oie-Bourg.
Sur cette carte postale, prise d’un peu loin, on aperçoit le tram venant de Montaigu et entrant à la halte de « l’Oie-Bourg » située au nord de l’agglomération. Nous sommes ici dans la partie tardive du tracé (ouverte seulement en 1908) et on aperçoit déjà une différence notable. Les gares sont, sur ce tronçon, de véritables petites maisons en pierres apparentes de couleur brune. Elles ont d’ailleurs été vendues ensuite pour un usage d’habitation. Autre différence, le tram va faire un écart pour aller passer dans le bourg de Sainte-Cécile, ce qu’il n’avait pas encore fait. Pour ce faire, il va quitter la RN 137 avant le village de la Ferrandière, tourner sur la droite, et se rendre directement en diagonale jusqu'à l’entrée du bourg de Sainte-Cécile. Sept kilomètres après l’Oie, il traverse le bourg et arrive ainsi en gare de Sainte-Cécile. Cette dernière est sans doute, à ce jour, une des plus belles et des mieux conservées du département. On remarquera qu’une cheminée a même été prévue pour mettre un poêle. Ce type d’édifice se retrouve aussi à l’Oie et à Saint-Vincent-Sterlanges. Sur cette photo on n’aperçoit pas les voies puisque le train à voie étroite s’arrêtait derrière le bâtiment.
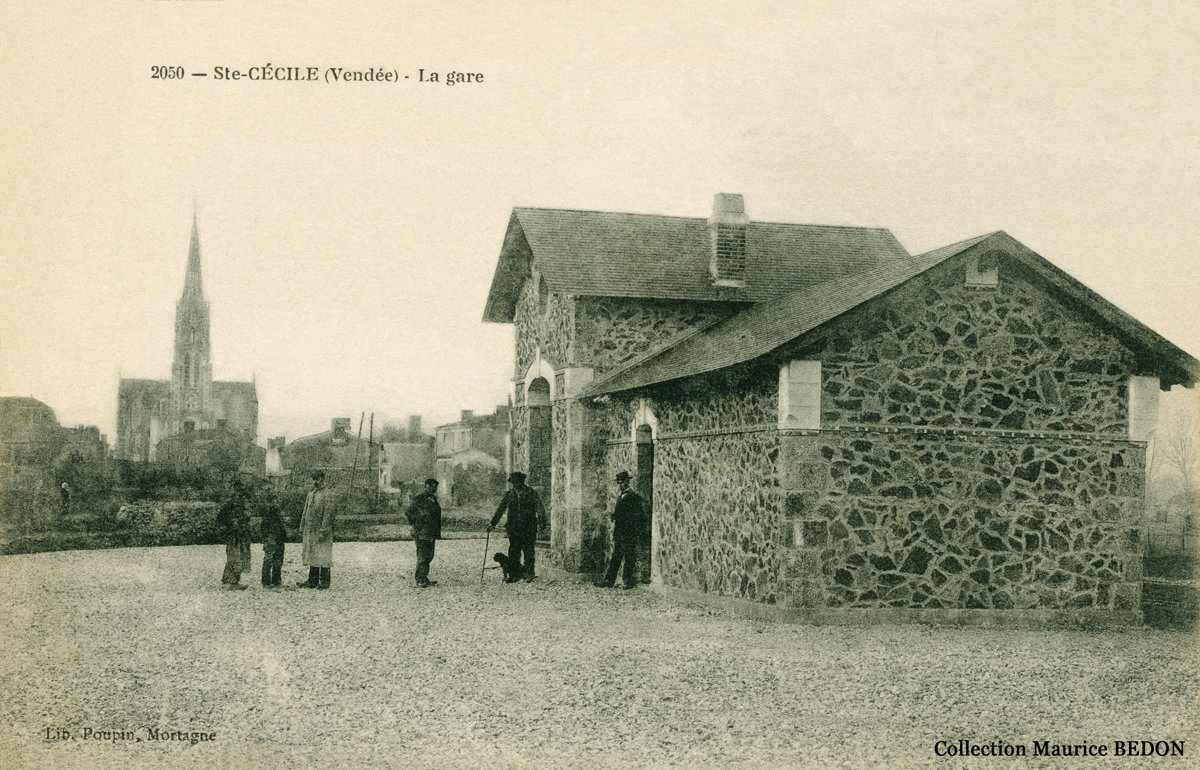 La Gare de Sainte-Cécile.
La Gare de Sainte-Cécile.
Suivant maintenant la petite route, le tram se dirigeait vers Saint-Vincent-Sterlanges et y arrivait après un court parcours de 2 kilomètres 500. A cet endroit il coupait en biais la place principale puis il reprenait l’accotement sur le côté droit de la RN 137. Après 1914 Saint-Vincent-Sterlanges possédera deux gares distinctes et distantes d’1 kilomètre 500 environ : - celle de la ligne de chemin de fer Fontenay / Chantonnay / Cholet à l’est de la ville sur la route des Roches-Barritaud et - celle du tram sur la route de Chantonnay (RN 137). La carte postale ci-dessous nous permet de nous rendre compte de l’importance inattendue du transport de marchandises sur le fonctionnement de la ligne.
 Le trafic en gare de Saint-Vincent-Sterlanges.
Le trafic en gare de Saint-Vincent-Sterlanges.
Le tram continuait sur le bas-côté droit de la route nationale. Arrivé au passage à niveau près du hameau des Aubiers, il abandonnait la route, tournait à droite et venait circuler le long de la ligne de train Fontenay / Chantonnay / Cholet. Celle-ci ne sera totalement ouverte pour les voyageurs qu’en août 1914, mais certains tronçons étaient déjà réalisés bien avant cette date. Ces deux voies jumelées montaient ensuite un talus pour pouvoir passer au dessus de la ligne La Roche / Thouars par un pont ferroviaire. Le tram arrivait ainsi, 6 kilomètres plus loin, en gare de Chantonnay par un contournement Nord-Ouest de l’agglomération. En effet, la gare de Chantonnay, construite en 1871, était commune au tram et aux autres lignes de trains. On aperçoit à peine sur la carte postale ci-dessous les grandes citernes juchées en hauteur qui permettaient aux locomotives « de faire de l’eau ».
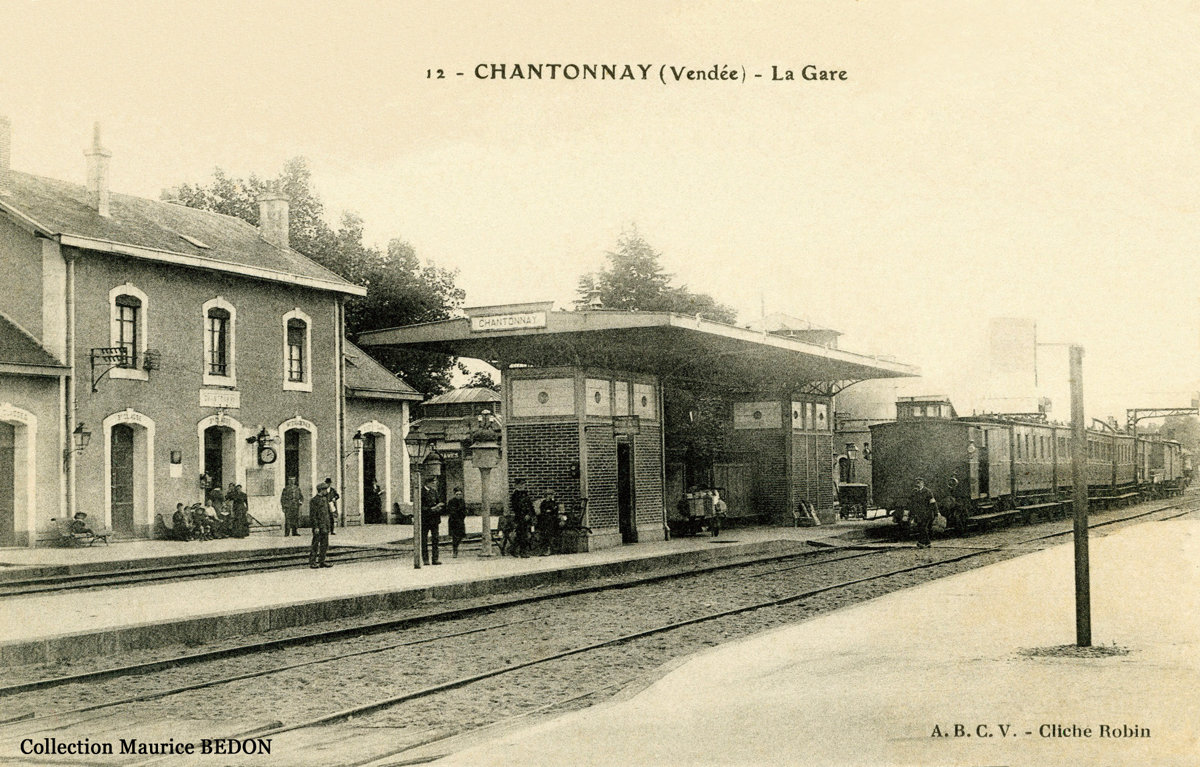 La Gare de Chantonnay.
La Gare de Chantonnay.
Pendant la première moitié du XXème siècle la gare de Chantonnay a été un véritable carrefour ferroviaire. La carte postale ci-dessous nous le montre mieux que quiconque mais pour la réaliser le photographe a du particulièrement bien choisir son moment. Le train, sur la voie 1, la plus proche de la gare, à droite, arrivait de La Roche-sur-Yon. A côté, sur la voie 2, le train venait dans l’autre sens de Pouzauges-Thouars (sur une voie unique ils ne pouvaient se croiser qu’ici). De l’autre côté de l’abri central, sur la voie 3, il venait de Cholet. Plus à gauche sur la voie 4 la locomotive arrivait de Fontenay-le-Comte. Nous trouvions ensuite deux voies réservées aux convois de marchandises. Enfin on apercevait tout à gauche la locomotive fumante du tram venant de l’Oie.
 Chantonnay, carrefour ferroviaire.
Chantonnay, carrefour ferroviaire.
Au moment de la première guerre mondiale le voyage de Chantonnay à Luçon (32 km) coûtait 2 Francs 40 en première classe et 1 Franc 50 en deuxième classe.
Pour quitter Chantonnay le tram suivait encore les lignes (SNCF) jusqu’au passage à niveau dit de la Mine sur la RN 137 au sud de la ville. A cet endroit, il les quittait et reprenait l’accotement de la route, mais cette fois-ci du côté gauche. Sur la carte postale ci-dessous, prise en direction de Chantonnay, on distingue au fond les barrières (fermées) du passage à niveau et au premier plan la route de Sainte-Hermine avec les rails du tram à droite.
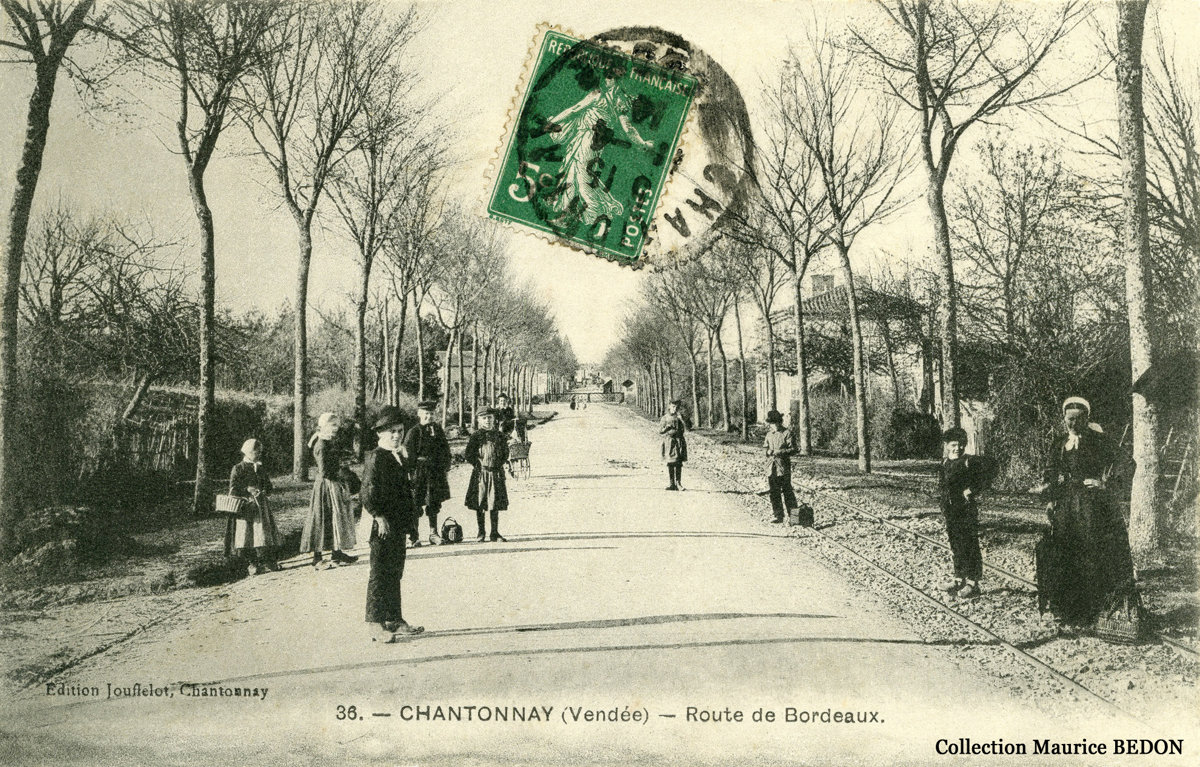 Le passage à niveau de la Mine.
Le passage à niveau de la Mine.
Arrivé au niveau de la ferme de la Mourière, la RN 137 entrait dans une zone de virages. Cet ancien cours royal, construit vers 1750, avait initialement été tracé en ligne droite. Mais, deux collines (dont l’une avec une pente de plus de 10% au lieu dit « Le Lion ») avaient provoqué des morts parmi les voyageurs des diligences. Aussi, sous le règne de Louis-Philippe, on avait remplacé la voie rectiligne par une route serpentant en lacets et possédant ainsi treize virages successifs. De sorte que le tram, pour conserver une voie à peu près linéaire, était obligé de couper fréquemment la route en passant alternativement de droite à gauche puis de gauche à droite de la chaussée. Et naturellement il opérait ce changement à chaque fois en plein virage rendant la circulation particulièrement dangereuse à cet endroit. On ose à peine imaginer ce que cette pratique provoquerait aujourd’hui avec une circulation nettement plus considérable.
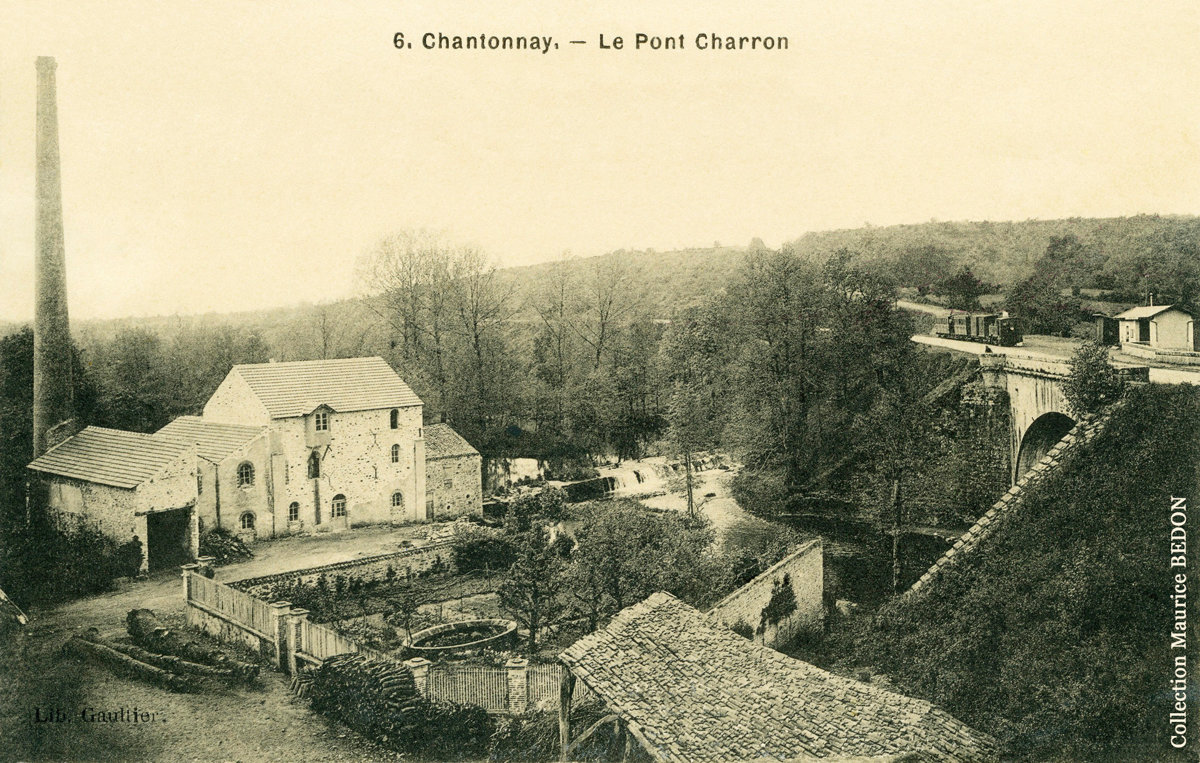 Le tram à Pont-Charron.
Le tram à Pont-Charron.
Cinq kilomètres après la gare de Chantonnay, le petit train s’arrêtait à la halte de Pont-Charron juste après l’imposant pont sur la rivière « Le Grand Lay ». Cette station n’était guère fréquentée que par les habitants du village de la Tabarière, mais elle prenait des marchandises à la minoterie et surtout à la carrière de pierres immédiatement voisines. Sur la carte postale ci-dessus on aperçoit le tram venant de Sainte-Hermine et se présentant à la halte de Pont-Charron.
 La gare du Charpre.
La gare du Charpre.
Deux kilomètres 500 plus loin seulement le petit train s’arrêtait de nouveau à la gare du Charpre. Cette dernière desservait en outre les villages de La Châtaigneraie-aux-Coteaux, le Poiserit et les hameaux voisins mais aussi le bourg de Saint-Philbert-du-Pont-Charrault pourtant distant de plus de quatre kilomètres. Sur la carte postale ci-dessus on aperçoit un wagon de marchandises stationné devant la petite gare. A un peu plus d’un kilomètre de là le tram stoppait encore à la halte du village de la Leue.
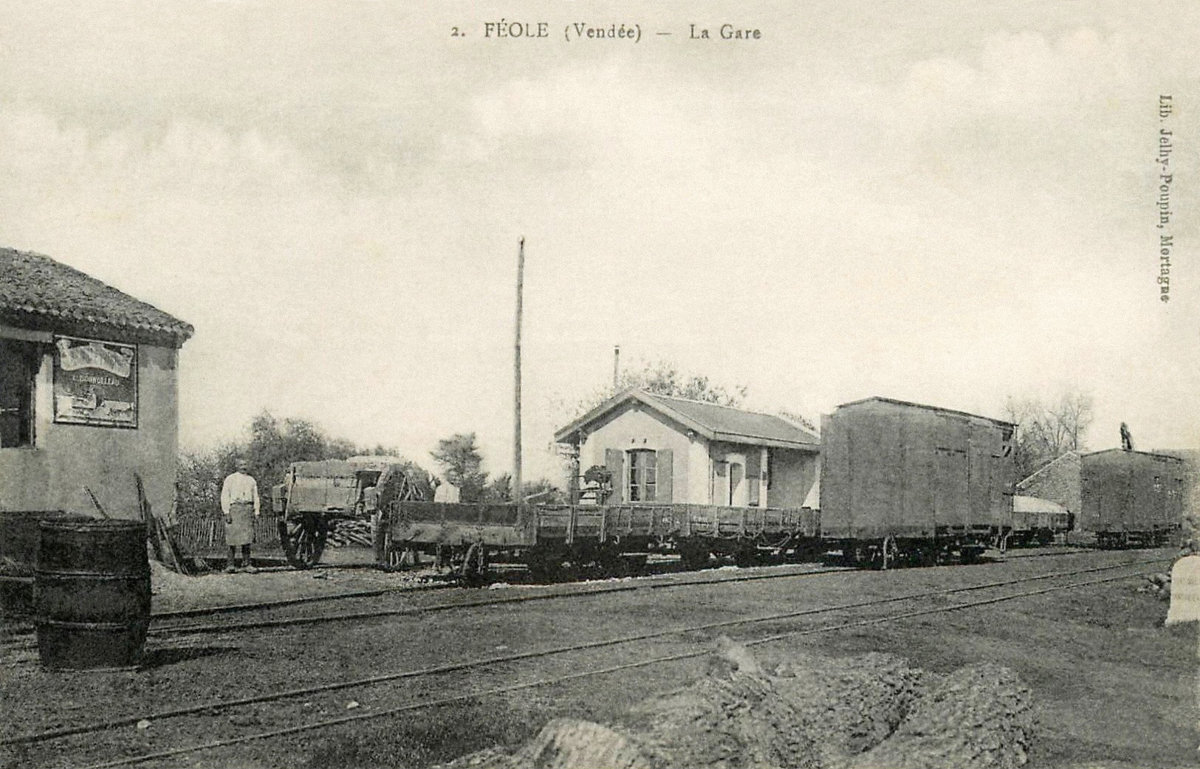 La Gare de Féole.
La Gare de Féole.
Poursuivant son chemin, toujours sur la banquette gauche de la route nationale 137, il arrivait ensuite à la gare de Féole après un parcours d’à peine quatre kilomètres. A Féole, il desservait du même coup le chef-lieu de la commune c'est-à-dire La Réorthe. Il passait ainsi juste devant l’allée du château de l’Aubraie. Toutefois, Georges Clemenceau, en se rendant dans sa famille, ne prenait pas le tram, il descendait du train venant de Paris-Austerlitz en gare de Chantonnay et se faisait ensuite conduire en voiture jusqu’à l’Aubraie. On aperçoit sur ce cliché, dans la gare de Féole comme dans la précédente, des wagons en stationnement. Certains, fermés, étaient destinés aux bestiaux et d’autres ouverts comme de simples plateaux (les wagons-tombereaux) servaient au transport des cailloux (sans doute de Pont-Charron).
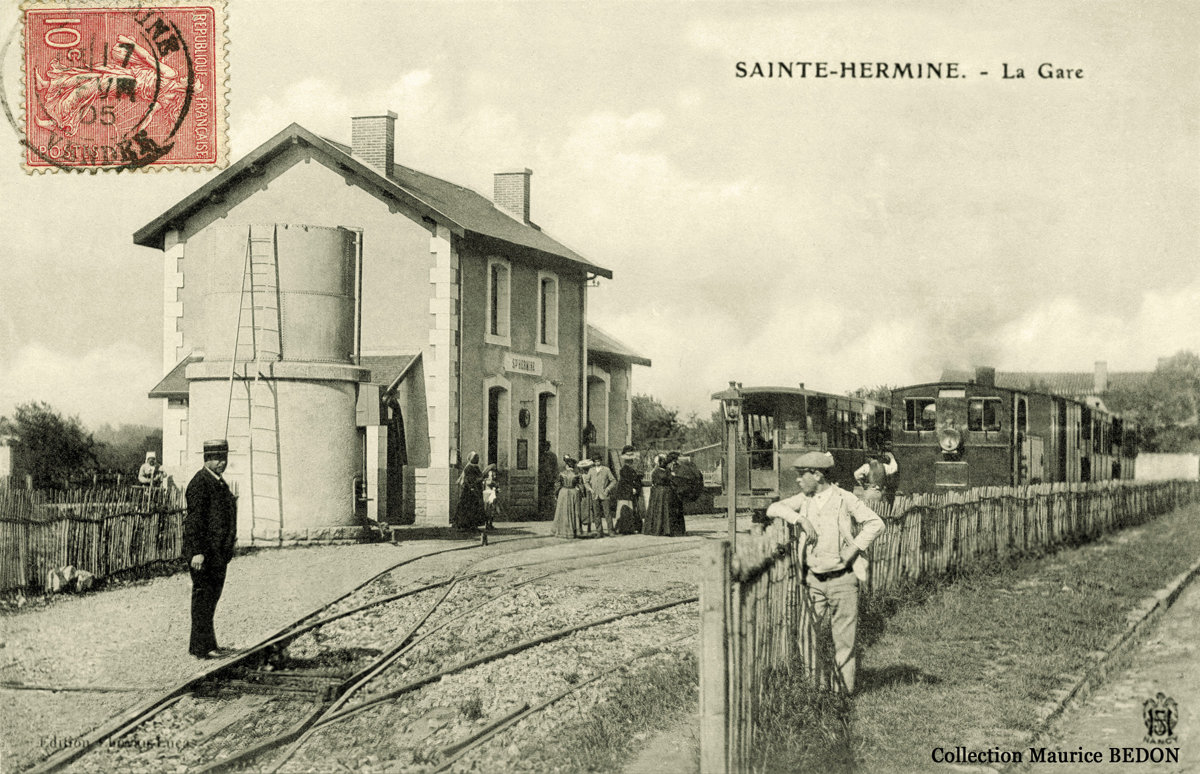 La Gare de Sainte-Hermine.
La Gare de Sainte-Hermine.
Encore cinq kilomètres et le petit train arrivait à Sainte-Hermine en face de l’actuelle Mairie. Sans compter les gares de Montaigu, Chantonnay et Luçon communes aux grands et petits trains, la gare de Sainte-Hermine était la plus importante de toute la ligne. Elle existe d’ailleurs encore aujourd’hui et a conservé sa vocation puisque la municipalité de Sainte-Hermine a eu la bonne idée de la transformer en gare routière. Sur la carte postale ci-dessus, deux trains se croisent à cet endroit: celui de droite vient de Chantonnay et celui de gauche de Luçon. En effet, le tram comme le grand train circulait à gauche suivant une habitude héritée des britanniques et toujours conservée depuis par la SNCF. On s’aperçoit également qu’avant l’installation, un peu partout, des célèbres barrières ajourées en béton, on utilisait une simple palissade en ganivelles de bois
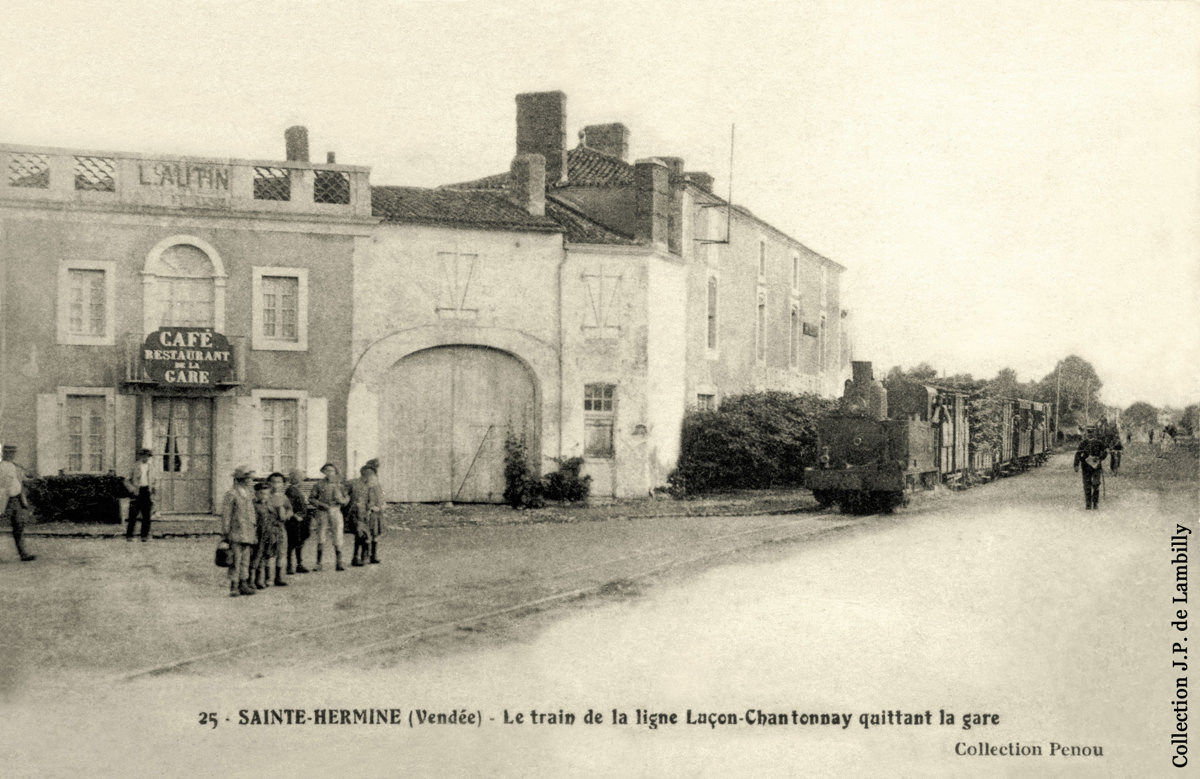 Le tram quitte la gare de Sainte-Hermine.
Le tram quitte la gare de Sainte-Hermine.
Tout juste parti de la gare de Sainte-Hermine, le petit train utilisait maintenant l’accotement du côté droit et traversait la place de Saint-Hermand (du nom de l’une des anciennes paroisses). On se rend compte assez facilement sur la photo ci-dessus que le convoi comportait successivement la locomotive, le fourgon des marchandises, un wagon de piquets de bois et quatre voitures pour les voyageurs (1ère et 2ème classe). Contrairement à que l’on pourrait imaginer la carte postale suivante (ci-dessous) n’a pas été prise par le même photographe (Penou et non pas Péré), ni le même jour que la précédente. Pourtant on y distingue un wagon identique rempli de piquets de bois, peut être utilisés pour faire les poteaux de bouchots pour les moules dans la baie de l’Aiguillon-sur-Mer.
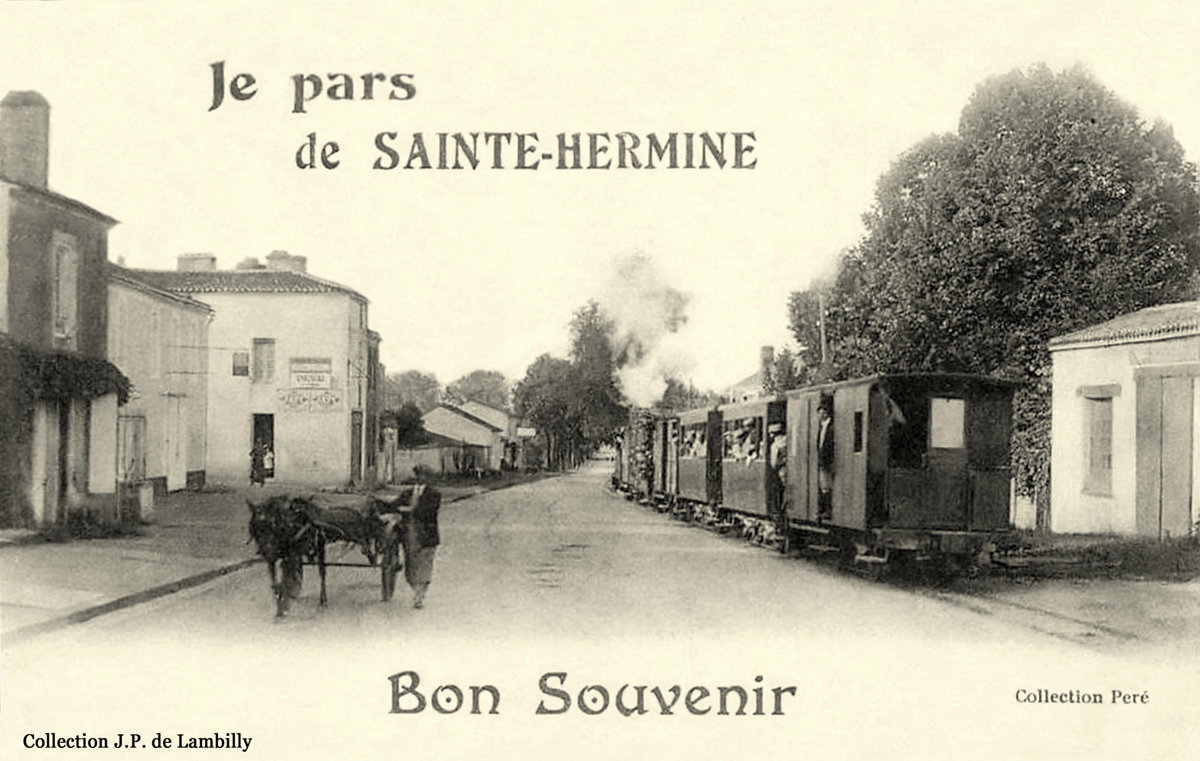 Le tram part de Sainte-Hermine.
Le tram part de Sainte-Hermine.
Au bout de cinq kilomètres à peine, le petit train, qui suivait toujours l’accotement de la route nationale 137, arrivait à la gare de Saint-Jean-de-Beugné. Et puis, encore cinq kilomètres et il traversait ensuite le bourg de Sainte-Gemme-la-Plaine. Celui que l’on aperçoit sur la carte postale ci-dessous semble venir de Luçon (sous l’œil intéressé des passants). Toujours dans le bourg de Sainte-Gemme, il abandonnait la RN 137 pour prendre une rue et rejoindre en diagonale l’ancienne route allant directement de Sainte-Gemme à Luçon.
 La traversée de Sainte-Gemme-la-Plaine.
La traversée de Sainte-Gemme-la-Plaine.
Le tram, après avoir parcouru cinq kilomètres arrivait ensuite à Luçon. Dans la ville épiscopale, il effectuait en réalité deux arrêts. - Le premier était commun avec la gare des voyageurs du chemin de fer située sur la ligne Nantes / La Roche-sur-Yon / La Rochelle ; - Le second, commun avec la gare des marchandises, était situé deux kilomètres plus loin sur le port. Sur la carte postale ci-dessous un train entre en gare à gauche, il arrive vraisemblablement de La Rochelle. Sur ce cliché, on n’aperçoit malheureusement pas l’emprise du tram qui devait obligatoirement couper la ligne de chemin de fer à Luçon. De cette dernière ville partait une autre ligne de chemin de fer à voie étroite qui se dirigeait vers Les Sables d’Olonne, via Angles et Talmont.
 La gare « SNCF » de Luçon.
La gare « SNCF » de Luçon.
Sur le plan reproduit ci-après, et qui est extrait de la carte d’état-major autour de Luçon, on peut suivre le tracé des lignes de chemins de fer et des voies du tram. Les rails de ce dernier sont ici représentés par une ligne coupée de petits traits de chaque côté que l’on aperçoit tout juste quand ils se confondent avec la route ou les voies plus larges (SNCF). Les gares sont ici indiquées par « Station » ou « Ston ».
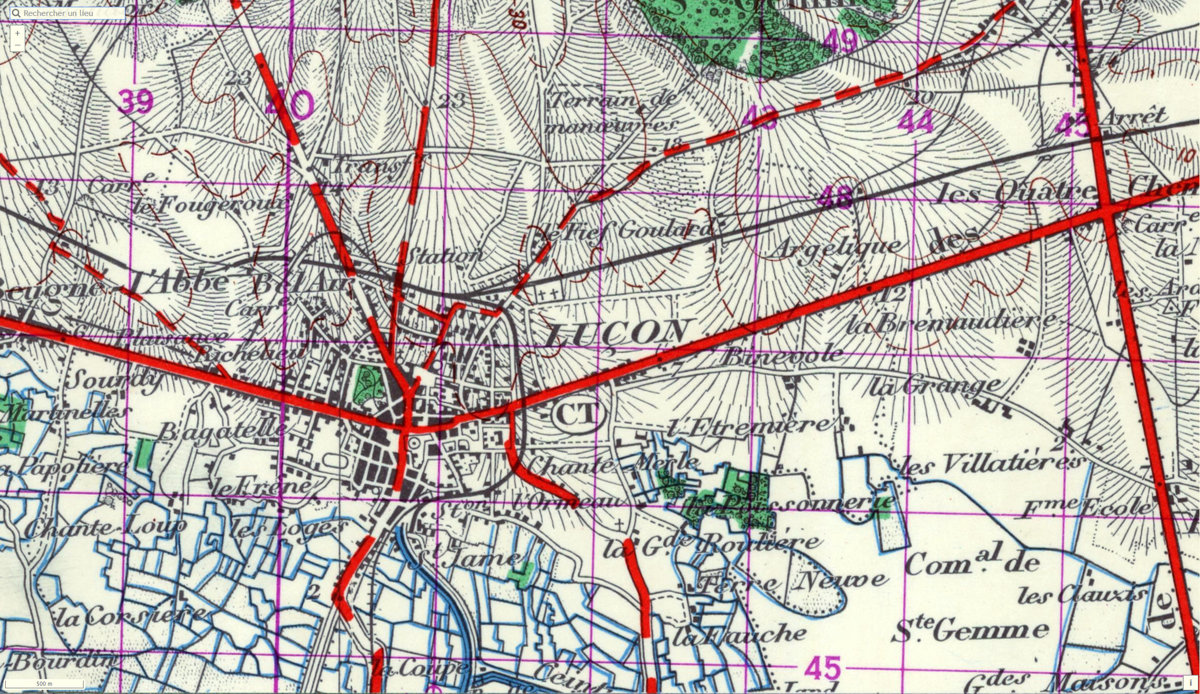 Extrait de la carte d’état-major
de Luçon.
Extrait de la carte d’état-major
de Luçon.
Le tracé de notre ligne Montaigu / l’Aiguillon enveloppait ensuite le centre ville, par une large courbe à l’Est de ce dernier, pour se diriger vers le port. En effet, la ville de Luçon disposait encore au début du XXème siècle d’un port commercial relié à la mer par un canal de 14 kilomètres. Les grands trains de marchandises (sur les voies ordinaires) venaient au port pour y livrer ou y charger des marchandises. D’ailleurs sur la carte postale ci-dessous, à gauche, des wagons du grand train sont en stationnement devant les usines ou les entrepôts construits le long du quai à l’Est du bassin. Le plus intéressant sur ce cliché, au premier plan, ce sont les palettes de retournement qui permettaient manuellement de faire tourner la locomotive ou bien les wagons à 90 degrés (virage impossible) ou à 180 degrés (retour en arrière). On aperçoit également, tout à droite, des wagons du tram en stationnement sur l’autre quai à l’Ouest du canal. Et on peut suivre ses voies qui arrivaient du côté gauche, coupaient les rails du train et effectuaient une large courbe pour se diriger ensuite vers Triaize. Le port a été malheureusement comblé à la fin du XXème siècle pour devenir un parking.
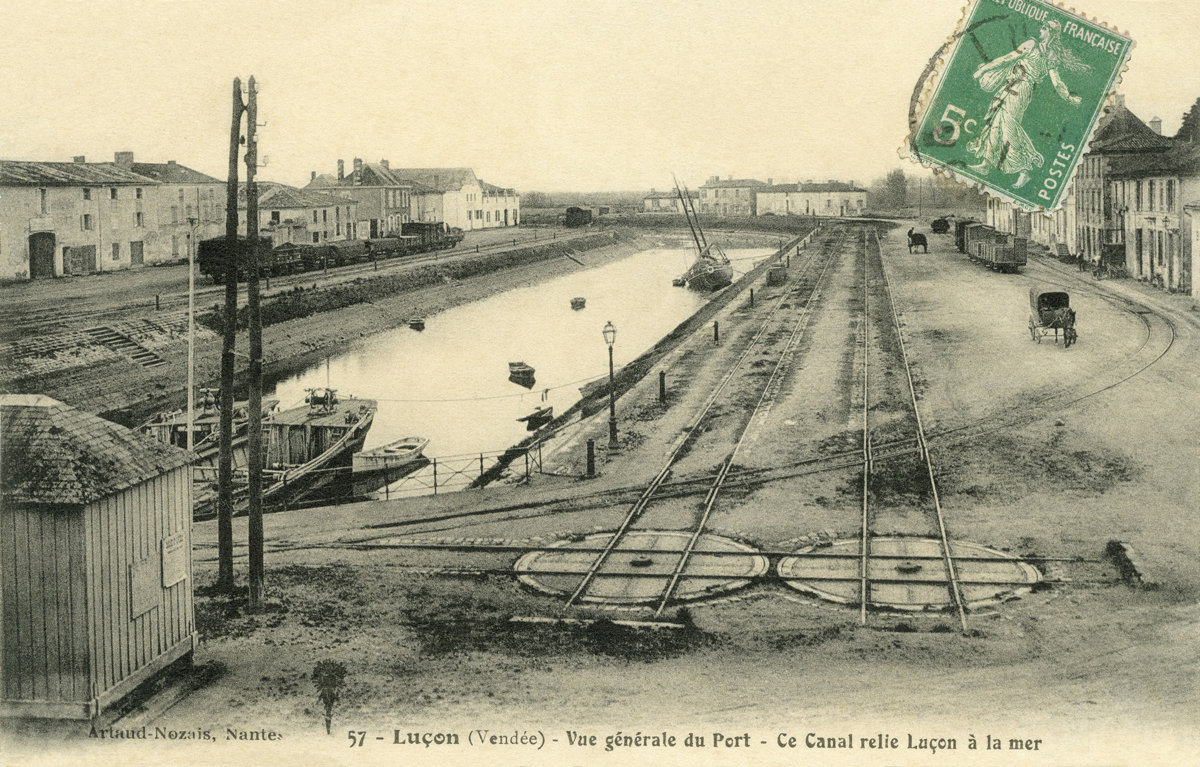 Le port de Luçon.
Le port de Luçon.
Par rapport à la carte postale précédente, la suivante a été prise (vers 1905) à l’autre extrémité du port, du côté Est. Au premier plan à gauche une locomotive et un convoi de marchandises se dirigent vers l’actuelle gare SNCF. De l’autre côté du canal, à l’Ouest, d’autres wagons attendent d’être chargés. Tout au fond à droite, juste devant les maisons, on aperçoit également le petit train qui arrive de l’Aiguillon en tractant lui aussi des wagons de marchandises. Nous avons ainsi une image vivante de l’activité du port de Luçon au début du XXème siècle.
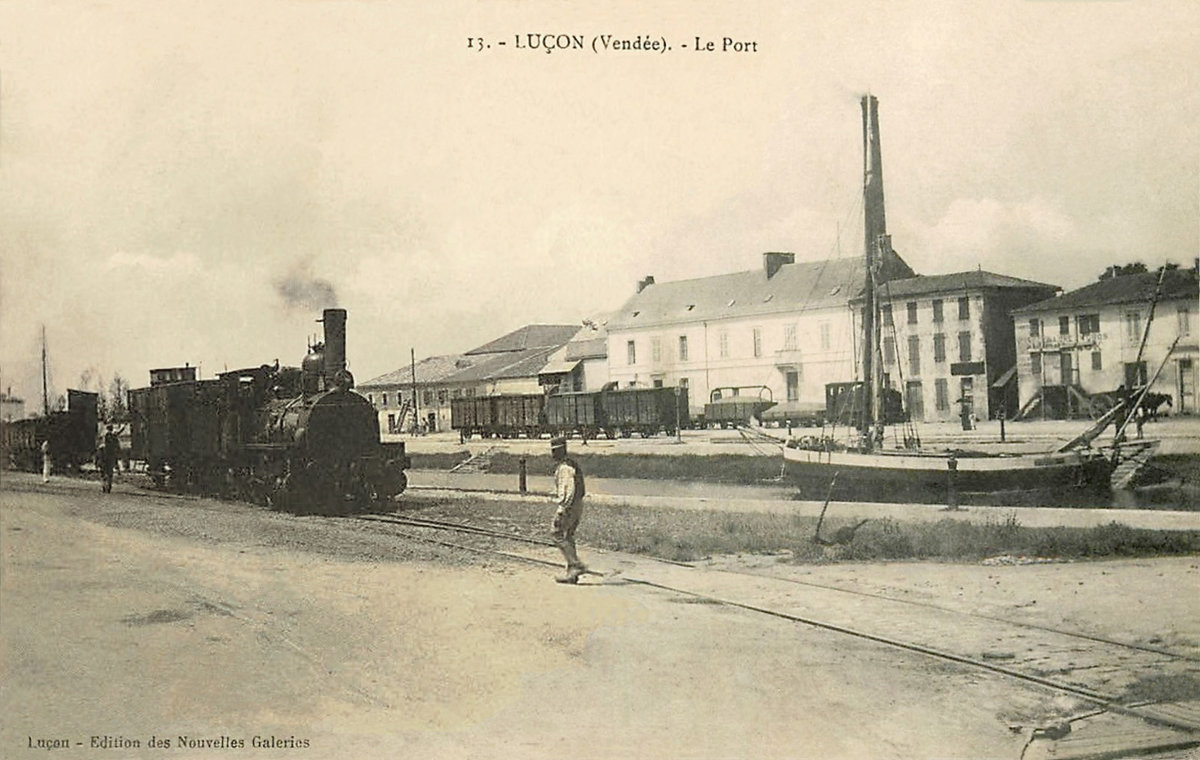 Les trains au port de Luçon.
Les trains au port de Luçon.
Sur la carte postale qui fait suite on aperçoit, sur la gauche, le tram qui vient de la gare de Luçon et arrive sur le quai Ouest du port. Le convoi comporte la locomotive, le fourgon de marchandises, trois wagons tombereaux bâchés et trois voitures de voyageurs. Il semblerait que la locomotive soit une Decauville. A l’origine, la compagnie des tramways avait surtout commandé des machines de modèle Corpet-Louvet, qui étaient préférées du fait de leur robustesse et leur fiabilité.
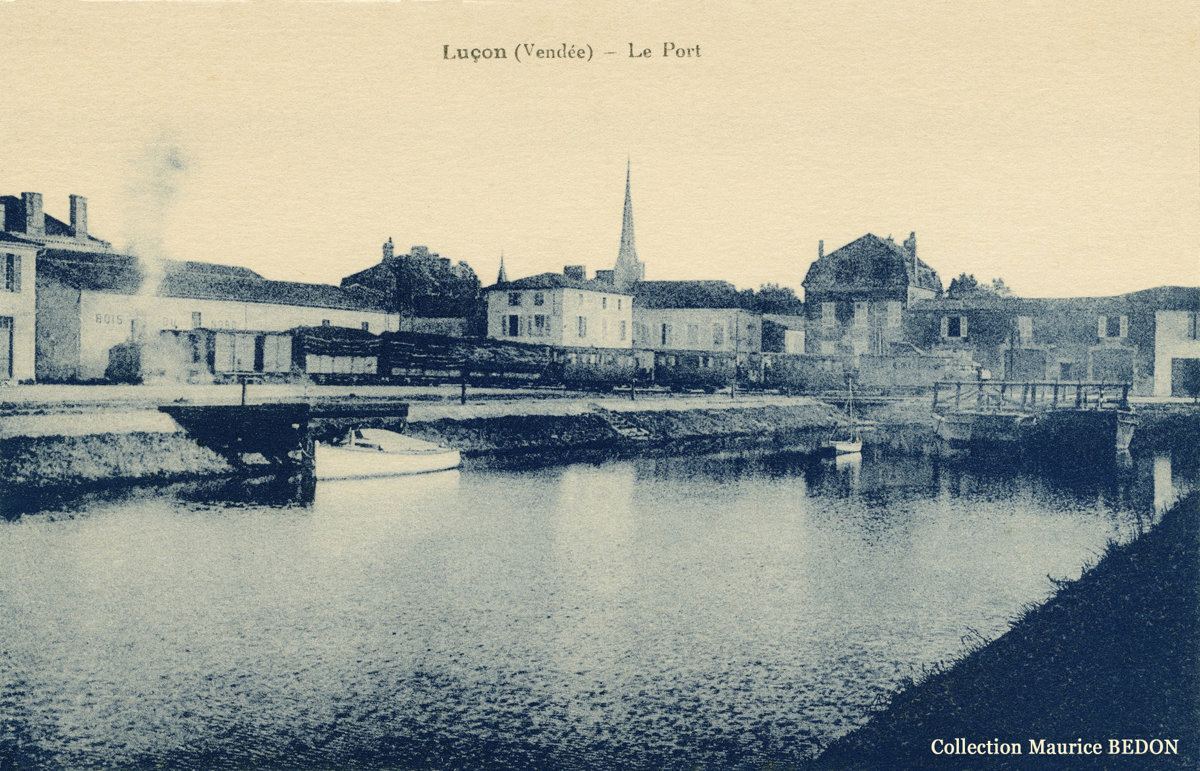 Le tram arrive au port de Luçon.
Le tram arrive au port de Luçon.
Juste après les quais du canal se situait la deuxième station de tram de la ville : « Luçon-Port ». Sur la carte postale ci-dessous le tram quitte sa petite gare. Les voyageurs descendus sont encore sur le quai et regardent le photographe. Curieusement cette face plate avec deux lucarnes et deux lanternes constituait bien la partie avant du convoi. En effet la petite locomotive était toujours obligatoirement placée en tête du convoi mais elle se retrouvait dans le mauvais sens au redémarrage après un terminus. Nous avons d’ailleurs vu précédemment une locomotive identique dans la même position à la gare de Sainte-Hermine.
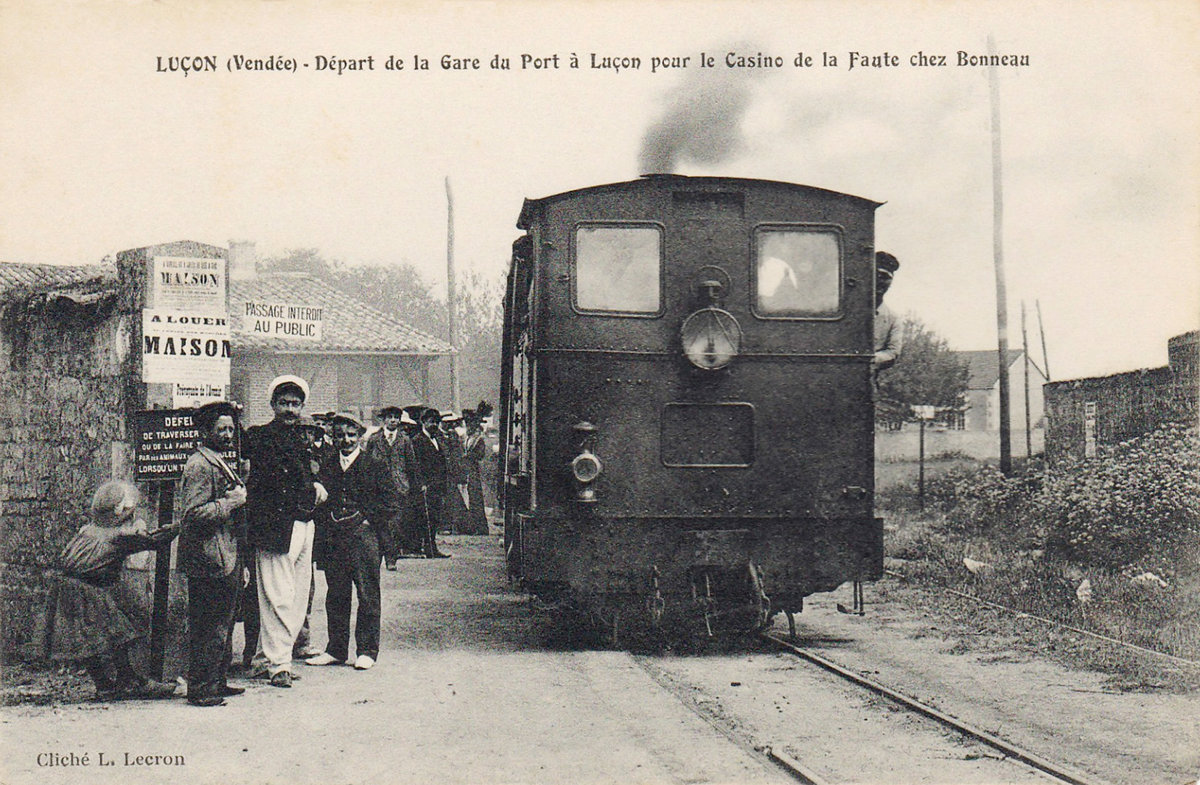 L»e tram quitte la gare de Luçon-Port.
L»e tram quitte la gare de Luçon-Port.
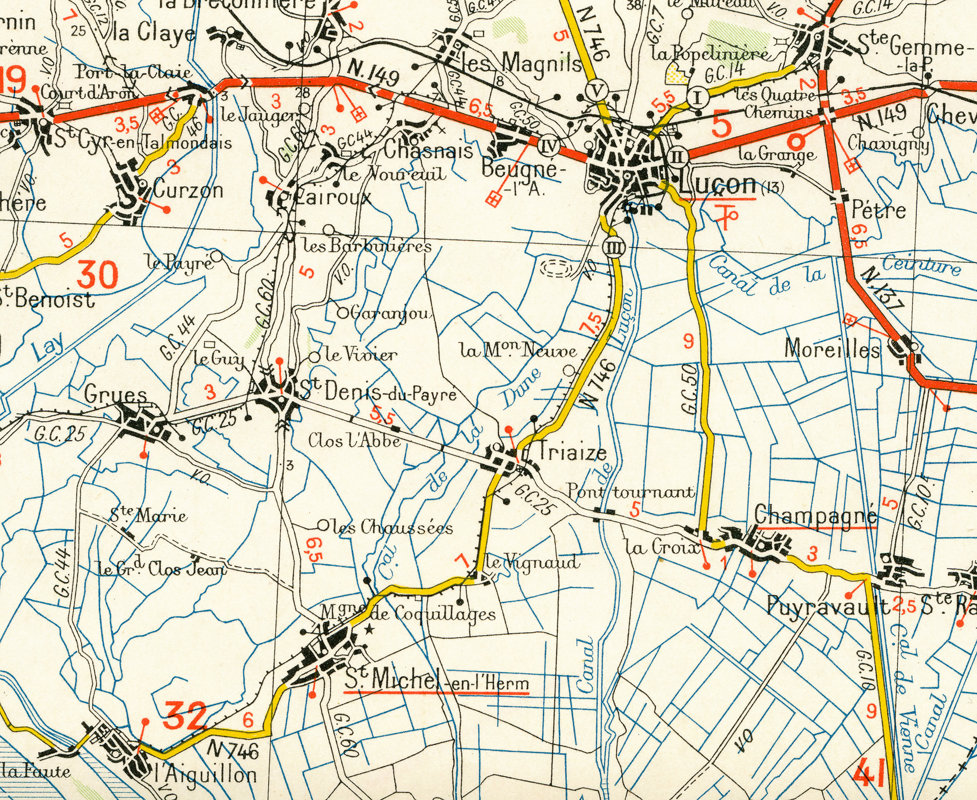 Extrait de la carte
Michelin de 1937.
Extrait de la carte
Michelin de 1937.
Sept kilomètres après Luçon-Port, il arrivait à la gare du bourg de Triaize. Si des touristes, se penchant à la portière, qualifiaient la commune de « pays des ânes » (à cause de ses célèbres compétitions asines) ils se voyaient répliquer tout aussitôt par les autochtones « il en passe plus qu’il n’en reste ». Sur la carte postale ci-dessous, on aperçoit un certain nombre de gens en tenue de travail et avec des outils, sans doute pour charger dans les wagons. Dans l’embrasure du local pour la billetterie on reconnaît l’employée de la compagnie avec un tablier et surtout un brassard distinctif de couleur.
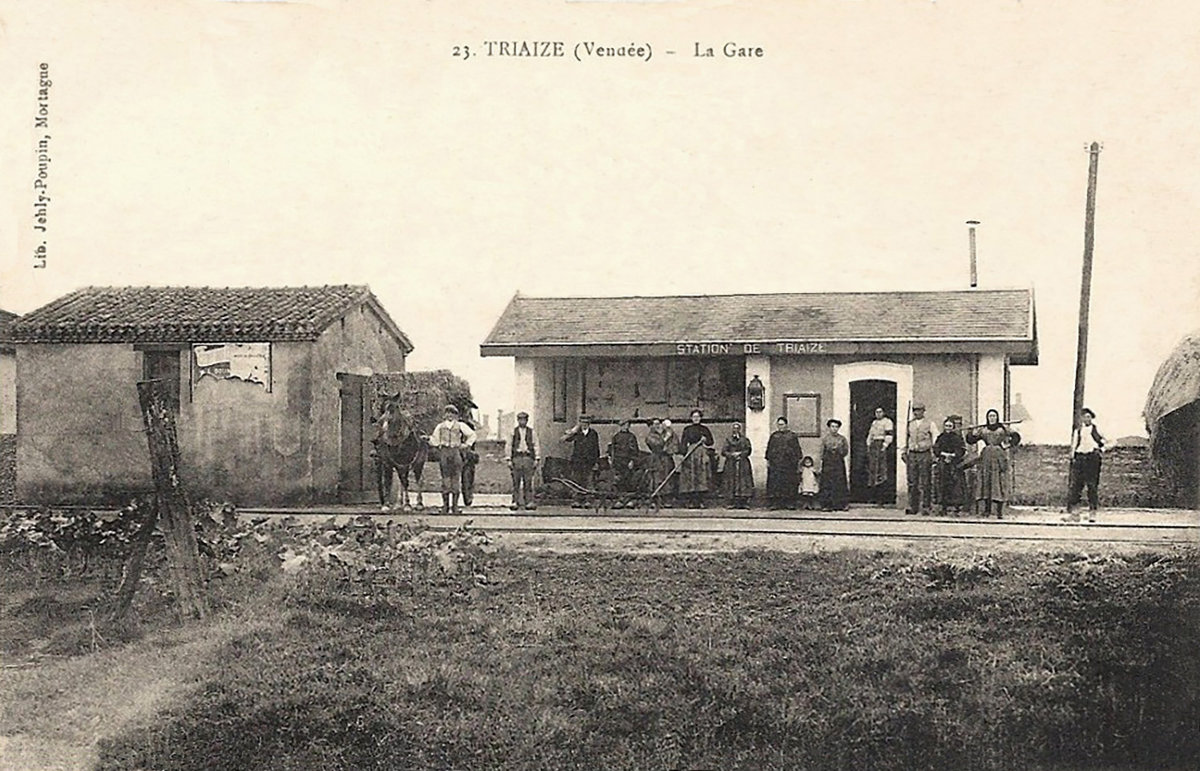 La gare de Triaize.
La gare de Triaize.
La gare de Saint-Michel-en-l’Herm, située exactement 7 kilomètres plus loin, avait au début du XXème siècle un certain dynamisme économique en raison de son importante laiterie, des activités annexes mais aussi de la carrière d’extraction de coquilles d’huitres fossilisées. Sur cette carte postale, les bâtiments de la gare, en tous points identiques à ceux de Triaize, sont tout aussi modestes. Le convoi est en gare, les voyageurs descendent des wagons, les marchandises sont déchargées des wagons.
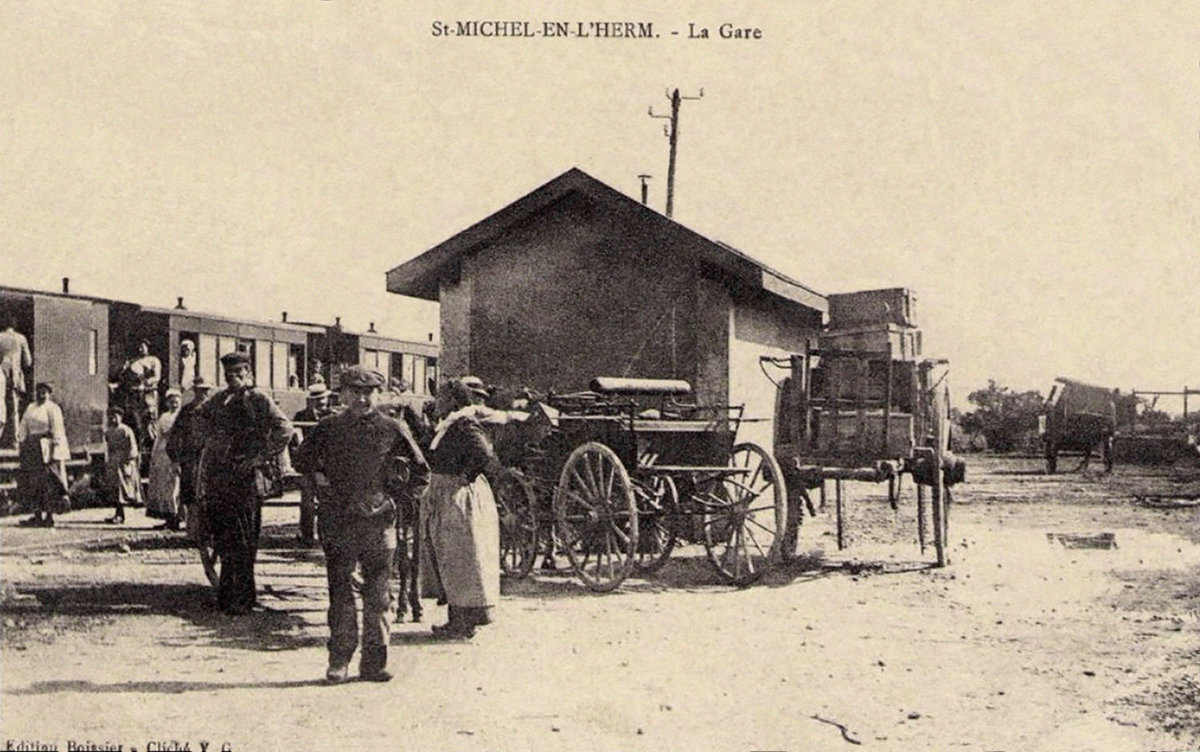 La gare de Saint-Michel-en-l’Herm.
La gare de Saint-Michel-en-l’Herm.
Après un petit parcours de cinq kilomètres seulement, le tram arrivait à la station de l’Aiguillon-Ville, située à la limite Est du bourg. Pourtant classés comme « halte » les bâtiments de la gare paraissaient plus importants et comprenaient en particulier un logement à l’étage. Deux trains semblent se croiser à ce moment là.
 La halte de
l’Aiguillon-Ville.
La halte de
l’Aiguillon-Ville.
La commune de l’Aiguillon-sur-Mer comportait donc, elle aussi, deux gares, en particulier « L’Aiguillon-Port » le terminus de la ligne, situé le long du port, dans l’embouchure du fleuve « Le Lay ». C’était le point le plus proche de la mer. Aussi, les voyageurs désirant se rendre à la plage la plus proche devaient encore franchir le Lay par le pont passerelle, à pied, puis traverser le village de la Faute. Souvent, ils ne quittaient pas la gare avant d’avoir assisté à la manœuvre qui consistait, au terminus, à tourner la locomotive sur une palette et à la conduire à l’autre extrémité pour lui faire prendre la tête du convoi de retour. Nous avons la chance de bénéficier à cet endroit d’une carte postale représentant une vue latérale du convoi avant son départ (ci-dessous). De gauche à droite nous pouvons ainsi distinguer au moins deux wagons de voyageurs, le fourgon de marchandises avec le convoyeur et la locomotive (Decauville N°1) avec le mécanicien, la burette d’huile à la main. Cette ligne Luçon / l’Aiguillon a toujours été considérée comme la plus rentable du réseau en voyageurs comme en marchandises.
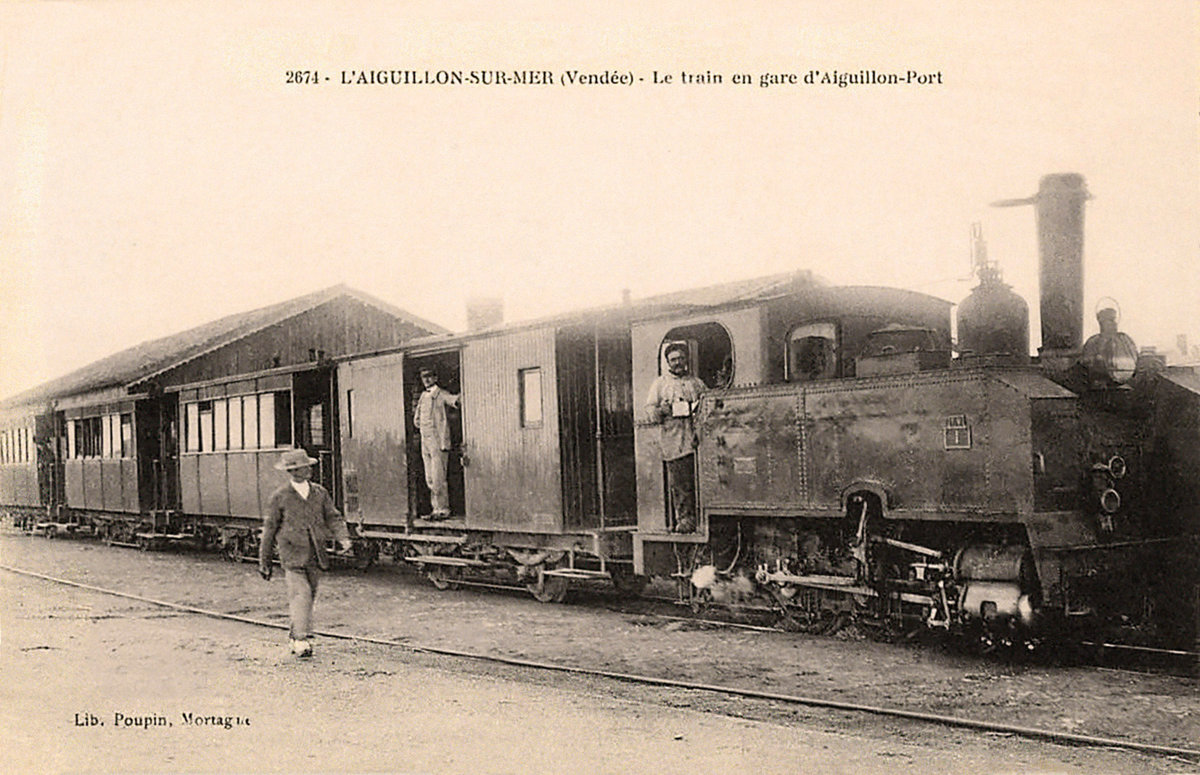 Le tram en gare de
l’Aiguillon-Port.
Le tram en gare de
l’Aiguillon-Port.
Contrairement aux autres cartes postales précédentes, datant à peu près toutes de 1905 environ, cette photo, a été réalisée par Bergevin photographe à La Rochelle (avec le sigle Ramuntcho) vers 1920. On ne compte pas moins de 10 wagons de voyageurs dans ce convoi qui attend ici le départ en bordure du quai. Certains touristes montent déjà dans les wagons pour choisir leur place, d’autres flânent encore sur les pontons pour regarder les pêcheurs. C’est par cette ligne de tram que les bourriches d’huitres, les cageots de moules de l’Aiguillon et les autres fruits de la marée remontaient vers le haut bocage vendéen au début du XXème siècle (sans wagon frigorifique, mais avec un peu de glace).
 Les voyageurs vont repartir
du terminus.
Les voyageurs vont repartir
du terminus.
Un voyageur qui partait de l’Aiguillon-sur-Mer le matin à 7 heures 12, arrivait à Luçon à 8 heures. Après 1 heure ¼ d’attente, il repartait à 9 heures 15 et arrivait à Chantonnay à 10 heures 20. Après 2 heures 40 d’attente, il repartait à 13 heures, arrivait Aux Quatre-Chemins à 13 heures 50, puis après 20 minutes d’attente, il repartait à 14 heures 10 pour arriver enfin (et en principe) à Montaigu à 15 heures 24.
Dans ces conditions, après la première guerre mondiale, le tram fut très vite largement concurrencé par les lignes d’autocar. Le trafic de voyageurs, étant désormais très peu rentable, le service fut interrompu à partir du 1er janvier 1935. Toutefois, il reprit en partie, pendant la durée de la seconde guerre mondiale. Le 1er janvier 1947 la ligne ferma définitivement de Chantonnay à Luçon. Et le dernier tronçon Luçon / l’Aiguillon réussit à se maintenir jusqu’au 31 novembre 1949.
Après cette date, les rails furent arrachés, les gares vendues et les petits trains disparurent définitivement du paysage de nos campagnes.
(Bibliographie : La Vendée des petits trains, 1987, Michel Harouy, Ed. Céromane).
Chantonnay le 15 mars 2019

LES ARMOIRIES DE LA VENDÉE
Dans le cadre de l’opération « Vendée 2040 », le Conseil Départemental a organisé une première soirée débat sur le thème de l’Identité Vendéenne, en présence de l’éminent historien Franck Ferrand, à l’école d’ingénieurs de La Roche-sur-Yon le Jeudi 31 janvier 2019. Cette conférence a été l’occasion pour certains de reparler des armoiries du département de la Vendée.
Sur ce même thème, nous avions eu l’occasion de lire un article dans une presse syndicale, il y a quelques années au moment de la création du Logo du Département le 18 septembre 1989 à l’époque du Président Philippe de Villiers. Nous ne citerons cet article que globalement et de mémoire car nous ne l’avons pas conservé. On y expliquait de façon convaincue et péremptoire que les armoiries de la Vendée avaient été données par le gouvernement de Vichy en 1943 pour rendre hommage aux Guerres de Vendée. Il nous apparaît donc utile de rappeler ici quelques réalités historiques locales.

Logo du département de la Vendée.
Ce n’est pas le gouvernement de Vichy qui a pris cette décision mais le Conseil Général de l’époque. Bien sûr, les Conseils Généraux avaient été dissous par l’État Français en 1940 et remplacés par des commissions consultatives appelées ensuite « conseils départementaux ». Les préfets avaient alors désigné un peu partout des personnes qui leur convenaient. Mais en Vendée, le représentant de l'État avait nommé 29 des 30 anciens Conseillers Généraux (élus à l’époque du Front Populaire), en éliminant ainsi un seul d'entre-eux (parce qu’il était franc-maçon). Ces conseillers ont ainsi siégé durant l’occupation, notamment en 1943 et 1944. Le Préfet avait parfois été amené à remplacer les membres décédés durant cette période, il le fit en nommant le plus souvent un des fils du défunt. Et les personnes ainsi désignées, quand elles se sont soumises ensuite au suffrage universel à l’époque de la Libération, ont été très largement élues. De sorte que, en Vendée, le Conseil Général du Front Populaire, celui de l’Occupation et celui de la Libération, cela correspond très majoritairement au même.
On peut se demander pourquoi les Conseillers Généraux avaient choisi cette période pour doter le département d’armoiries. Tout d’abord parce qu’une période d’occupation par une puissance étrangère est psychologiquement un moment de prédilection pour affirmer son identité. Et surtout parce qu’à cette époque, les décisions déterminantes étaient prises par le Préfet, et que l’assemblée départementale avait fort peu d’argent à gérer. Elle avait ainsi plus de temps pour se consacrer à des choses, qui en d’autres circonstances, n’auraient pas été considérées comme prioritaires.
Le Département a géré cette affaire d’une façon tout à fait sérieuse, en faisant participer un érudit local Jacques de Maupeou directeur d’une revue qui faisait alors autorité : « La revue du Bas-Poitou » (fondée en 1888 par René Vallette). Celui-ci, par l’intermédiaire de sa revue, a fait une sorte d’appel à projets auprès de la population et contrairement à toute attente en cette période critique, cet appel à suscité beaucoup d’intérêt. Il a ainsi été collecté beaucoup d’idées différentes et une quarantaine de projets construits et même dessinés. Ces propositions diverses pouvaient tout de même être classées en quatre catégories :
- celles qui évoquaient l’appartenance à la France et à la province du Poitou ;
- celles qui évoquaient les Guerres de Vendée ;
- celles qui évoquaient un célèbre bijou (le double cœur) ;
- celles qui évoquaient des aspects géographiques ou autres.
Il convient de préciser ici que la ligne politique générale suivie par le Conseil Général, dont nous venons de dire qu’il n’avait pas varié durant cette époque, pouvait (pour faire simple) être qualifiée de « centre droit ». Le Conseil était globalement revenu à la ligne de l’union sacrée mise à l’ordre du jour pendant la première guerre mondiale ; c’est dire qu’il évitait les positions qui pouvaient apporter de graves divisions dans son sein.
C’est la raison pour laquelle, par exemple, le Conseil Général n’a pas retenu un projet qui évoquait seulement Les Guerres de Vendée, celui de Pascal Lanco. D’autant plus qu’il n’était pas particulièrement esthétique ni rigoureux en matière d’héraldique. En effet, il accolait sur un seul écu le bleu et le rouge alors qu’on ne peut associer « métal sur métal » ou « émail sur émail » (« Azur » et « Gueules ») à moins de le faire avec plusieurs blasons « cousus ».
A ce niveau, il convient aussi de parler maintenant du célèbre motif au double cœur. Ce thème n’est pas spécifiquement vendéen, puisqu’il apparaît vers la fin du XVIIème siècle dans beaucoup de provinces de France. En effet il évoque alors exclusivement l’association de deux cœurs et décore donc les cadeaux de fiançailles ou de mariages. Nous publions ici deux objets pour illustrer ces habitudes : un miroir originaire de Provence utilisé comme cadeau de mariage et une assiette de mariage originaire de l’Ouest de la France, tous les deux décorés de deux cœurs enlacés.
 Miroir provençal du
XVIIIème siècle
Miroir provençal du
XVIIIème siècle
 Assiette de Mariage
du XVIIIème siècle.
Assiette de Mariage
du XVIIIème siècle.
Ce qui est spécifiquement bas-poitevin à la fin du XVIIIème siècle et utilisé principalement dans la région de Challans, c’est le bijou au double cœur évidé. Cet objet généralement en argent massif, surnommé la Guimbarde, était offert au promis lors des fiançailles et servait à fermer le col de la chemise. Là aussi c’était un motif amoureux, assez peu religieux et surtout aucunement politique. Bien sûr, il était parfois surmonté d’une croix, pour bien montrer que les fiançailles étaient religieusement bénies. Sur le premier exemple ci-dessous il est surmonté de plusieurs clous, sans doute pour suggérer que l’union serait dans le bonheur comme dans les épreuves. Il était encore plus souvent surmonté d’une couronne pour affirmer que l’amour était roi et le mariage son couronnement.
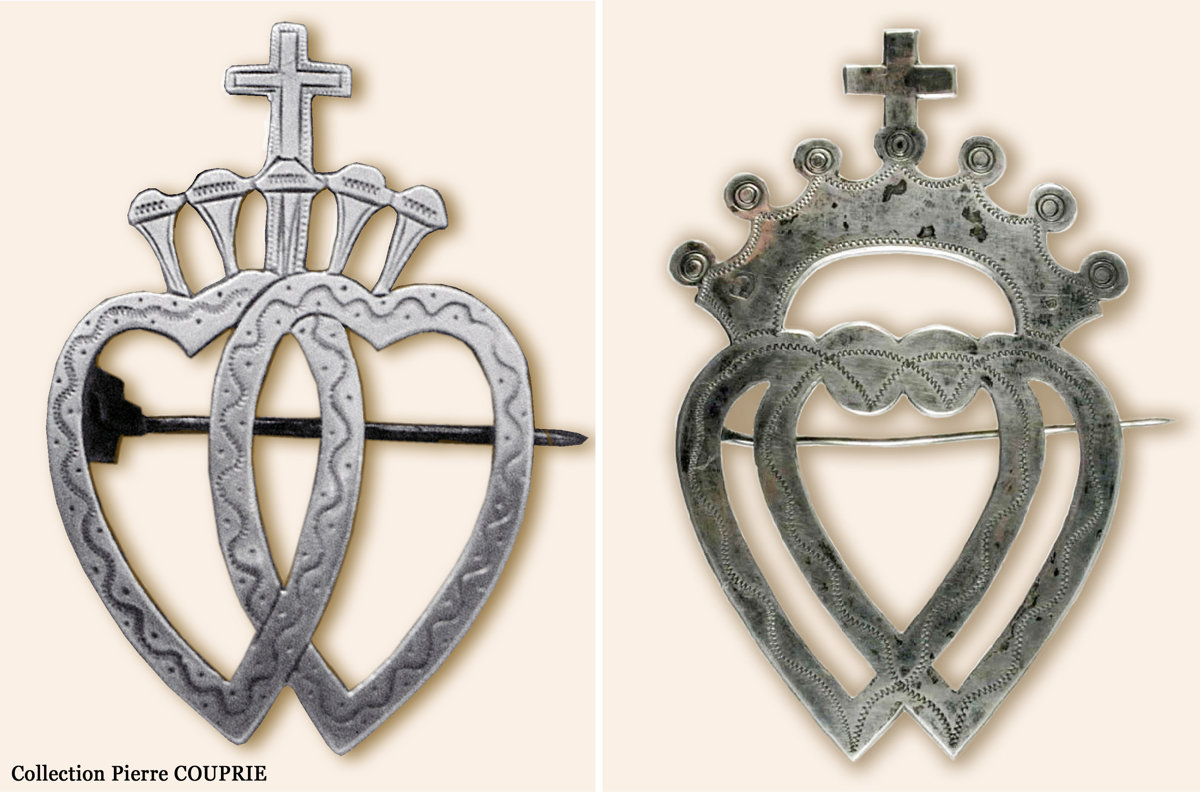
Bijou bas-poitevin du XVIIIème Bijou vendéen du milieu du XIXème
Cette parenthèse étant fermée, revenons en maintenant aux Armoiries de la Vendée. Au lieu de choisir radicalement entre les différentes propositions reçues, le Conseil Général a préféré adopter une solution qui permettait d’en intégrer plusieurs en même temps. Nous avons eu, à ce sujet, le privilège de recueillir les souvenirs d’un membre ayant participé à la commission chargée de ce dossier.
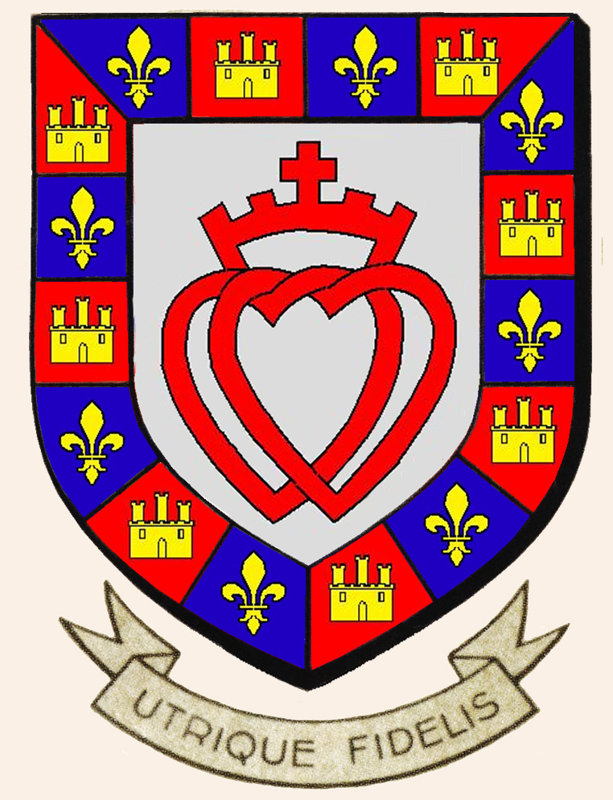 Les Armoiries officielles de la Vendée.
Les Armoiries officielles de la Vendée.
Ainsi, enregistré à Paris le 20 octobre 1943 par la commission des Sceaux et Armoiries de l’État, le blason du département avait désormais une existence légale. Il pouvait se lire héraldiquement de la manière suivante :
« d’argent au double cœur enlacé évidé couronné croiseté de gueules et à la bordure componée à 16 pièces : au 1, 3, 5 et de suite d’azur à la fleur de lys d’or, au 2, 4, 6 et de suite de gueules au château à 3 tours d’or ».
(On remarquera que le dessinateur a représenté par erreur le fond de couleur métallique grise alors qu’en fait « l’argent » se présente tout simplement en blanc !).
La bordure portait les armoiries anciennes du pays « d’azur à la fleur de lys d’or » (qui est de France) et de la province « de gueules au château à 3 tours d’or » (qui est du Poitou). La partie centrale de l’écu évoquait le bijou dont nous venons de parler précédemment. Seules les couleurs blanc et rouge (argent et gueules) évoquaient (très discrètement) les Guerres de Vendée. Toutefois, le message est bien passé puisque ces couleurs sont maintenant reconnues unanimement comme celles de la Vendée. En ce sens, elles rappelaient le cœur rouge surmonté d’une croix sur un carré d’étoffe blanc que portaient les soldats vendéens au revers de leur vêtement en 1793. Cette dévotion au Sacré-Cœur provenait des apparitions de Sainte Marguerite-Marie Alacoque à Paray-le-Monial au XVIIème siècle. Elle a été renouvelée et confondue avec les apparitions de la médaille miraculeuse à Sainte Catherine Labouré en 1830 et la consécration au Sacré-Cœur à la fin du XIXème siècle.
Dans les armoiries, l’écu constitue la partie essentielle ; le reste à savoir les lambrequins, les supports, la couronne, la devise, le cri, le cimier etc…sont des éléments destinés à le compléter et à le mettre en valeur. Par exemple la famille de Maupeou avait comme armoiries un porc épic et comme devise : « qui s’y frotte s’y pique ». Il est donc parfaitement superflu d’essayer d’épiloguer sur une éventuelle opposition entre l’interprétation de la devise et celle de l’écu. La bonne interprétation est obligatoirement celle qui va dans le même sens que « les meubles » de l’écu. Or ce dernier évoque clairement l’appartenance à la France et à l’ancien Poitou.
Il est vrai qu’au moment de la décision, le blason choisi n’avait pas de devise. Aussi, sur proposition de l’archiviste départemental, ils sont allés en chercher une dans un des projets non retenus. Et sur ce dernier, la devise évoquait effectivement la fidélité à Dieu et au Roy « Utrique Fidelis » (fidèle à l’un et à l’autre). Ils l’ont pris par défaut, mais aussi parce qu’elle avait le mérite d’être écrite en latin et de se prêter à beaucoup d’autres interprétations. Mais, à aucun moment, ils n’ont validé l’interprétation proposée par Pascal Lanco. Une variante a été un moment envisagée : « Utrique et Semper Fidelis » (toujours fidèle à l’un et à l’autre) parce qu’elle aurait ainsi été en trois parties comme la plupart des devises. L’idée personnelle de l’archiviste était bien d’évoquer la bravoure dans l’un et l’autre camp lors des guerres de Vendée Toutefois l’interprétation officielle retenue à ce moment là par les Conseillers Généraux a été sans ambigüité: « Fidèle à la Grande Patrie (La France) et à la Petite Patrie (La Vendée) ». N’oublions pas que la première guerre mondiale était alors encore très présente dans les esprits ! De plus, la devise se trouvait cette fois-ci en parfaite conformité avec les thèmes présents sur l’écu (et donc héraldiquement correcte).
Par la suite les interprétations ont pu varier quelque peu. Le Président
Auguste Durand (1945 à 1969) a parfois fait allusion aussi aux deux aspects de
la Vendée, la côte et la ruralité. Pour sa part, le Président Michel Crucis (1971
à 1988), dans ses discours, est toujours revenu à l’interprétation initiale des
deux patries pour la « chère et
douce Vendée ». L’interprétation de la fidélité à la Vendée de
Charrette comme à celle de Clemenceau est plus récente.
 Médaille d'honneur du Conseil Général.
Médaille d'honneur du Conseil Général.
Maurice BEDON
Ancien Conseiller Général de la Vendée

TROIS SQUELETTES EN MAYENNE
Dans son édition du dimanche 20 Janvier 2019, le quotidien régional « Ouest-France » a publié un article intitulé « Les squelettes retrouvés en Mayenne ont parlé » (cf. l’article ci-dessous).
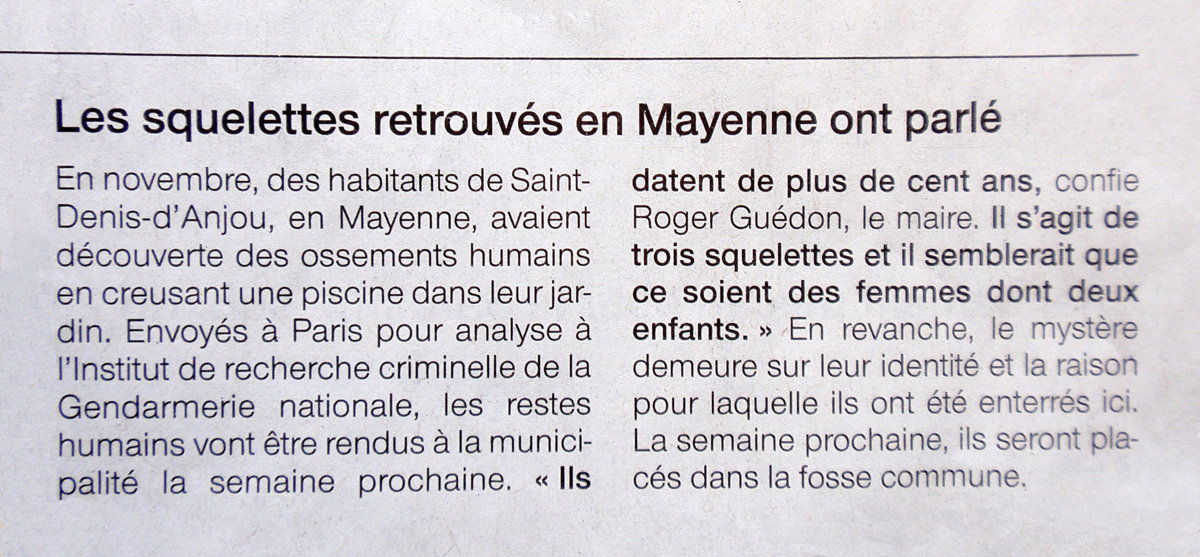
Article de Ouest-France 20-0I-2019.
Pour comprendre de quoi il s’agit en réalité, il nous faut remonter quelques mois en arrière. Au mois de novembre 2018 un couple d’habitants de la commune de Saint-Denis-d'Anjou dans le département de la Mayenne avaient entrepris de faire faire des terrassements pour implanter une piscine privée sur leur propriété. Quelle ne fut pas leur surprise de trouver trois squelettes à cet endroit.
Les Gendarmes prévenus avaient aussitôt envoyés les restes humains pour analyse à l’Institut des recherches criminelles de la Gendarmerie Nationale à Paris.
Les résultats viennent de tomber et le maire de la commune Louis Guédon en a été informé officiellement. Il s’agit de trois squelettes humains de sexe féminin, une femme et deux jeunes filles. « Ils datent de plus de 100 ans ». La semaine prochaine ils seront normalement inhumés dans une fosse du terrain communal dans le cimetière de Saint-Denis-d'Anjou.
On peut donc de ce fait, écarter totalement l’hypothèse qu’il aurait pu s’agir de personnes ayant succombé pendant la débâcle de 1940, l’occupation allemande ou la libération de 1944. En revanche le mystère reste entier concernant la date de leur mort à cet endroit, les circonstances de celle-ci, et leur identité. Aussi l’hypothèse qu’il s’agisse de victimes de la Guerre de Vendée entre 1793 et 1794 s’est elle renforcée !

Extrait de la carte de Cassini datant du XVIIIème siècle.
Comme on peut le voir sur cette carte ancienne (publiée ci-dessus) établie par le géographe Cassini à la fin du XVIIIème siècle (donc à la veille des Guerres de Vendée), Saint-Denis-d'Anjou est située à 10 kilomètres environ de la paroisse de Sablé-sur-Sarthe. Dans le bourg de cette dernière passait déjà à cette époque la grande route Laval-La Flèche. Or celle-ci a effectivement été empruntée par l’armée vendéenne et la population qui la suivait lors de la Virée de Galerne, vers le 29 novembre 1793.
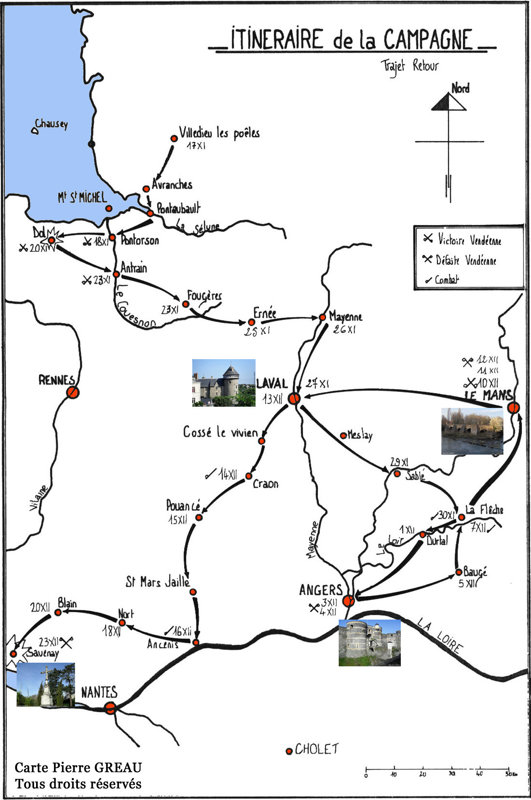 Itinéraire de retour de le Virée de Galerne.
Itinéraire de retour de le Virée de Galerne.
On se souvient que les Vendéens, tout d’abord vainqueurs à Torfou le 19 septembre 1793 avaient finalement été battus à Cholet le 17 octobre. Fuyant les exactions des armées bleus, ils avaient franchi la Loire à Saint-Florent-le Vieil le 18 octobre 1793 et s’étaient dirigés vers Granville pour prendre un port et recevoir du secours. N’y étant pas parvenus le 15 novembre, ils avaient pris le chemin du retour dans une errance entrecoupée de combats qui se déroulaient dans des conditions atroces. De cette manière ils étaient à Laval le 27 novembre et arrivaient à Sablé-sur-Sarthe le 29 novembre.
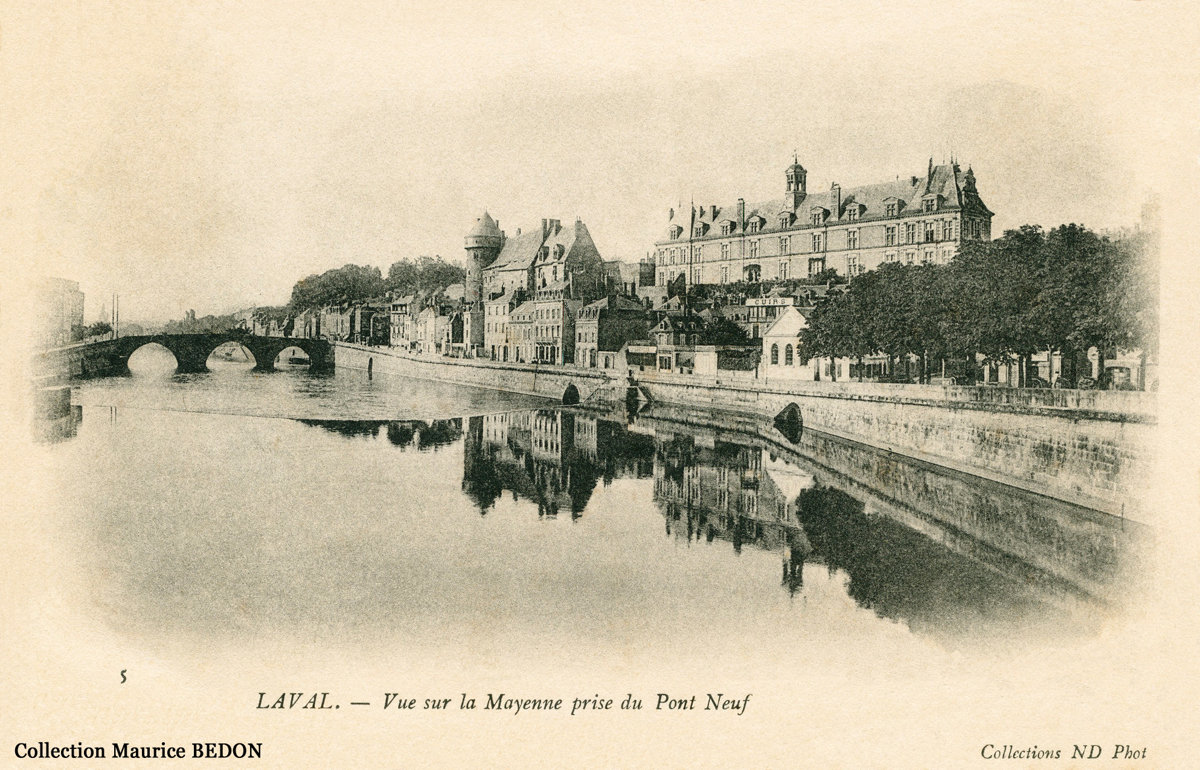
La ville de Laval, le château et le pont.
Nous avons interrogé à ce propos l’historien spécialiste de la Virée de Galerne, Pierre Gréau, pour avoir son avis. Voici sa réponse :
« Sans vouloir l'affirmer à cent pour cent, il semble bien que ces squelettes soient ceux de Vendéens de la Virée de Galerne.... Nombreux sont ceux qui quittèrent la colonne principale pour échapper aux hussards républicains, pour trouver à manger où s'abriter des intempéries. Perdus, affamés, trempés et gelés, ils sont morts loin des leurs. Requiescat in Pace ».
Ajoutons que dans le contexte tendu de l’époque elles ont sûrement été enterrées clandestinement, par conséquent en dehors du cimetière officiel.

Tableau du musée de Cholet représentant la Virée de Galerne.
Peut être viendrons nous à en apprendre d’avantage ?
En tous cas, nous nous permettons de souhaiter qu’une des associations de la Mémoire Vendéenne s’intéresse au sort de ces pauvres femmes et surtout à leur future sépulture dans le cimetière de Saint-Denis-d'Anjou. A titre d’information, dans le terrain communal au cimetière, la tombe pourra disparaître ou être réutilisée dans neuf ans !
Chantonnay, le 22 janvier 2019

QUATRE MARINS DANS LA GRANDE GUERRE
« Quatre Marins dans la Grande Guerre » c’est sous ce titre que Didier Besseau ; Lieutenant de vaisseau, publiera prochainement un nouvel ouvrage aux Éditions « La Chouette de Vendée ». Ce nouvel auteur de la maison d’Éditions nous offre aujourd’hui un petit article résumant la vie d’un de ces quatre marins : François Angibaud.
François Angibaud, sieur de la Morinière, capitaine royaliste de Beauvoir-sur-Mer et son frère Prosper, aide de camp du Général Charette, sont exécutés le 20 avril 1793 aux Sables d’Olonne. Cette ancienne et très honorable famille de Vendée, victime de la barbarie de la Convention Nationale, figure désormais parmi les martyrs d’une cause que tant d’autres ont payés de leurs vies dans cette région restée fidèle à Dieu et au Roi.
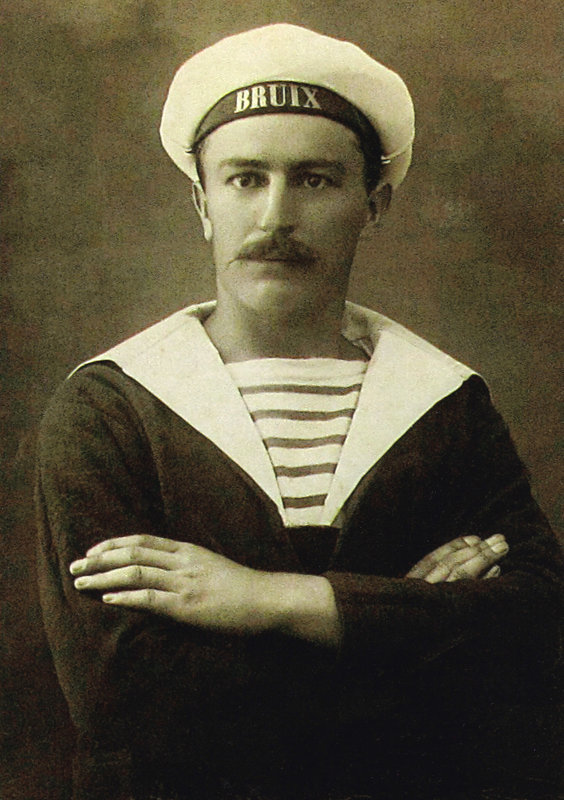 François Angibaud (1886-1915) .
François Angibaud (1886-1915) .
Moins d’un siècle plus tard, leurs descendants se sont installés à Saint-Nazaire. C’est dans ce port breton que nait François Angibaud le 23 mai 1886. La mer est sa passion et tout naturellement il embarque à 16 ans en qualité de mousse à bord du vapeur Basse Indre puis sur divers navires du commerce pour apprendre un métier des plus difficile et ingrat, celui de chauffeur et soutier. Cette spécialité implique de passer de longues heures dans les profondeurs du bâtiment pour alimenter continuellement en charbon les chaudières et vérifier le bon fonctionnement des machines.
A partir de septembre 1906, François Angibaud est appelé à servir sur les vaisseaux de l’État. Durant trois années, il foule le pont du croiseur Catinat, de l’aviso-torpilleur Lance, du navire école des canonniers Tourville, du croiseur-cuirassé Bruix et du tout nouveau contre-torpilleur Voltigeur.
En 1910, de retour à la vie civile, il retrouve son métier et poursuit ses navigations au commerce. L’année d’après son père décède à Saint-Nazaire. François décide alors de suivre sa mère qui s’installe à Machecoul où demeure l’une de ses filles.
Fin juin 1914, il embarque sur le transport postal El Kantara à destination de Saïgon. Arrivée sur place, la situation internationale s’est terriblement dégradée. La guerre est inévitable. Le El Kanrara est alors réquisitionné par l’armée pour le transport de l’artillerie.
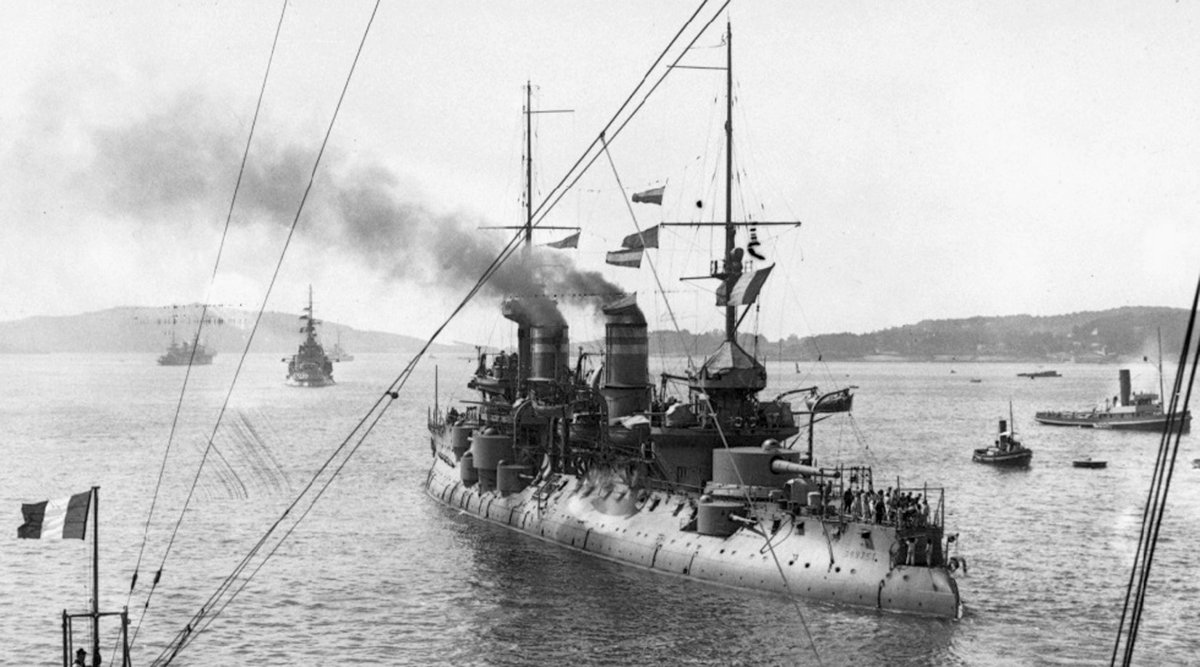
Le Cuirassier Le Bouvet .
François rentre en France en octobre 1914 étant désormais mobilisé dans la marine de guerre. Il embarque sur le puissant cuirassé Bouvet et servira en qualité de chauffeur à son bord. Il devra combattre sur le nouveau front des Dardanelles qui se trouve sous domination turque. Mais pourquoi doit-on désormais se battre si loin ? En Europe, la guerre s’enlise et les hommes s’enterrent dans les tranchées. Nos alliés russes subissent d’importants revers sur le front oriental qui se fige également sur une ligne allant de la mer Baltique à la mer Noire. Le détroit des Dardanelles devient l’unique passage qui peut maintenir la communication entre la Russie d'un côté, la France et le Royaume-Uni de l'autre. Il doit rester ouvert à tout prix !
Notre jeune marin est conscient des risques qu’il va devoir affronter et adresse à sa mère et sa sœur un courrier rempli de résignation face aux dangers qui ne manqueront pas. Le 18 mars 1915, le Bouvet participe à un combat décisif pour tenter de franchir le détroit des Dardanelles. Ce détroit est un enjeu stratégique d’importance pour permettre une communication rapide entre les Alliés européens et russes. Une escadre franco-britannique de 18 vaisseaux ouvre le feu sur les forts turcs qui défendent ce passage. Le combat fait rage et son issue ne fait guère de doutes pour les commandants anglais et français. Les Turcs ont bien préparé leur défense et leurs tirs endommagent de nombreux bâtiments. Il est alors décidé de battre en retraite avant que cette défaite ne se transforme en déroute. Il est 11h58 quand le Bouvet entame sa manœuvre de repli et heurte l’une des nombreuses mines flottantes déployées par les forces ottomanes dans tout le détroit.
Une énorme explosion se fait entendre. Les machines sont immédiatement envahies par l’eau. François Angibaud et ses compagnons comprennent alors qu’ils vont mourir. Le Bouvet est perdu et tel un animal touché à mort, le fier cuirassé se couche et coule en quelques minutes seulement. Seuls 75 hommes survivront à ce désastre. On compte 648 morts parmi lesquels le brave commandant Rageot de La Touche qui voulut partager le sort de son équipage plutôt que survivre.
A 29 ans, l’âge où l’on veut créer une famille, avoir des enfants, François Angibaud a donné sa vie pour la Patrie. Après la guerre, l’heure des hommages étant venue, chaque commune a érigé un monument dédié à la Mémoire de ceux qui ne reviendront pas. Ni Saint-Nazaire, ni Machecoul n’a alors inscrit le nom de François Angibaud sur leurs tables mémorielles.
Mais François connaitra, un siècle après sa disparition, un destin post-mortem peu commun et ô combien honorifique. Le 30 septembre 2015, le Centre d’instruction de Saint-Mandrier dans le Var, qui forme les quartiers-maîtres et matelots de la Flotte, a été le théâtre d’une cérémonie qui honore chaque année un marin Mort pour la France.
La Marine nationale a décidé que la cession 2015-2016 portera le nom de « Promotion Matelot François Angibaud ».

La nouvelle plaque sur le monument de Machecoul .
La municipalité de Machecoul a souhaité également rendre hommage à ce marin. Le dimanche 11 novembre 2018, une cérémonie émouvante s’est déroulée devant le monument aux Morts. Les autorités civiles et militaires présentes et Madame Valérie Renty arrière-petite nièce de François, ont dévoilé une plaque sur laquelle figure les noms de combattants morts pour la France qui dormaient depuis un siècle dans un anonymat total.
François Angibaud a désormais son nom gravé pour toujours auprès de ses compagnons d’armes qui, comme lui, ont sacrifié leurs vies pour la France.

Didier Besseau lors de la cérémonie du 11 XI 2018 .
Au travers de la vie de François Angibaud, un pan du rôle de la Marine au cours de la première Guerre mondiale a été abordé. Tout au long de ces quatre années de conflit, la Marine a combattu pour protéger nos côtes et a aussi partagé le sort des soldats de l’infanterie dans les tranchées. Peu connaissent la réelle importance de notre Marine entre 1914 et 1918 malgré l’engagement total de nos forces maritimes.
Didier BESSEAU
Pour
réparer quelque peu cet « oubli historique », Didier Besseau,
Lieutenant de vaisseau dans la Réserve citoyenne, a rassemblé des archives
familiales et administratives pour retracer le destin de « Quatre marins
dans la Grande Guerre». C’est sous ce titre qu’il publiera son ouvrage aux
Editions « La Chouette de Vendée », vous pourrez y retrouver François
Angibaud, mais aussi Jean-Marie Allo, Aristide Moyon et Pierre Perraud, marins
du commerce ou de l’État.

La Motte-Picquet (1720-1791) Héros de la guerre d’Indépendance
Né en 1720 à Rennes, Jean Toussaint Guillaume de La Motte, dit La Motte-Picquet, est sans aucun doute l’un des plus valeureux officiers de la marine française au 18ème siècle. C’est à Brest, en 1735, qu’il commence sa carrière en entrant à l’école des Gardes de la Marine.
 Toussaint de la Motte-Picquet.
Toussaint de la Motte-Picquet.
Sa longue carrière se déroule sur près de cinquante ans. Il effectue 28 campagnes au cours desquelles il traverse la guerre de Succession d’Autriche (1740-1748), la guerre de Sept ans (1756-1763) et la guerre d’Indépendance (1778-1783). C’est lors de cette dernière guerre, au cours de laquelle plusieurs futurs chefs Vendéens tels que Bonchamps et Charrette font leurs armes, qu’il se couvre de gloire et devient célèbre.
Au cours de ses 28 campagnes durant lesquelles il exerce 10 commandements, il affronte à 11 reprises les anglais au prix de sept blessures. Chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1756, commandeur en 1780 et Grand Croix en 1784, il est en 1784 l’un des membres fondateurs de la Société des Cincinnati. Resté célibataire, il décède à Brest en 1791.
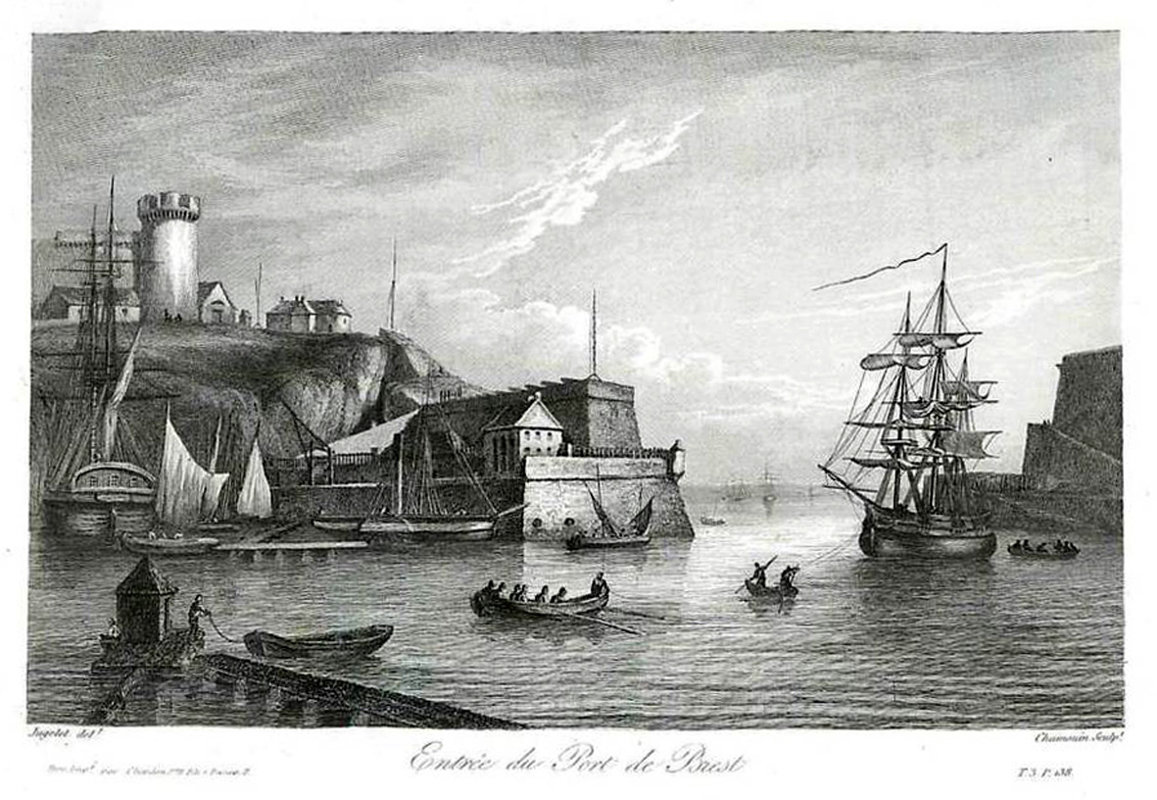
Le Port de Brest au XVIIIème siècle.
La Motte-Picquet n’a pas laissé de récit sur sa vie, hormis deux petits mémoires détaillant ses différentes campagnes. Conservés aux Archives Nationales à Paris, l’un d’eux va de 1735 à 1744 et ne compte que 2 feuillets. L’autre reprend sa carrière depuis 1735 jusqu’en 1764 et comprend 6 feuillets de son écriture serrée, très lisible. Ces documents précieux se trouvent dans son dossier personnel. On trouve aussi, toujours dans son dossier personnel, un mémoire résumant sa carrière depuis 1772 jusqu’à 1783. Ce mémoire n’est pas de sa main mais une copie d’un mémoire autographe, mémoire dont avait hérité l’un de ses petits neveux, A. de La Motte, enseigne de vaisseau. Ce dernier avait eu la bonne idée d’en donner une copie aux archives nationales en 1839. L’histoire de La Motte-Picquet restait donc à écrire, ce qui n’avait pas été fait jusqu’à présent.
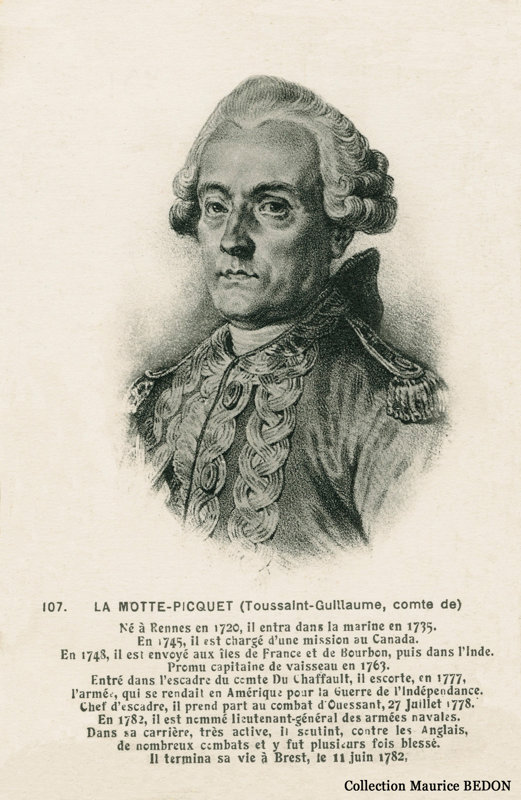 Carte postale en hommage à La Motte-Picquet.
Carte postale en hommage à La Motte-Picquet.
Pour reconstituer sa carrière, il faut consulter les archives et s’aider tout particulièrement des documents concernant ses campagnes successives. On y trouve en particulier sa correspondance. Il était en effet d’usage sous l’ancien régime, pour un officier exerçant un commandement, de rendre compte au ministre du déroulement de sa campagne. Ces documents sont conservés dans la série Marine B4 aux archives nationales à Paris
A travers sa correspondance, on découvre un homme passionné par son métier, soucieux de faire respecter le pavillon de son roi et, en temps de guerre, déterminé à se battre si nécessaire jusqu’à la dernière goutte de son sang. On découvre aussi son intérêt pour ses officiers pour lesquels il ne cesse de demander des promotions. Il n’oublie pas ses équipages, trop souvent négligés par le haut commandement, manquant de tout : il se bat pour qu’ils soient vêtus et payés. Tout cela le rend particulièrement attachant et il n’est pas surprenant d’apprendre qu’il était adulé de ses hommes.

La Bataille de Fort-Royal.
Ses hauts faits d’armes sont restés en mémoire, tout particulièrement son combat du 18 décembre 1779 à la Martinique dans la baie de Fort-Royal. Ce jour là, on annonce à La Motte-Picquet l’arrivée d’un convoi venu de Marseille, convoi très attendu dans la colonie car il apporte des vivres et des munitions. On annonce aussi que ce convoi est attaqué par une escadre anglaise, forte de 13 vaisseaux, commandée par l’amiral Hyde Parker. La Motte-Picquet n’hésite pas une seconde et suivant son intrépidité habituelle, lève l’ancre pour se porter seul au devant des anglais avec son vaisseau l’Annibal. Il réussit par sa fougue et ses brillantes manœuvres à stopper net l’action des anglais et, soutenu une heure plus tard par deux autres vaisseaux de son escadre, parvient à sauver la plus grande partie du convoi tant attendu. Cet exploit sera salué aux Antilles comme en France et, fait extraordinaire, La Motte-Picquet recevra même une lettre de l’amiral anglais qui lui fera part de son admiration.
En 1786, Louis XVI qui s’intéressait de très près à sa Marine et qui avait tant fait pour qu’elle retrouve son rang, décide de commander une série de tableaux afin de commémorer ces heures de gloire de la Royale. Tout naturellement cette bataille de Fort-Royal fera partie des sujets représentés. Ce tableau, peint par Auguste-Louis de Rossel est conservé de nos jours au musée de la Marine à Paris.
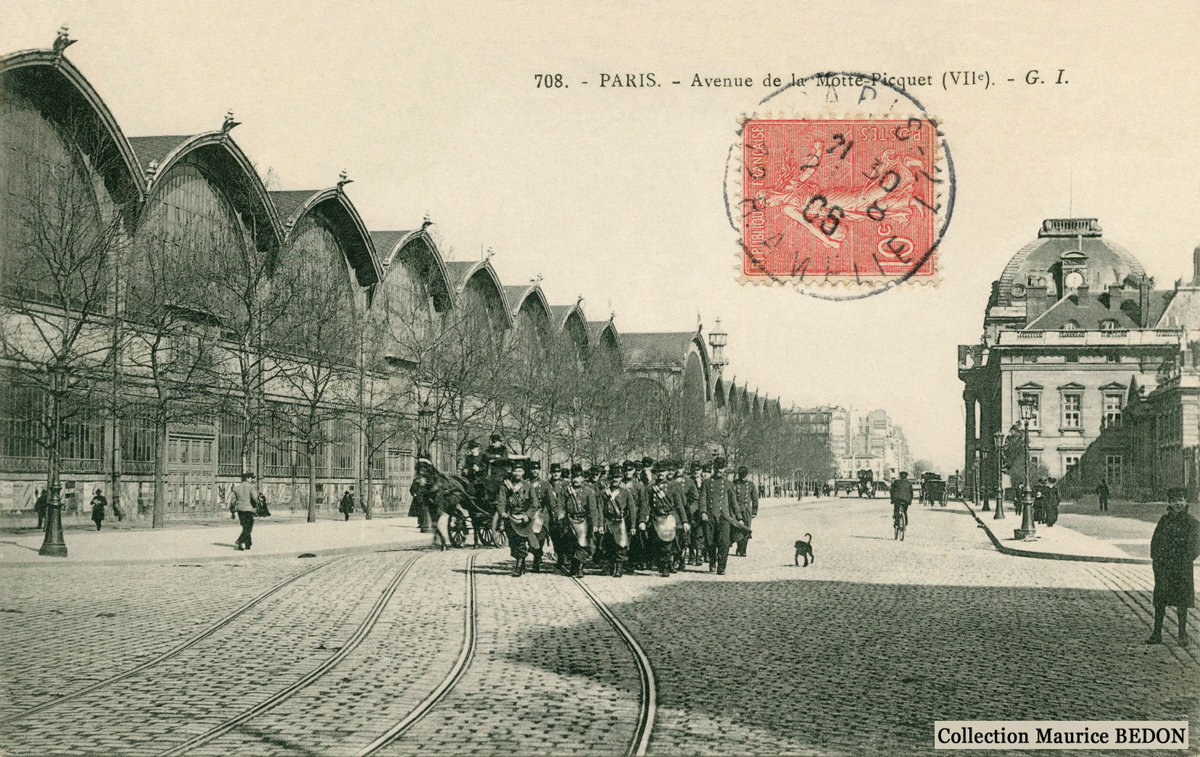
L’avenue La Motte-Picquet à Paris.
(entre L’École Militaire à droite et le Champ de Mars à gauche, alors encore encombré par les vestiges de l’exposition universelle).
La Motte-Picquet a donné son nom à des bâtiments de Marine et à des rues, à Rennes sa ville de naissance et à Brest, sa ville d’élection. Une avenue porte son nom à Paris, mais on s’étonne qu’il n’y ait aucun monument dédié à sa mémoire.

Buste de la Motte-Picquet, Brion 1835.
Pour retrouver ce grand homme, il faut aller au Musée de la Marine où se trouvent le tableau cité plus haut et un buste le représentant, buste sculpté en 1835 par Brion. Ce buste, quelque peu idéalisé, a le mérite de nous remettre en mémoire cet illustre marin qui avait tant fait pour la gloire de son Roi et de son pays.
Alain GAILLARD

Les Armoiries de la Motte-Picquet dans la station de métro à son nom.
« d’azur à 3 chevrons d’or accompagnés de 3 pointes de lance d’argent, posées 2 en chef et une en pointe » (ce qui constitue des armes semi-parlantes : pointe de lance = pique = Picquet).
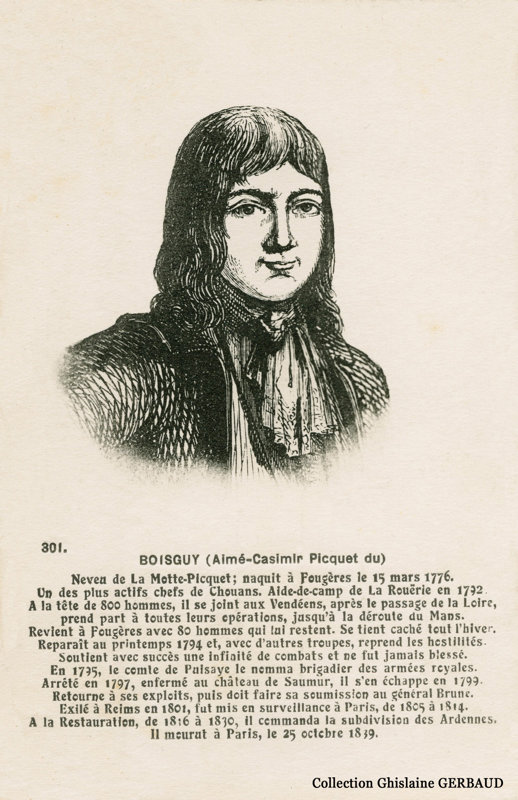
Le neveu de La Motte-Picquet, chef chouan.

Christine Guillet, héroïne vendéenne de la seconde guerre mondiale
Au cours de la seconde guerre mondiale, en Vendée comme dans d’autres départements, des gens courageux n’ont pas hésité, au risque de leur vie et de celle de leurs proches, à porter secours à des aviateurs alliés dont les avions avaient été abattus et qui, après avoir sauté en parachute, se retrouvaient en pays occupés par les Allemands et risquaient d’être capturés. Christine Guillet fait partie de ces héros méconnus puisqu’elle a caché dans sa ferme pendant près d’un an un aviateur américain alors qu’elle connaissait très bien le danger qu’elle courait et faisait courir à toute sa famille : si cet aviateur avait été trouvé chez elle par les Allemands, son mari aurait été aussitôt fusillé et elle aurait été déportée avec ses enfants. Il a fallu attendre 1996 pour qu’elle soit honorée au cours d’une cérémonie très émouvante présidée par Monsieur Philippe De Villiers.
Voici l’histoire de cette héroïne et de cet aviateur américain, Harold Lyberger, telle qu’il a été possible de la reconstituer en interrogeant tous les témoins retrouvés, à commencer par Madame Guillet, et en consultant les archives américaines. Mais comment cet aviateur a-t-il pu se retrouver dans une ferme de Vendée pendant la dernière guerre ? Avant d’aller plus loin, il n’est pas inutile de faire un bref rappel historique.
L’entrée en guerre des américains
La seconde guerre mondiale commence le 3 septembre 1939 à la suite de l’invasion de la Pologne par Hitler. La France et l’Angleterre déclarent la guerre à l’Allemagne mais les troupes ne bougent pas. Les seules actions se déroulent sur mer et dans les airs. Les Anglais commencent à bombarder des cibles allemandes. En mai 1940, les Allemands déclenchent une guerre éclair. En quelques semaines, la Hollande, la Belgique puis la France sont envahis et en juin, Pétain signe un armistice. L’Angleterre se retrouve seule à combattre et poursuit sa campagne de bombardement sur l’Allemagne.
Le 7 décembre 1941, à la suite de l’attaque japonaise de Pearl Harbor, l’Amérique entre à son tour en guerre, non seulement contre le Japon mais aussi contre l’Allemagne et l’Italie. Roosevelt et Churchill se rencontrent et décident de faire porter en priorité leur effort de guerre contre les nazis afin de libérer l’Europe occupée. Pour ce faire, il faudra effectuer un débarquement en France et celui-ci ne pourra réussir qu’après avoir désorganisé la machine de guerre allemande. Les Anglais, renforcés par les Américains, déclenchent alors une guerre aérienne intensive avec en particulier une campagne de bombardements stratégiques destinés à détruire le potentiel de guerre ennemi : usines, raffineries de pétrole, installations portuaires, moyens de communication. Dès le mois d’août 1942, les Américains, arrivés en renfort et dont les avions sont basés au sud de l’Angleterre, partent attaquer les Allemands non seulement sur leur territoire mais aussi dans les pays occupés, dont la France.
Les Anglais, qui supportent seuls l’effort de guerre depuis 1939, font voler leurs bombardiers la nuit pour échapper le plus possible aux chasseurs et à la DCA. De ce fait, leurs bombardements manquent le plus souvent leurs cibles. Les Américains ont choisi une option différente : ils ont décidé de bombarder en plein jour afin de frapper leurs objectifs avec plus de précision. Leurs bombardiers stratégiques quadrimoteurs, type « Liberator » et « Forteresse volante » sont équipés d’un viseur ultra moderne, le « Norden », ce qui doit théoriquement leur permettre de toucher leurs cibles sans erreur. Pour se protéger des chasseurs ennemis, ces avions sont hérissés de mitrailleuses et volent à haute altitude, au moins à 5 000 mètres, pour rester hors de portée de la DCA.
Harold Lyberger, aviateur américain
Harold Lyberger, cet aviateur américain qui sera caché par Christine Guillet, est âgé alors de 26 ans. Marié, il habite près de New York, à Newark dans le New Jersey. Il s’est engagé dans l’armée de l’air en 1942 et, après une période d’entrainement, a rejoint l’Angleterre en février 1943. Il fait partie de la 8ème Air Force. Son unité, équipée de forteresses volantes, est le 91ème Bomb group, 323ème squadron, basé à Bassingbourn au nord de Londres.

Une forteresse volante semblable à celle d’Harold Lyberger.
Ces forteresses volantes ont un équipage de dix hommes. Les camarades d’équipage d’Harold Lyberger sont :
Eldon Smith, pilote H. Cramer, co-pilote B. Bone, mitrailleur
Banowetz, navigateur S. Hansen, bombardier A. Antonacchio, mitrailleur
J. Schmitt, radio-opérateur L.M. Young, mitrailleur W. Mazzola, mitrailleur de queue.
Harold Lyberger est ingénieur et mitrailleur de tourelle.
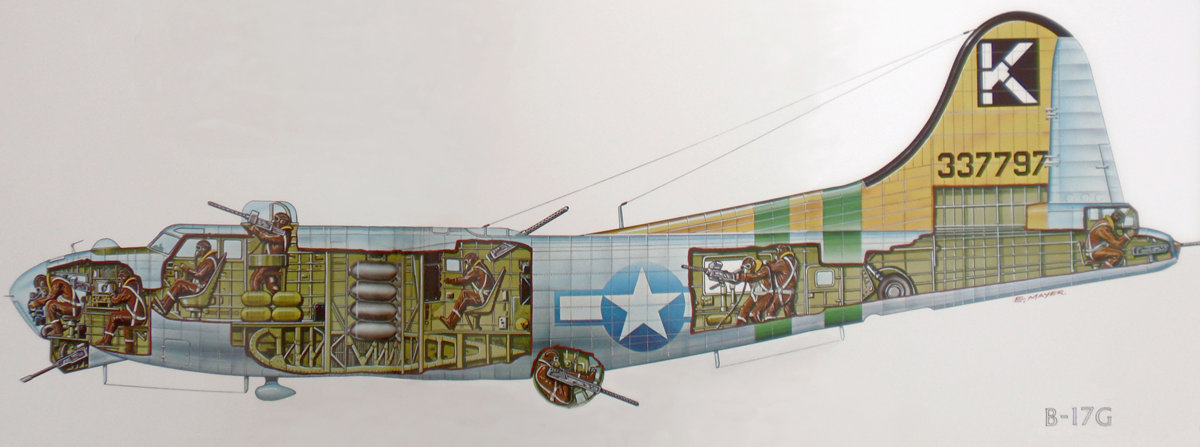
Intérieur d’une forteresse volante B 17 G. Le poste d’Harold Lyberger est la tourelle la plus haute, située derrière le poste de pilotage.
Au mois de septembre 1943, la 8ème Air Force qui a subit de lourdes pertes les semaines précédentes lors de longues missions au dessus de l’Allemagne doit faire une pause et programmer des missions moins longues donc moins dangereuses. L’occasion se présente lorsque les Américains apprennent par des résistants qu’un bateau ravitailleur de sous-marins est arrivé dans le port de Nantes. C’est une cible prioritaire car les sous-marins allemands attaquent et coulent de nombreux cargo qui transportent d’Amérique des secours aux Anglais. Le bombardement de Nantes est programmé pour le 16 septembre et Harold Lyberger va faire partie de cette mission. Les avions américains doivent bombarder le port, mais aussi l’aéroport de Château-Bougon. Cette dernière cible est celle d’Harold Lyberger, qui a bien failli périr le 16 août précédent : parti pour bombarder l’aéroport du Bourget, son avion baptisé « All American », victime d’une explosion à son bord, avait du rebrousser chemin à 4 km des côtes françaises et était tombé en mer du Nord à 12 km de l’Angleterre. Heureusement, tout l’équipage a été repêché par une vedette de la Royal Navy.
Le 16 septembre, à 10 heures du matin, 131 forteresses volantes s’envolent du sud de l’Angleterre. L’avion d’Harold Lyberger porte le numéro 42-3079. L’escadrille traverse la Manche et survole ensuite la Bretagne. Au sud de Rennes, volant à 6 000 mètres et se dirigeant vers Nantes, l’avion d’Harold Lyberger est touché par la DCA et perd de l’altitude.
Harold Lyberger et ses camarades sautent en parachute
Au dessus de Saint-Nazaire, l’avion est en perdition. Le pilote qui tient le rôle de commandant de bord, donne l’ordre à ses hommes d’abandonner l’avion et branche le pilote automatique. Les dix hommes d’équipage sautent en parachute. Lors de sa descente, Harold Lyberger voit l’avion se diriger vers l’océan et le perd de vue.
La fin de cet avion est connue grâce à des témoins de sa chute : après avoir survolé la baie de Bourgneuf, la forteresse volante frôle les toits de Saint-Jean-de Monts, perd un moteur en touchant des peupliers puis se pose dans un pré de la ferme de Champ-Gaillard, près de la plage des Demoiselles. Monsieur Mathurin Barranger qui assiste à l’atterrissage de cet avion fantôme se souvient :
« Ce jeudi 16 septembre, un peu après 16 heures, je soignais mes moutons dans la grange, quand un grand vacarme me fit me précipiter au dehors. Je fus suffoqué par le spectacle qui s’offrait à moi : un énorme avion quadrimoteur venant du nord, après avoir fauché une rangée de peupliers atterrissait normalement dans le champ voisin planté de betteraves, puis franchissait le buisson, traversait un pré où paissaient des vaches, sans les toucher. Il terminait sa course folle dans le champ de maïs contigu, où il s’immobilisait sans capoter.
Je me suis immédiatement précipité vers l’avion, mais, nouvelle surprise, il n’y avait personne à bord et aucun parachute dans le ciel. Monsieur Jean Daniau, qui avait failli recevoir un des moteurs sur la tête, arrivait lui aussi en courant, pénétrait à l’intérieur du fuselage par une porte restée ouverte et ramenait une paire de bottes d’aviateur. Il était temps, les Allemands accouraient au grand galop et interdisaient l’entrée du champ aux visiteurs qui venait voir ce spectacle insolite ».
Pendant ce temps, les parachutistes terminent leur descente. L’un d’eux, Bone, a le malheur de tomber en mer et se noie. Son corps sera découvert le 8 octobre suivant sur la plage de Coulepasse, près de Bouin, où il sera inhumé pour être transféré ensuite au cimetière américain de Draguignan. Ses neuf camarades touchent la terre ferme où ils sont attendus par les militaires allemands qui les arrêtent aussitôt. Seul Harold Lyberger, tombé à l’écart des routes, réussit à échapper aux recherches. Il détache son parachute et retire sa combinaison chauffante, équipement indispensable pour les missions à haute altitude dans ces avions non pressurisés où la température peut tomber à moins quarante degrés et où il faut porter des masques à oxygène. Il jette son parachute et sa combinaison dans un buisson et s’éloigne de son point de chute, l’œil aux aguets. Sur le dos de son blouson est écrit en grosses lettres « All American », nom de la forteresse volante avec laquelle il était tombé en mer du Nord un mois plus tôt.
Harold Lyberger tente de rejoindre l’Espagne
Harold Lyberger essaie, suivant les consignes de son commandement, de rejoindre l’Angleterre en passant par l’Espagne. Pour se guider, il a, comme tous ses camarades, une boussole et une carte de France imprimée sur son foulard de soie. Il peut espérer être aidé dans sa fuite par des résistants, comme l’ont déjà été et comme le seront beaucoup d’aviateurs alliés tombés en France.
Il passe sa première nuit de fugitif à la belle étoile. Le lendemain, il repart et suit la voie de chemin de fer Bourgneuf-Nantes. Il arrive vers 11 heures du matin près de la gare de Cheméré. Dans la gare se trouve monsieur Jean Conan, âgé alors de vingt ans, qui surveille le chargement de wagons que l’on remplit de pierre d’une carrière proche, pierres destinées à la construction du mur de l’Atlantique. Monsieur Conan aperçoit Harold Lyberger qui essaie de se cacher dans des buissons. Il va à sa rencontre, lui demande ce qu’il cherche, ne comprend pas ce qu’il dit et devine qu’il s’agit d’un aviateur allié. Il le conduit alors chez son beau-frère, monsieur Denis, chef de gare. Lyberger semble très inquiet, ayant manifestement peur d’être livré aux Allemands. Ne parlant pas le français et ses interlocuteurs ne parlant pas l’anglais, il montre son uniforme américain. Sur sa manche est cousu l’insigne de son escadrille : un bouc assis sur une bombe.
 Insigne du 323ème Bomb squadron, 91ème Bomb group.
Insigne du 323ème Bomb squadron, 91ème Bomb group.
Il montre aussi ses papiers militaires, ses rations de secours, sa trousse de secours pour prouver son identité.
Monsieur Conan le laisse avec son beau frère pour aller déjeuner et revient à la gare à 13 heures 30. Son beau-frère lui apprend que l’aviateur est parti vers Saint-Hilaire de Chaléons en suivant la voie de chemin de fer. Il essaie de le rejoindre pour l’aider et le mettre à l’abri des recherches, mais, malgré ses appels, il ne le retrouve pas. L’année suivante, monsieur Conan rejoint le maquis de Princé. Il participe ensuite aux combats pour libérer la poche de Saint-Nazaire.
Le soir du 17 septembre, Harold Lyberger arrive dans une ferme où un couple de viticulteurs l’invite à partager leur repas et l’héberge pour la nuit. En repartant le lendemain matin, il leur offre en remerciement sa montre en or. Il arrive vers midi en bordure de l’aéroport de Château-Bougon et voit des soldats allemands montant la garde. Il repart alors vers le sud. Dans la soirée du 18 septembre il demande de l’aide à des fermiers qui refusent de le recevoir par crainte de représailles, les Allemands menaçant de fusiller ceux qui aideraient des aviateurs alliés.
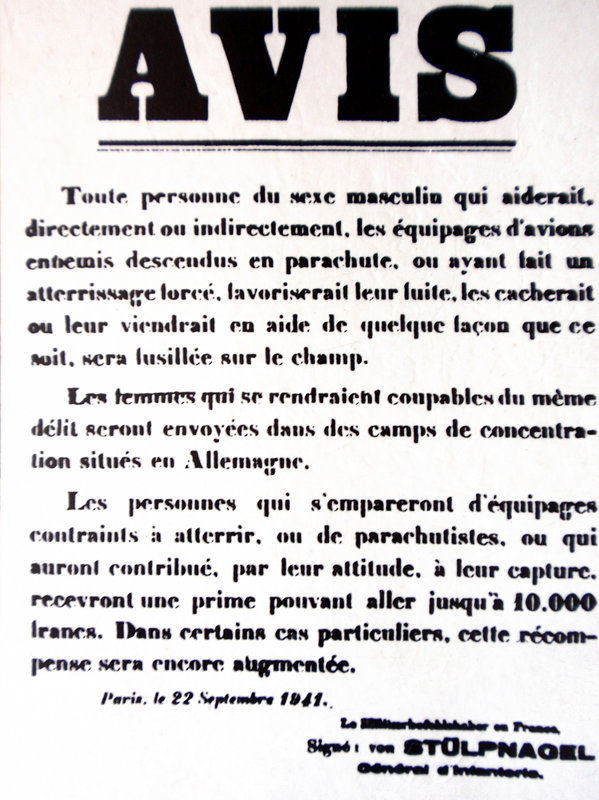 Affiche placardée par les Allemands
dès 1941. Ces menaces
n’ont
pas empêché des Français d’aider des aviateurs alliés tombés
sur notre sol. Certains l’ont payé de
leur vie.
Affiche placardée par les Allemands
dès 1941. Ces menaces
n’ont
pas empêché des Français d’aider des aviateurs alliés tombés
sur notre sol. Certains l’ont payé de
leur vie.
Harold Lyberger reprend son chemin et couche à la belle étoile, mais heureusement il ne pleut pas et la température est encore clémente.
L’arrivée d’Harold Lyberger à la Preuille
Le 19 septembre, dans l’après-midi, Harold Lyberger arrive à la Preuille, propriété vendéenne située à 25 kilomètres au sud de Nantes, près de Saint-Hilaire de Loulay. Dans cette propriété se trouve un château du 13ème siècle, remanié au 15ème siècle. Ce château est entre autre célèbre pour avoir accueilli et caché la duchesse de Berry avant son arrestation à Nantes lors de sa folle équipée en 1832.
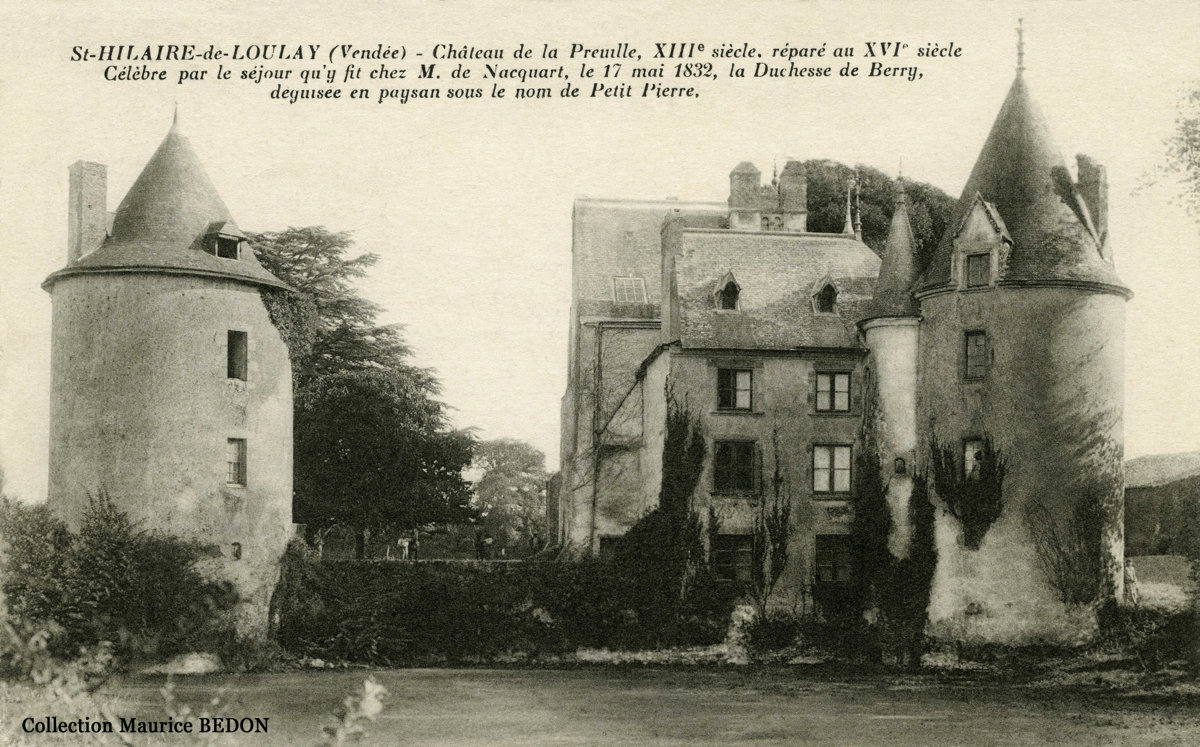
Le château de la Preuille.
Fatigué par ses longues marches et surtout affamé, ayant consommé ses rations de secours, il entre dans la vigne au dessus du château où il trouve quelques grappes de raisin. Il est alors surpris par Christiane Guillet, âgée de huit ans, dont les parents, Christine et René Guillet habitent une des fermes de la propriété voisine, la Haute-Preuille. Elle est accompagnée d’une de ses cousines. Elles ont un peu peur car elles ne comprennent pas ce qu’il leur dit. Arrive alors Marcel Guillet, âgé de vingt ans, fils de Léon Guillet habitant l’autre ferme de la Haute-Preuille. Il parle un peu anglais et conduit Harold Lyberger chez son oncle, monsieur Durand, fermier de la Basse-Preuille qui invite l’aviateur à partager le dîner familial et l’héberge pour la nuit. Les Guillet et les Durand se réunissent dans la soirée et discutent de la marche à suivre. Harold Lyberger ne pourra pas rester le lendemain à la Basse-Preuille car le château est occupé par une colonie de vacances. Il risque d’être repéré. Il sera plus en sûreté à la Haute-Preuille, de préférence chez René et Christine Guillet qui n’ont que trois enfants, le frère de René, Léon en ayant quinze.
Le lendemain, 20 septembre, René Guillet vient chercher Harold Lyberger et le conduit chez lui. On le fait déjeuner, dîner, et le soir il couche dans un bon lit. Le lendemain matin, Harold fait comprendre qu’il veut repartir. Christine Guillet lui prépare une petite sacoche où elle met du pain, quelques pommes, une perdrix rôtie et une bouteille de vin.
Madame Guillet décide de cacher Harold Lyberger
Au moment où il commence à s’éloigner, persuadée qu’il va être arrêté, elle court le rejoindre, lui fait comprendre qu’il va être pris s’il s’en va et qu’elle peut le cacher. Il semble comprendre et revient avec elle à la ferme. Son mari, surpris par la tournure des événements, hésite, craignant des représailles, mais finalement se rallie à la décision de sa femme. Déterminée, Christine Guillet décide seule de mettre les vêtements militaires d’Harold dans une caisse en bois qu’elle enterre en plein milieu d’un champ de topinambours. Elle donne à l’aviateur des habits de son mari, dont son beau gilet de mariage. Au cours des mois suivants, elle n’achète pas de vêtements nouveaux de peur d’éveiller les soupçons et réussit à vêtir tant bien que mal Harold avec ce qu’elle a chez elle.
Les Guillet connaissent un résistant qui habitent dans le voisinage, monsieur Pierre Baudry. Mis au courant de la situation, celui-ci dresse un plan de la ferme et le fait parvenir à Londres pour qu’un avion vienne récupérer Harold. Le jour où l’avion viendra, les Guillet devront étaler un drap blanc dans un champ près de la ferme et s’éloigner pour ne pas être arrêtés au cas où les Allemands surviendraient. Il y a d’ailleurs une opération semblable prévue près de Chavagnes-en-Paillers pour un autre aviateur allié. Par malchance, cette dernière opération va échouer et monsieur Baudry, dénoncé par des voisins, sera arrêté. Heureusement, sa maison n’est pas fouillée et sa femme réussit à brûler les papiers compromettants cachés dans une lessiveuse. Monsieur Baudry mourra en déportation à Mauthausen.
Harold reste donc chez les Guillet, partageant leur vie et participant aux travaux de la ferme. Il est logé dans une chambre et les Guillet lui laissent un lit tout neuf qu’ils venaient d’acheter. On le fait passer pour sourd-muet et un peu « demeuré ». On lui procure une fausse carte d’identité au nom de Daniel Briand, carte faite par monsieur Joseph Caillé, café du Four, 2 Route de Saint-Joseph à Nantes.
Les Guillet sont tout à fait conscients du danger qu’ils courent. Leurs trois enfants sont encore petits (6, 8 et 12 ans) et peuvent bavarder. Ils leur font la leçon : s’ils parlent, toute la famille sera fusillée. Par sécurité, un réseau de surveillance est organisé : trois amis sûrs, mis dans la confidence, vont écouter ce que l’on dit dans les environs. Au moindre bavardage, ils viendront prévenir les Guillet qui feront partir Harold. En cas de visite nocturne intempestive, Harold doit s’enfuir par la fenêtre et un des enfants doit prendre sa place dans le lit.
Malgré les nombreux passages de visiteurs venant chercher des provisions à la ferme, tout se passe bien et personne ne se doute que les Guillet cachent un aviateur allié sauf une infirmière qui s’occupe de la colonie de vacances logée au château. A la fin du printemps 1944, elle multiplie ses visites et devine la vérité, mais elle n’en parle à personne. Elle doit d’ailleurs soigner Harold qui s’est blessé au cours de son travail.
Harold se fait bien à sa nouvelle vie et ne semble pas trop malheureux. Un jour, alors qu’il travaille près de la ferme, il se met à chanter une chanson américaine. Un visiteur étant arrivé, Christine Guillet envoie un de ses enfants lui dire de se taire. Le soir, il apprend un peu d’anglais aux enfants, mais ne parlant pas le français et les Guillet ne parlant pas l’anglais, la communication n’est pas toujours facile. Elle se fait la plupart du temps par gestes et mimiques ce qui déclenche souvent des fous rires. Lorsque les Guillet sentent qu’il a le cafard, ils essaient de l’occuper ou de le distraire. De plus, pour qu’il ne soit pas complètement coupé du monde extérieur, ils le conduisent de temps en temps le soir, à travers les champs, au village voisin de la Proutière où vit une sœur de Christine Guillet. Le village a l’électricité et la sœur de Christine Guillet possède un poste de radio sur lequel Harold peut écouter la BBC.
Harold Lyberger retrouve ses compatriotes
Le 6 juin 1944, les alliés débarquent en Normandie et le 25 août, une avant-garde américaine arrive à Nantes. Harold, tenu au courant des événements, demande aux Guillet d’aller signaler sa présence à ses camarades afin de ne pas être pris pour un déserteur. Il reprend alors ses vêtements militaires, bien conservés grâce aux précautions de Christine Guillet, mais depuis son arrivée à la ferme, il a grossi et a du mal à enfiler son pantalon. René Guillet part à Nantes à bicyclette. Il rejoint après bien des difficultés les Américains car il lui faut traverser la Loire et le pont de Pirmil a été détruit par les Allemands. Les Américains sont heureux d’apprendre qu’un des leurs s’en est aussi bien sorti et promettent de venir chercher Harold le mardi 5 septembre. Ils viennent finalement plus tôt que prévu, le samedi 2 vers 10 heures. Ils ne trouvent à la ferme que Christine Guillet, son mari et Harold étant partis faire une course à Remouillé, petit bourg proche de la ferme. Ils disent qu’ils repasseront le soir même après avoir récupéré un prisonnier allemand à Cholet.
Christine Guillet va aussitôt chercher son mari et Harold à bicyclette. Apprenant la venue de ses compatriotes, Harold est fou de joie. Pour fêter la nouvelle, il boit plusieurs verres de vin et, arrivé à la ferme, s’effondre sur son lit. En fin d’après-midi, il a récupéré. Une fête a été préparée pour son départ, avec des gâteaux, du champagne et du muscadet.
 Harold Lyberger entre René et Christine Guillet le jour de son départ.
Harold Lyberger entre René et Christine Guillet le jour de son départ.
La nouvelle s’étant répandue, il y a déjà soixante dix personnes dans la cour de la ferme lorsque les soldats américains arrivent dans leur jeep avec leur prisonnier. Celui-ci se fait le plus discret possible. Quelques invités, sous l’effet de la boisson se moquent de lui et veulent le frapper. Christine Guillet s’interpose aussitôt et dit qu’elle ne permettra pas cela chez elle.
Lorsque les Américains demandent à Harold comment son séjour s’est passé et s’il a été bien traité, il répond « j’ai été traité comme un enfant de la maison ».
Le directeur de la colonie de vacances hébergée dans le château, découvrant la présence de cet aviateur américain, déclare que s’il avait su cela plus tôt, il n’aurait pas hésité à aller tout raconter aux Allemands pour faire libérer son frère prisonnier. A la lumière de cette anecdote, on comprend à quel point les Guillet avaient risqué gros en cachant Harold Lyberger.
Le mardi 5 septembre, Harold Lyberger est de retour à sa base en Angleterre et fait son rapport. Il précise qu’il n’a vu lors de sa descente que sept parachutes et qu’après son atterrissage, il n’a pas revu ses camarades. Il raconte ensuite sa fuite et son séjour chez les Guillet, insistant sur leur gentillesse et leur dévouement. Pour lui, la guerre est finie. Contrairement aux Anglais, les aviateurs américains évadés après être tombés en Europe occupée ou en Allemagne ne repartent pas en mission. Il apprend que son camarade Bone, tombé en mer est mort noyé et que les autres aviateurs de son équipage ont survécu mais ont tous été fait prisonniers. Ils ne reviendront que l’année suivante, après la capitulation de l’Allemagne, le 8 mai 1945.
De retour aux États-Unis, il retrouve sa femme, Wanda E. Lyberger qui était sans nouvelles de lui depuis le 16 septembre 1943 mais avait gardé espoir. Elle avait reçu, selon la procédure habituelle, un télégramme lui annonçant que son mari avait été porté manquant au retour de sa mission et il était précisé que l’équipage de son avion avait sauté en parachute. Il avait donc pu survivre en étant caché quelque part puisque sa présence dans les camps de prisonniers allemands n’avait pas été signalée plus tard par la Croix Rouge, contrairement à ses huit autres camarades. L’administration lui avait aussi adressé un mandat de 59 dollars, et six bons du trésor que son mari avait laissé dans son placard en partant pour sa dernière mission.
Après son retour à la vie civile, Harold Lyberger a écrit à plusieurs reprises aux Guillet, les remerciant de tout ce qu’ils avaient fait pour lui, sa dernière lettre datant de 1946. Christine Guillet a pensé que le dialogue s’était interrompu alors par la faute de leur neveu, Marcel Guillet, qui avait écrit à Harold et lui avait demandé de lui envoyer une carabine.
Christine et René Guillet ont reçu en 1946 une grande enveloppe des Etats-Unis contenant un parchemin signé Eisenhower, disant la reconnaissance du peuple américain pour leur conduite courageuse.
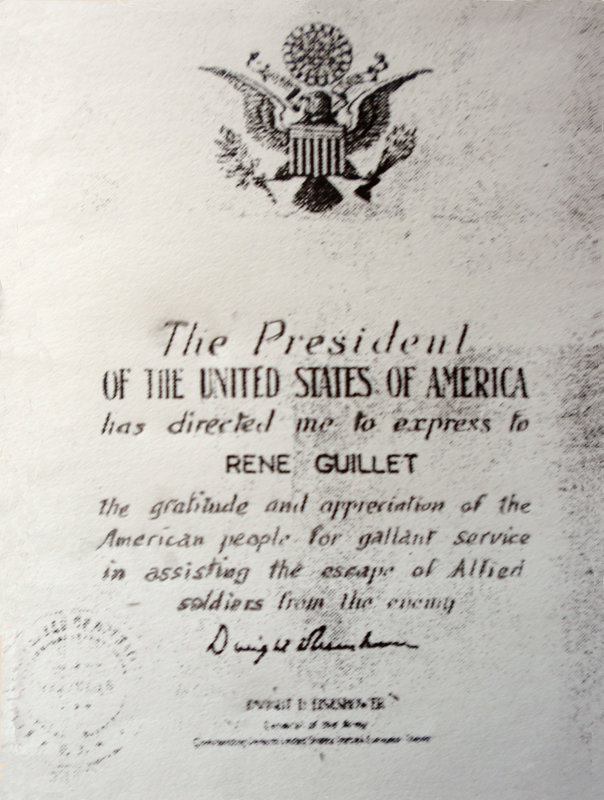 Le certificat signé Eisenhower, reçu
par les Guillet.
Le certificat signé Eisenhower, reçu
par les Guillet.
En 1948, monsieur Guillet a été nommé chevalier du mérite agricole à titre exceptionnel pour son action pendant la guerre. Il est décédé en 1988.
Au début des années 1990, madame Guillet n’habite plus dans sa ferme de la Preuille. Elle l’a laissé à ses enfants après la mort de son mari. Elle vit dans un petit pavillon du « Foyer Soleil » à Saint-Hilaire-de-Loulay et se souvient d’Harold comme si tout cela s’était passé hier. Elle trouve que ce qu’elle a fait était bien naturel, n’en tirant aucune fierté.
A la recherche d’Harold Lyberger
Peu de temps après avoir caché Harold Lyberger, monsieur et madame Guillet avaient mis au courant le docteur René Picard, professeur à l’école de médecine de Nantes, et sa femme, propriétaires de leur ferme. Bien évidemment, les Picard avaient gardé le secret. Ils avaient même fait parvenir à Harold des livres en anglais pour le distraire et surtout avaient eu la bonne idée d’écrire un bref résumé de son parcours avec son nom et son numéro de matricule. Fort de ces renseignements retrouvés au début des années 1990, on pouvait espérer reprendre contact avec Harold Lyberger ou sa famille en écrivant à différents services de l’armée de l’air américaine. Cet espoir ne s’est malheureusement pas concrétisé : le National Personnel Records Center de Saint-Louis, Missouri, nous a appris qu’il était décédé le 19 août 1983. Il nous a par ailleurs été précisé qu’Harold n’avait pas eu d’enfant et que l’adresse de sa femme était inconnue. Madame Guillet en a été bien attristée, ayant gardé l’espoir d’avoir un jour de ses nouvelles.
L’odyssée d’Harold Lyberger ainsi reconstituée a été publiée en Janvier 1996 dans une revue vendéenne, «La fin de la Rabinaie». Un exemplaire en a été adressé à Monsieur Philippe de Villiers en soulignant le rôle exceptionnel qu’avait joué madame Guillet dans cette histoire et en proposant qu’une cérémonie soit organisée en son honneur.
La cérémonie en l’honneur de Madame Guillet
Il s’en est suivi, le samedi 12 octobre 1996, une cérémonie très émouvante à la ferme de la Haute-Preuille où Harold Lyberger avait été caché. Au cours de cette cérémonie, présidée par Monsieur Philippe de Villiers, étaient présents le maire de Saint-Hilaire-de-Loulay et l’union locale des anciens combattants portant leurs drapeaux. Christine Guillet, qui aurait bien mérité d’être décorée de la Légion d’Honneur, a reçu alors la médaille du département, la médaille de la commune et deux diplômes américains, l’un signé Ralph Patton, président de l’Escape and Evasion Society, l’autre signé par le Field Commander Rogers, de l’association des anciens combattants américains.
 Christine Guillet aux côtés de Philippe de Villiers lors de la cérémonie
du 12 octobre 1996.
Christine Guillet aux côtés de Philippe de Villiers lors de la cérémonie
du 12 octobre 1996.
Était présente aussi à la cérémonie Suzann Roten dont le père, John Roten, engagé dans la 8ème Air Force, avait lui aussi sauté de son avion en parachute lors de la seconde guerre mondiale. En février 1943, alors qu’il était à bord d’une forteresse volante du 91ème Bomb group, le même groupe que celui d’Harold Lyberger, il était venu bombarder Saint-Nazaire et avait été abattu par la DCA. Sur les 10 hommes d’équipage, seuls quatre d’entre eux avaient pu sauter en parachute. Les trois camarades de John Roten étaient tombés en mer au large de Noirmoutier, près du port de l’Herbaudière. Des pêcheurs avaient voulu leur porter secours mais ils en avaient été empêchés par les Allemands pendant plusieurs heures. Lorsque ces pêcheurs avaient enfin pu partir, ils n’avaient pu repêcher que des cadavres. Plus chanceux, John Roten était tombé sur une maison de l’Herbaudière et avait été recueilli par des villageois qui lui avaient servi une grande tasse de café bien chaud et donné un gros chandail. Peu de temps après, les Allemands étaient venus l’arrêter. Il avait terminé la guerre en Allemagne dans un camp de prisonniers. En faisant des recherches sur les avions alliés tombés en Vendée au cours de la dernière guerre, le docteur Gouraud, médecin retraité demeurant à la Roche-sur-Yon, venait juste de retrouver sa trace et c’est ainsi que la fille de cet aviateur, Suzann Roten, de passage en France, était venu assister à la cérémonie de la Haute-Preuille, remettant à cette occasion à Christine Guillet la médaille de Malte, dédiée à ceux ayant œuvré pour la patrie américaine.
Le jour même de cette cérémonie, une plaque commémorant le séjour l’Harold Lyberger chez René et Christine Guillet a été posée sur le mur de la ferme où il avait été caché.
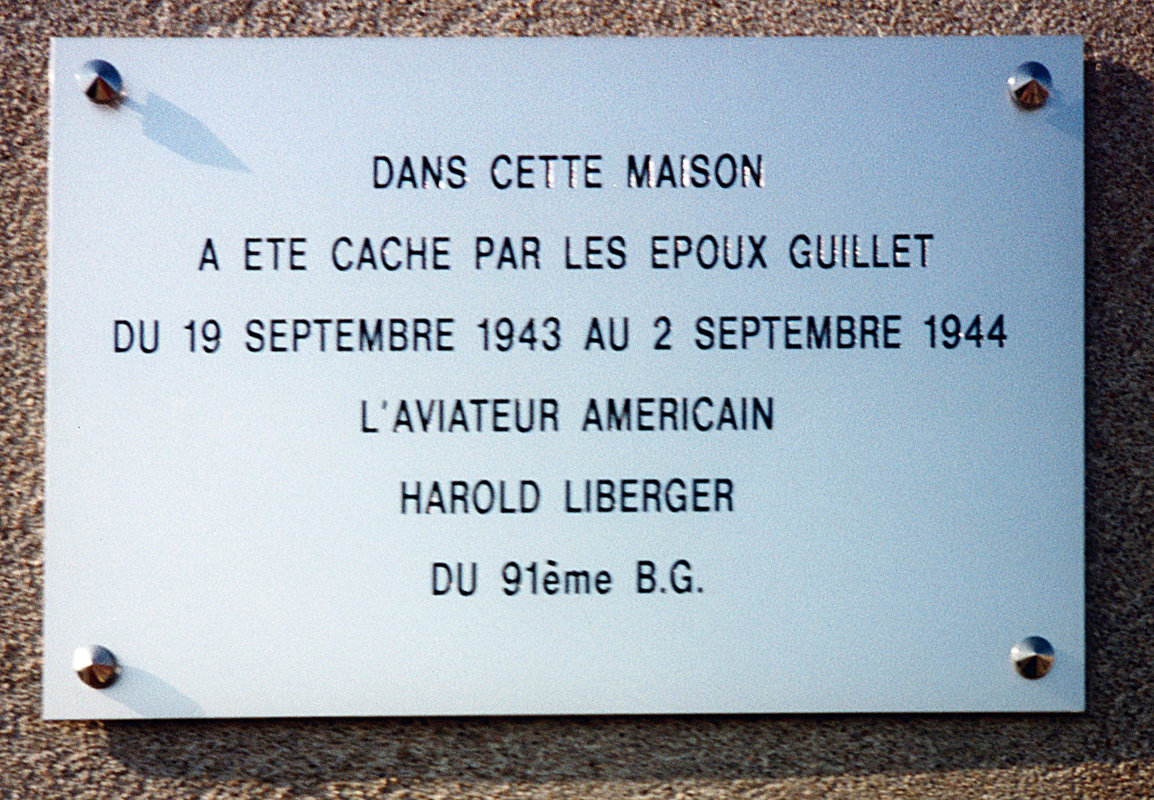
Plaque commémorative posée sur la maison de René et Christine Guillet.
Christine Guillet a manifestement été très heureuse de cet hommage en présence de ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants, certains d’entre eux découvrant ce jour là à quel point elle avait été courageuse et les risques qu’elle avait couru pour sauver cet aviateur américain. Elle en a été d’autant plus touchée que cet hommage était aussi rendu à son défunt mari, ce qui n’avait jamais été vraiment fait jusqu’alors.
L’année suivante, John Roten, venu à Noirmoutier sur les lieux de son atterrissage en parachute, est passé à la Preuille et a pu ainsi rencontrer cette femme hors du commun.
Christine Guillet est décédée en 2001 dans sa maison de retraite. Ces quelques lignes ont été écrites pour que son geste admirable ne tombe pas dans l’oubli.
le 22 septembre 2018
Alain GAILLARD

 Éditions La Chouette de Vendée
Éditions La Chouette de Vendée